Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
Pour une évaluation indépendante des OGM
Article publié dans le numéro 79 de l'Actualité Poitou-Charentes - Entretien avec Aurélien Bernier - Les effets à long terme des OGM sur la santé et l’environnement restent encore largement méconnus. Un système d’évaluation fiable et indépendant est incontournable pour se donner les moyens de répondre aux questions des citoyens.
Entretien Sarah Caillaud
Aurélien Bernier s’est engagé depuis plusieurs années dans le combat contre les OGM commerciaux. Il a fait ses premières armes dans l’organisation altermondialiste Attac en tant qu’animateur de la commission sur les OGM. Aujourd’hui, il est membre de la coordination régionale « vigilance OGM Poitou-Charentes » et secrétaire d’Inf’OGM (www.infogm.org). Créée pour pallier « un déficit d’information fiable et objective sur les OGM », cette association assure une « veille citoyenne ». Aurélien Bernier dénonce les méthodes d’évaluation des plantes transgéniques et soumet des idées de réforme.
L’actualité. - Pourquoi êtes-vous opposé aux OGM ?
Aurélien Bernier.- Dans l’absolu, je ne suis pas opposé par principe à la transgénèse. Si les OGM n’étaient pas brevetés, s’ils avaient un intérêt pour l’agriculture sans être contaminants, s’ils étaient correctement évalués et s’ils ne présentaient aucun risque pour la santé humaine et pour l’environnement, je ne serais pas inquiet. Malheureusement à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là.
Économiquement, nous n’avons aucun intérêt à cultiver des plantes génétiquement modifiées comme le font les Américains ou les Argentins. Nous ne pourrons jamais les concurrencer sur le terrain du productivisme. La France devrait plutôt se doter d’une agriculture davantage orientée vers la qualité et valorisable localement. Ce mode d’agriculture intelligente et respectueuse de l’environnement offre des débouchés commerciaux d’avenir. La demande en produits biologiques ou labellisés par exemple est en forte croissante.
Ce qui m'inquiète le plus actuellement pour les cultures traditionnelles, c’est la contamination par les plantes transgéniques. Avec l’introduction des OGM, la contamination de filières entières est inévitable. Contester le droit à un cultivateur de produire sans OGM, d’un point de vue démocratique, ça me choque profondément. D'autant plus qu'aujourd'hui, l’impact sanitaire et environnemental des OGM commerciaux est très mal évalué.
Quelle est la réalité des évaluations des OGM aujourd’hui ?
Aux Etats-Unis, on applique le principe « d’équivalence en substance ». On ne fait pas de différence entre un aliment traditionnel et son équivalent OGM. Or, les plantes génétiquement modifiées ne sont pas des organismes ordinaires. Des constructions génétiques sont insérées dans les cellules de ces plantes par transgénèse, ce qui est totalement nouveau par rapport aux méthodes de sélection traditionnelles. Les autorités américaines ont volontairement occulté cette réalité. Pour évaluer l’innocuité des aliments avec ou sans OGM, on utilise donc les mêmes critères : toxicité aigüe et risques allergiques notamment. Une autre conséquence est que les aliments issus d’OGM commercialisés aux Etats-Unis ne sont pas tracés, ce qui rend impossible l’identification d’éventuels impacts sanitaires sur le moyen ou le long terme. Cette décision politique est un contresens scientifique et démocratique.
En Europe, l’évaluation des OGM se fait variété par variété, ce qui paraît à première vue plus responsable. En fait, les évaluations sont négligées et peu fiables. Toutes les études permettant l’homologation d’une variété sont effectuées par les multinationales qui les commercialisent. Ces firmes limitent au maximum le coût des études qui, en conséquence, sont le plus souvent bâclées. Plus scandaleux encore : ces entreprises se retranchent derrière le secret industriel pour ne pas communiquer une partie des résultats. Les commissions chargées de l’examen des dossiers d’autorisation (la Commission du Génie Biomoléculaire en France, l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments – EFSA – au niveau communautaire) s’appuient donc sur ces expertises partisanes et incomplètes.
Il est urgent de repenser ce système et de mettre en place une évaluation indépendante. Il suffirait pour cela de confier l’évaluation à la recherche publique, à condition de vérifier qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts entre les experts sélectionnés et l’industrie des biotechnologies. Par contre, il n'est pas question que le contribuable paye le coût de cette évaluation. Pour cela, Monsanto, Limagrain et les autres firmes souhaitant commercialiser une variété d’OGM paieraient une somme forfaitaire correspondant au coût de l’évaluation des risques. Au final, avec une telle mesure, les OGM actuellement utilisés dans l’alimentation deviendraient sans doute non rentables.
Les commissions d'évaluation n’ont-elles pas les moyens de demander une contre-expertise ?
Dans l’absolu, c’est possible, mais dans la pratique aucune contre-expertise indépendante n’a été demandée à ce jour. La Commission du génie biomoléculaire, chargée de l’évaluation des OGM en France, ne sort pas du cadre de sa mission déterminée par décret : elle doit dire si « en l’état actuel des connaissances scientifiques » et « sur la base des données fournies » (par les multinationales), elle estime que les OGM présentent un danger pour la santé ou l’environnement. Dans ces conditions, la réponse est évidemment non ! Au niveau européen, c’est l’Efsa (European Food Safety Authority) qui émet les avis, en suivant exactement la même logique. Ces recommandations permettent ensuite aux institutions européennes d’autoriser ou non un OGM. Il y a généralement deux étapes dans la décision. Le Conseil des ministres peut d’abord autoriser ou refuser la variété OGM s’il dégage une majorité qualifiée. Dans le cas contraire, c’est à dire à chaque fois, c’est la Commission européenne qui tranche, et elle donne systématiquement son accord à la commercialisation. Cet accord est ensuite valable dans tous les Etats membres de l’Union. Si un Etat membre veut refuser l’OGM après coup, il devra invoquer une « clause de sauvegarde » pour l’interdire sur son territoire, en apportant des preuves scientifiques nouvelles montrant un risque pour l’environnement ou la santé. C’est une véritable « usine à gaz ».
Vu la complexité de ces procédures d’autorisation, l’évaluation des OGM pourrait sembler rigoureuse…
Ce n’est pas le cas. Si on suivait les directives européennes et leurs critères d’évaluation à la lettre, le contrôle des plantes transgéniques avant autorisation serait très sérieux. Par exemple, la directive européenne 2001-18 relative aux conditions de culture et de mise sur le marché des OGM comporte 50 pages d’annexes sur l’évaluation. Les procédures n’ont jamais été totalement appliquées. Progressivement, on est de plus en plus laxiste et certaines exigences sont abandonnées. Par exemple, le règlement de 2003 sur l’étiquetage et la traçabilité des OGM a instauré une procédure simplifiée. Dans les étapes d’évaluation, l’avis des ministres de l’environnement (plutôt défavorables aux OGM) a été remplacé par celui des ministres de l’agriculture. Ces derniers sont plutôt pro-OGM et davantage aux prises avec le lobby agricole.
Pourtant, dans l’attente d’une évaluation sérieuse, le gel des cultures d’OGM a été décidé lors du Grenelle de l’environnement. N’est-ce pas une première avancée ?
Le gouvernement a enfin entendu les opposants et les citoyens qui sont sceptiques au sujet des OGM. Les décisions prises lors du Grenelle de l’environnement constituent une première avancée même si nous sommes encore loin de la révolution écologique. Le contexte a fortement fait pencher la balance. La France a suivi un mouvement enclenché en Europe récemment. L’Autriche en tête, suivie de la Hongrie, la Grèce, la Pologne et plus récemment l’Allemagne ont mis en place des moratoires contre les OGM, qui n’ont pas pu être cassés par l’Union européenne, car ils se basent sur des études scientifiques solides qui révèlent de sérieux doutes sur leur innocuité. Les Etats commencent à prendre conscience des dysfonctionnements des évaluations. De plus, pour la première fois, M. Stavros Dimas, commissaire européen à l’environnement, a pris publiquement position contre la commercialisation de deux variétés de maïs Bt produisant un insecticide. Cette contestation au niveau communautaire devra forcément aboutir à une réforme du système d’évaluation des OGM.
Derrière les moratoires sur les OGM, le procès de l'Europe libérale
Si cette décision ne clôt évidemment pas le dossier, elle est malgré tout d'une importance majeure. Elle constitue tout d'abord la victoire d'un mouvement large et divers qui lutte depuis plus de dix ans pour faire entendre des arguments solides. Derrière la caricature dressée par les grands médias, qui se sont très rarement intéressés à autre chose qu'aux actions spectaculaires, des militants ont fourni un travail incroyable pour convaincre les citoyens, les élus, les scientifiques, que nous étions avec la question des OGM face à un choix de société. Le succès tient essentiellement à une chose : le fait d'avoir su dépasser les clivages partisans pour poser sur la table les termes du débat et mettre les néolibéraux face à leurs propres contradictions. Ces derniers, qui font de la liberté d'entreprendre une valeur suprême, se sont trouvés dans une situation intenable qui consistait à vouloir l'offrir sans réserves à des firmes comme Monsanto (l'américaine !) et à la refuser aux agriculteurs sous labels de qualité. Pris au piège de leur propre idéologie, ils n'ont pu que constater le revirement des politiques de droite comme de gauche, qui sont passés d'une opinion initialement favorable ― ou « plutôt favorable » ― aux OGM à un refus ou une extrême réserve. Ce fut le cas du Parti Socialiste et du Parti Communiste à la veille des élections régionales de 2004, puis de l'actuel MODEM lors de la campagne présidentielle de 2007. A présent, même si elle est loin de marquer un basculement complet de l'UMP, la décision de Nicolas Sarkozy prend des allures d' « outing » pour une part non négligeable d'élus de droite qui doutent depuis longtemps de la pertinence à disséminer des OGM.
Cette année 2008 qui débute par un moratoire se poursuivra par la bataille sur la loi qui doit rapidement transposer la directive 2001-18 en droit national. L'objectif majeur est d'obtenir un cadre qui garantisse le droit de produire sans OGM dans la durée, et ce pour tous les types de cultures et pas seulement le maïs-pesticide. L'examen du projet divulgué fin 2007 montre que le chemin est encore long mais qu'il est maintenant permis d'être raisonnablement optimiste.
Surtout, il convient dès à présent d'engager au niveau communautaire un bras de fer sans lequel rien ne sera jamais résolu. Depuis plusieurs années, la tension monte sur le dossier des OGM entre la Commission et certains Etats membres. Un groupe de pays « non alignés » tente par différents moyens d'infléchir des commissaires libre-échangistes qui ont toujours plaidé en faveur des plantes et des aliments transgéniques. C'est le cas de l'Autriche, de la Hongrie et de la Pologne ― qui ont utilisé la clause de sauvegarde bien avant la France ― mais aussi de l'Italie, de la Grèce ou de l'Irlande, et, dans une posture plus hypocrite, de l'Allemagne. Ces Etats ont même été rejoints dans leur contestation par le commissaire à l'environnement, M. Stavros Dimas, qui appelle au recalage de deux OGM dont la demande de commercialisation en Europe est déposée. Le prochain combat, sur lequel les chances de victoire sont réelles, est donc celui de la refonte du système d'autorisation européen, et la présidence française de l'Union qui début le 1er juillet 2008 constitue une belle opportunité. Il conviendra alors de ne pas s'en tenir aux cultures, même si l'urgence est effectivement là, mais d'évoquer aussi la question gênante des importations.
Enfin, il serait dommage de confiner l'analyse aux seules questions agricoles, sanitaires et environnementales, car les conclusions à tirer de dix ans de lutte contre les OGM sont bien plus politiques. Derrière la dissémination des moratoires et les prises de position de M. Dimas, c'est bien le procès de l'Europe qui a lieu actuellement. Une Europe profondément libérale, dont le bras armé est une Commission toute puissante, totalement incapable de décider dans le sens de l'intérêt général. La « gardienne des Traités » a ainsi dépensé une belle énergie à poursuivre les Etats membres qui tentaient d'activer la clause de sauvegarde malgré des doutes scientifiques évidents. Elle a donné raison à une agence d'évaluation scandaleusement incompétente, l'EFSA (1), en ayant parfaitement connaissance des profondes lacunes des procédures lui permettant de fonder ses avis. S'il ne tenait qu'à la Commission, le principe d'équivalence en substance, qui mettrait un terme à toute évaluation spécifique des OGM en considérant qu'ils sont assimilables à des aliments traditionnels, serait depuis longtemps en vigueur en Europe. Le Parlement européen, quant à lui, a été dans l'incapacité de s'opposer à une telle logique, apportant même parfois sa pierre à l'édifice. Ainsi, en adoptant avec le Conseil les règlements 1829 et 1830/2003 sur la traçabilité et l'étiquetage des OGM, il introduisit pour le plus grand bonheur des multinationales une procédure « simplifiée » d'autorisation qui transforme la demande de mise sur le marché d'OGM en une simple formalité administrative.
Dès lors, la vraie conclusion à tirer est malheureusement claire. Les institutions européennes, prises au piège du libre-échange, travaillent sur ce dossier comme sur bien d'autres contre l'intérêt des peuples, se livrant à une forfaiture permanente. La résistance aux politiques libérales ne peut passer aujourd'hui que par les Etats, mais l'ampleur de la tâche est devenue incroyable. Dans le cas emblématique des OGM, il aura fallu dix ans pour obtenir un rapport de forces favorable avec le soutien sans faille des citoyens. Combien faudra t'il sur d'autres questions commerciales, sur le droit du travail, sur la fiscalité, sur la protection sociale, sur les délocalisations ? Le temps perdu dans la guérilla politico-juridique à l'échelon communautaire ne serait-il pas mieux employé à construire un vrai système alternatif ? Et, au final, peut on faire une « autre Europe » sur les fondements de celle qui s'est livrée corps et âme au néolibéralisme ?
(1) Agence Européenne de Sécurité Alimentaire.
Faut-il brûler le Protocole de Kyoto ?

Les premiers travaux d’économie préfigurant la notion de taxe environnementale remontent à 1920, quand l’économiste britannique Arthur Cecil Pigou publie The Economics of Welfare [économie du bien-être], ouvrage dans lequel il traite des « externalités » ou « effet externe » d’un acte de production ou de consommation. L’auteur prend pour exemple les escarbilles produites par les locomotives à vapeur : des morceaux de charbon incandescents qui s’échappent parfois des cheminées et déclenchent des incendies de forêts ou de champs à proximité des voies ferrées. Pigou considère qu’une taxe sur les dégâts, infligée à la société des chemins de fer, inciterait à l’installation de dispositifs anti-escarbilles et permettrait de limiter les préjudices. Ce raisonnement pose les bases de l’économie de l’environnement et du principe « pollueur-payeur ».
Quarante ans plus tard, un autre économiste britannique, Ronald Coase, critique les thèses de Pigou. Avec quelques décennies d’avance sur les négociations de Kyoto, il offre un argumentaire en or pour les firmes polluantes souhaitant échapper aux contraintes des pouvoirs publics et « laisser faire le marché ». Coase conteste l’efficacité des taxes « pigouviennes » au motif qu’elles induisent des coûts de transaction liés à l’intervention de l’Etat. D’après lui, l’optimum économique serait atteint si les victimes des incendies négociaient directement avec la société des chemins de fer. Il prétend que si une firme possédait les chemins de fer et les zones alentour, elle règlerait d’elle-même le problème par un calcul d’optimisation interne. Selon le théorème de Coase, d’un point de vue économique, la définition des droits n’a pas d’importance : il est indifférent de considérer que le propriétaire des champs ou des forêts possède le droit de ne pas être victime d’incendies, ou bien que, à l’inverse, la société des chemins de fer dispose du droit de les provoquer.
Pourtant, dès 1970, face à une pollution atmosphérique persistante, les Etats-Unis décident de fixer des normes très strictes sur les rejets de polluants et révisent à cette fin une loi fédérale dite « Clean Air Act ». Deux ans plus tard, le Club de Rome, organisation internationale réunissant scientifiques, économistes, fonctionnaires et industriels, publie un rapport intitulé « Les limites de la croissance » (1), qui prévoit un futur assez catastrophique si les humains ne prennent pas en compte rapidement la dimension environnementale. L’hypothèse d’une relation entre la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère et le changement climatique émerge ; les débats sur l’effet de serre deviennent de plus en plus présents dans la société.
Malgré cette prise de conscience, une victoire idéologique des libéraux s’amorce au début des années 90. Devant l’incapacité des zones urbaines à respecter le « Clean Air Act », le gouvernement américain, après différents assouplissements, décide de mettre en œuvre un système d’échanges de droits d’émission. Ce système s’inscrit dans un nouveau programme intitulé « Acid Rain » (pluies acides) qui fixe des objectifs de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), responsable des pluies acides. Le dispositif délivre aux cent dix installations les plus polluantes des autorisations à émettre du SO2, puis leur permet l’échange libre de ces droits sur le marché.
Le pari est fait que les améliorations auront lieu en priorité là où les coûts d’investissement pour les réaliser sont les plus faibles, et que les surplus d’autorisations ainsi générés seront vendus aux exploitants émettant au-delà du volume qui leur a été attribué. De très fortes amendes sont prévues pour sanctionner une firme qui ne présenterait pas en fin d’année autant d’autorisations que de tonnes de SO2 libérées dans l’atmosphère.
En apparence, ce système respectait les préconisations de Ronald Coase en laissant fonctionner le jeu du marché. « Acid Rain » aboutit à un véritable succès du point de vue des rejets de SO2 : l’objectif chiffré de réduction des émissions de 40 % par rapport à la situation de 1980 a été atteint et même dépassé. Pourtant, à y regarder de plus près, il serait malhonnête d’attribuer cette réussite au marché.
Tout d’abord, le renforcement de la règlementation auquel s’ajoutait un système de contrôle en continu des polluants en sortie de cheminées, a poussé bon nombre d’exploitants à anticiper les travaux de mise aux normes. De plus, l’industrie du charbon a développé des produits à faible teneur en soufre, moins émetteurs de SO2, qui sont devenus compétitifs. Ces deux phénomènes expliquent en grande partie la forte baisse des émissions, les échanges sur le marché n’intervenant qu’à la marge (2). Enfin, les effets secondaires sont loin d’être négligeables. Le pouvoir calorifique inférieur du nouveau charbon moins soufré impose d’en consommer une plus grande quantité… ce qui augmente mécaniquement les émissions d’un autre polluant : le dioxyde de carbone !
Mais les tenants de la non-intervention de l’Etat feront mine de ne retenir qu’une chose : le marché de quotas est efficace, il peut donc être généralisé. Créé en 1988 à la demande du G7, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) tente d’alerter les décideurs sur les conséquences du réchauffement climatique en publiant des rapports. En 1992, la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC) est ouverte à ratification, et recevra une réponse favorable de la quasi-totalité des états. Elle affiche comme objectif de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère », sans toutefois indiquer d’objectifs chiffrés ni de moyens. Cette phase opérationnelle est renvoyée à un traité « fils », le Protocole de Kyoto, dont les premières négociations débutent en décembre 1997. Le cadre des Nations unies imposant l’unanimité, la bataille est rude entre pays industrialisés et pays en développement. Il faudra près de quatre ans pour aboutir, le 10 novembre 2001, aux Accords de Marrakech – traduction juridique du Protocole de Kyoto.
Le retrait des Etats-Unis, à l’issue d’un vote au cours duquel près d’une centaine de sénateurs américains se sont prononcés contre la ratification (et aucun pour…), a fait chuter à 40 % des émissions mondiales le gisement de gaz à effet de serre (GES) ciblé. L’engagement global de réduction de 5,2 % par rapport au niveau de 1990, à l’horizon 2012, contenu dans le Protocole de Kyoto, correspondait donc à une baisse de 2 % des rejets annuels de GES sur la planète. Si l’on ajoute qu’au moment où se négociaient les modalités de mise en œuvre, les émissions étaient déjà inférieures de 4,8 % à celles de 1990 (3), l’ambition réelle du Protocole se limite à une diminution de 0,16 % des tonnages de GES rejetés dans l’atmosphère ! Ce chiffre n’apparaît bien sûr nulle part dans les communications officielles tant il peut paraître ridicule comparé aux enjeux.
En contrepartie de cette minuscule concession, le lobby des plus gros pollueurs a pu obtenir des mécanismes dits « de flexibilité » dont il pourra tirer un maximum de bénéfices.
Le premier outil est ce fameux marché de « permis d’émissions négociables » imposé par les Etats-Unis, au prétexte que leur expérience sur le SO2 a fonctionné. Peu importe que le territoire concerné ne soit plus homogène, que le nombre de sites émetteurs soit sans commune mesure avec le nombre de centrales au charbon américaines, ou encore que le Protocole de Kyoto ne s’appuie sur aucun cadre réglementaire commun.
Chaque Etat inscrit à l’Annexe B (4) définira donc un plan d’allocation des quotas permettant de distribuer, comme au début d’une partie de Monopoly, le volume de droits à émettre du CO2 à ses installations les plus polluantes (5). Bien entendu, les gouvernements ne s’abaisseront pas à faire payer ces quotas aux industriels, ce qui aurait généré des recettes fiscales permettant de mener des politiques publiques ambitieuses en faveur de l’environnement. Il s’agit donc réellement de « droits à polluer », cette gratuité supposant que l’environnement appartient par défaut à ceux qui lui portent atteinte.
Une fois les comptes-carbone crédités, les entreprises ne sont plus soumises qu’à une obligation : restituer à la fin de la période de fonctionnement autant de quotas que de tonnes de CO2 produites. Cette « restitution » prend la forme d’une simple opération comptable. Affectées au passif des sociétés, les émissions annuelles doivent être équilibrées par le volume de quotas initialement attribué, augmenté des achats et diminué des ventes.
La réalisation de projets économes en gaz à effet de serre (implantation d’éoliennes, captage de méthane issu de décharges, substitutions de combustibles, développement de la filière bois, etc.) peut aussi permettre un transfert de quotas entre signataires du Protocole. Il s’agit de la mise en œuvre conjointe (MOC), dans laquelle le pays hôte cède une part de ses quotas aux investisseurs en proportion des émissions évitées.
Mais les pays en développement, avec à leur tête le Brésil, ont obtenu que les Etats non inscrits à l’Annexe B puissent également accueillir de tels projets, qui présentent pour eux l’intérêt d’attirer de nouveaux capitaux étrangers. Dans ce cas, puisque le pays hôte n’a pas d’engagement au regard du Protocole de Kyoto, le volume annuel de GES évité donne lieu à la création de nouveaux crédits baptisés URCE (unités de réduction certifiée des émissions). Sur le marché mondial, cette opération revient donc à augmenter la masse de monnaie-carbone. Comme pour la MOC, les crédits URCE sont attribués gratuitement par les Nations Unies aux investisseurs, qui pourront soit les utiliser pour respecter leurs engagements s’ils sont concernés par un plan d’allocation, soit les vendre sur les marchés, au même titre qu’un quota alloué par un Etat. Cette formidable idée prend le nom de « Mécanisme de développement propre » (MDP) et permet de ne plus avoir à s’inquiéter de la rareté des quotas, dont le réservoir devient extensible à souhait.
Enfin, les parties sont invitées à étendre ces dispositifs à des secteurs non couverts par l’allocation des quotas. Les « projets domestiques », pour lesquels le gouvernement français a fixé au printemps 2007 un cadre réglementaire (6), offrent un accès au marché à des exploitants faiblement émetteurs, privés ou publics, ainsi qu’aux secteurs agricoles et du transport, en contrepartie d’investissements contribuant à diminuer les rejets ou à absorber le dioxyde de carbone.
Le Royaume-Uni va plus loin, puisqu’il travaille actuellement sur un texte de loi visant à attribuer un volume de quotas à chaque personne adulte. Cette quantité de droits, créditée sur une carte à puce, serait débitée à chaque consommation d’énergie primaire : plein d’essence, remplissage d’une cuve de fuel, règlement d’une facture d’électricité… Une fois le solde épuisé, il faudrait payer au prix fort le rechargement de la carte de crédit-CO2, ou bien acheter des unités supplémentaires sur le marché.
Pour préparer la phase d’application du dispositif prévu dans le Protocole de Kyoto, qui concerne la période 2008-2012, l’Union européenne a lancé, dès 2005, son propre marché du carbone. Les deux premières années de fonctionnement sont très riches d’enseignements et dévoilent tous les risques encourus avec l’application de recettes aussi libérales.
Le marché européen du carbone est calqué sur le fonctionnement des marchés financiers. Les échanges peuvent se faire soit directement entre détenteurs de quotas (« de gré à gré »), soit sur des places financières organisées (Bourses de CO2) qui permettent de faciliter et de sécuriser les transactions. Ces dernières se font soit au comptant, soit « à terme », c'est-à-dire à une date de livraison déterminée à l’avance. Ainsi, on peut suivre l’évolution de deux prix différents pour le carbone : le prix de la tonne au comptant (dit « SPOT »), et le prix de la tonne livrée en décembre 2008 (dit “ Futures ”).
Après avoir oscillé entre 20 et 30 euros pendant près d’un an, le prix SPOT s’est effondré au printemps 2006, avec la publication d’un premier bilan des émissions réelles des entreprises. Ces résultats ont montré à quel point l’attribution de quotas par les gouvernements a été généreuse, ce qui n’est en rien surprenant puisque les plans se sont appuyés sur les prévisions des industriels. Courant septembre 2007, le prix du CO2 touchait le fond, à cinq centimes d’euros la tonne au comptant, ce qui couvre tout juste les coûts de transaction.
La logique qui sous-tend les investissements liés à l’effet de serre est clairement une logique de rentabilité. De nombreux fonds carbone sont créés pour gérer les portefeuilles de quotas, en particulier ceux délivrés via les projets MDP. La Banque mondiale est le premier gestionnaire d’actifs carbone (7). En France, la Caisse des dépôts et consignation est en même temps chargée de la tenue du registre national des quotas et gestionnaire du Fonds carbone européen, qu’elle a pris soin de loger… dans une Sicav luxembourgeoise.
Il n’est pas nécessaire d’effectuer de longs calculs pour comprendre pourquoi la course aux projets MDP est d’ores et déjà lancée. Compte tenu des niveaux d’équipement et des différences de coût de main d’œuvre, économiser une tonne de CO2 en Europe demande un investissement de 80 euros. En Chine, la même tonne évitée coûte en moyenne… 3 euros (8). Ce mécanisme constitue donc non seulement une formidable réserve de quotas, mais qui plus est, les soldes y ont lieu toute l’année… Dès lors, personne ne trouvera étonnant que les entreprises des pays développés préfèrent investir en Chine pour créer des activités économes en GES ou moderniser des installations existantes plutôt que de réduire leurs propres émissions. De plus, en abondant des fonds carbone avec de l’argent public, les Etats ont la possibilité d’accorder des aides déguisées aux entreprises, puisque ce sont elles qui bénéficieront au final des quotas nouvellement créés.
Selon certains analystes, les projets MDP devraient générer d’ici 2012 un volume de nouveaux quotas équivalent aux émissions de GES cumulées du Canada, de la France, de l’Espagne et de la Suisse. En 2006, plus de 40 % du marché mondial du carbone était constitué d’URCE (9), une partie d’entre elles étant d’ailleurs attribués de manière totalement abusive à des projets qui ne le justifient pas (10).
Quant aux bénéficiaires, ils restaient les pays les plus attractifs pour les investisseurs. Selon la Banque mondiale, la Chine et l’Inde pesaient à elles seules 73 % des URCE et les projets qu’elles accueillent se comptaient par centaines. Le continent africain dénombrait à peine plus d’une trentaine de projets, et 80 % des crédits se concentraient sur trois pays : Afrique du Sud, Egypte et Tunisie. Nous sommes donc très loin des bonnes intentions qui parsèment les publications officielles, qu’elles fassent état de protection de l’environnement, de transfert technologique ou d’aide au développement durable.
Dans un diaporama mis en ligne sur un site gouvernemental, le groupe Lafarge décrit « les facteurs clés de succès pour les projets MDP » de la façon suivante : « Réaliser des projets simples ; éviter les procédures longues et coûteuses ; comprendre et anticiper les critères d’évaluation du risque ; chercher des possibilités de réplicabilité (sic) du projet ; obtenir des appuis forts dans le pays hôte (11). »
Au-delà du cynisme des grands groupes, l’ambiance générale sur les marchés liés au changement climatique rappelle la période d’euphorie qu’ont connu les nouvelles technologies de l’information. Une véritable bulle spéculative se forme autour des procédés économes en CO2 et générateurs de quotas valorisables. Le Français Areva a bataillé plusieurs mois avec le groupe indien Suzlon pour acquérir le premier fabricant d’éolienne allemand, Repower, sans parvenir à ses fins. Début avril 2007, la société était valorisée cent fois son résultat d’exploitation 2006, qui dépasse les douze millions d’euros. Pour la filiale environnement d’EDF, l’introduction du titre en Bourse a réussi au-delà de toutes les espérances. En moins d’une heure et demie, l’action gagnait 20 %, et la cotation en fin de journée s’élevait à six fois le chiffre d’affaires. En février 2007, l’électricien renforçait son positionnement sur le marché du renouvelable en achetant 66 % du capital de Supra, spécialiste du chauffage au bois.
Quant au groupe Rhodia, il s’est livré ces dernières années à un autre genre d’exercice. Secouée par les scandales, la société frôlait en 2003 le dépôt de bilan. La direction décide alors de miser sur le carbone. En novembre 2005, elle annonce la rénovation de deux usines situées l’une en Corée, l’autre au Brésil. En effectuant 14 millions d’euros de travaux sur ces usines, Rhodia va obtenir des quotas de CO2 (77 millions de tonnes) valorisables à hauteur de 200 millions d’euros par an ! Le titre progresse de 14 % dans l’heure qui suit (12). Le fonds carbone dans lequel seront placés les titres sera géré en partenariat avec la Société Générale.
Alors que les banques d’affaires comme Lehman Brothers ou les réassureurs comme Swiss-Re commencent tout juste à inciter les investisseurs à s’engager dans la finance carbone (13), nous ne sommes qu’au début d’un processus spéculatif dont les dangers sautent déjà aux yeux. La manière dont se profilent les négociations internationales pour l’après-2012 est très inquiétante. Les parties au Protocole semblent en effet prêtes à de nombreuses concessions pour obtenir cette fois l’accord des Etats-Unis. Or, la stratégie américaine pourrait être de décrocher, à la place d’objectifs absolus de réduction des émissions, soit des engagements non contraignants, soit des objectifs exprimés en « intensité carbone », qui reflète le contenu en CO2 de la croissance. Dans ce deuxième cas, le référentiel deviendrait la quantité de dioxyde de carbone émise par point de produit intérieur brut (PIB), ce qui aboutirait à ranger définitivement les politiques de lutte contre le changement climatique au rayon des décorations.
Il reste donc peu de temps pour réagir et les cautions apportées par certains écologistes ne favorisent pas la prise de conscience. Quand Mme Dominique Voynet, ancienne ministre de l’environnement, estime que « le piège a été de croire que les échanges de droits d’émission constituaient un mécanisme libéral (14) » ou quand M. Alain Lipietz, député européen Vert, se félicite du système des permis négociables (15), ils se risquent à justifier l’injustifiable.
Or, aucune solution efficace ne peut vraisemblablement exister sans remettre en cause les systèmes de production et les règles du commerce international, en instaurant par exemple de nouveaux droits de douane qui intègreraient le contenu énergétique et carbonique des produits d’importation. Ce dispositif se situerait à l’opposé d’une logique protectionniste, les recettes étant utilisées pour mettre en œuvre des projets réellement durables dans les pays en développement, en confiant leur réalisation à des entreprises locales ou à des entreprises conjointes dont les capitaux proviendraient majoritairement du pays hôte.
Cette taxe mixte carbone/énergie devrait aussi s’appliquer aux activités industrielles résidentes. Dans ce cas, les recettes pourraient alimenter pour moitié le budget de l’Etat et autoriser des politiques publiques ambitieuses en matière d’environnement. L’autre moitié serait placée sur un compte individualisé de l’entreprise, réservé à l’investissement dans des technologies lui permettant de réduire ses émissions. Enfin, un conditionnement efficace des aides publiques devrait compléter le dispositif. En d’autres termes, pour répondre à l’échec de Coase et aux enjeux de la crise environnementale, nous devons réinventer Pigou.
AURELIEN BERNIER
Auteur de Les OGM en guerre contre la société (Attac, Mille et une nuits, Paris, 2005) et co-auteur de Transgénial ! (Attac, Mille et une nuits, 2006).
(1) Publié en 1972 sous le titre Halte à la croissance ? Rapports sur les limites de la croissance, Fayard, Paris.
(2) Olivier Godard, « L’expérience américaine des permis négociables », dans la revue du CEPII, n° 82, 2000. Voir aussi la chronique économique de Bernard Girard, « Le marché des droits à polluer », http://www.bernardgirard.com/
(3) Pierre Cornu, Courrier de la Planète / Cahiers de Global Chance, Paris, avril/juin 2004.
(4) L’Annexe B du Protocole établit la liste des états visés par ces engagements de réduction : il s’agit uniquement des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des pays d’Europe de l’Est « en transition vers une économie de marché ».
(5) Les gaz à effet de serre ciblés par le Protocole de Kyoto sont au nombre de six : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), l'hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) , les hydrocarbures perfluorés ou perfluorocarbures (PFC). Une conversion permet de ramener toutes les émissions en « équivalents CO2 », le dioxyde de carbone étant le principal responsable de l’effet de serre et, par conséquent, l’unité de référence.
(6) Arrêté publié le 8 mars 2007 au Journal Officiel ; http://www.actu-environnement.com/.
(7) Fin juillet 2007, la Banque mondiale gérait onze fonds carbone pour un montant de 2,23 milliards de dollars. La contribution moyenne des gouvernements y est d’environ 50 %.
(8) Annie Vallée, Economie de l'environnement, Points Economie, Paris, 2002.
(9) Banque Mondiale, “State and Trends of the Carbon Market 2007 ”, mai 2007. Le chiffre cité correspond aux échanges exprimés en tonnes de CO2.
(10) Un rapport interne au comité d’évaluation des projets MDP dévoile les grandes largesses des cabinets d’audit privés chargés d’analyser le contenu des dossiers vis à vis des industriels qui les présentent. Voir l’interview d’Axel Michaelowa, (7 juin 2007) : www.lemonde.fr.
(12) Libération, Paris, 10 novembre 2005.
(13) Lehman Brothers a publié début 2007 un rapport intitulé « Le marché du changement climatique » dans lequel la banque recense les « défis » et les « opportunités » pour les entreprises. Voir aussi www.swissre.com, rubrique « Climate Change ».
(14) Courrier de la Planète / Cahiers de Global Chance, avril/juin 2004.
(15) http://lipietz.net/.
Commentaires
1. version5 le 28-12-2007 à 23:39:38 (site)
Bonne question ! Scandaleuse réalité.
Une autre question : comment se faire entendre des seules personnes qui détiennent l'ultime pouvoir : les consommateurs-citoyens ...
Car "on" écoute ... "on" commence à s'informer et puis on se fatigue. Tout cela représente trop d'efforts, de changements de pratiques ... "On" en exige déjà tant de nous!!
2. abernier le 02-01-2008 à 19:34:10 (site)
Bonjour,
Je crois comme je l'ai écrit par ailleurs qu'il faut passer à une autre phase de mobilisation.
Depuis une dizaine d'années, le mouvement altermondialiste élabore une critique du système néolibéral. Cette critique est indispensable. Elle peut et doit toujours être affinée et remise à jour.
Mais au delà, nous devons élaborer des alternatives crédibles, qui puissent donner de l'espoir en proposant autre chose.
Ceci ne peut à mon sens être porté que par le citoyen. C'est lui qui va collectivement influencer le politique, alors que le consommateur influence souvent individuellement l'économique. Je suis d'accord avec le fait que les choix de consommation ont du poids, mais je pense que ce poids n'est pas suffisant, et que l'enjeu d'aujourd'hui est réellement la soumission de l'économique au politique.
Je vous renvoie au texte ci-dessous, qui donne quelques pistes :
http://abernier.vefblog.net/4.html#Le_libreechange_arme_de_destruction_massive_de_len
Bien cordialement,
Aurélien Bernier
3. version5 le 03-01-2008 à 02:30:16 (site)
Bonsoir,
J'ai lu avec intérêt l'article auquel vous me renvoyez.
Votre conclusion est éloquente :
"Au final, les citoyens ne voient plus où trouver des alternatives crédibles. Ils votent et s’engagent par défaut. Nous devons rapidement nous attacher à combler ce vide idéologique et à faire émerger un mouvement qui, en tapant là où ça fait mal, crée l’enthousiasme sans lequel nous ne pourrons rien changer." ...
Je vois aussi bien, me semble-t-il, la nuance que vous faites, et qui me semble très judicieuse, entre le consommateur et le citoyen ! Reste que le citoyen n'est pas préparé ...
Son instruction a été réduite à une peau de chagrin ; son habitude de l'effort intellectuel passée par pertes et profit ; son devoir de résistance "taxé" de politiquement incorrect ... comment le citoyen peut-il faire face ? Et quel "parti" aura le courage de combler ce "vide idéologique" pour répondre aux mal-être grandissants de pans entiers de la population.
Là, tout de suite, qu'est-ce qui peut, ne serait-ce qu'un instant, retarder ces "groupes", ces "think tanks" qui redessinent les contours d'un monde où ils seront les seuls gagnants ?
Cordialement,
Vee (http://version5.vefblog.net)
4. Benoit le 30-03-2008 à 15:53:07
Mais créons donc ce "parti altermondialiste" !!
Les idées sont là, les hommes et les femmes sont là, tout est là sous nos yeux !
La vraie idéologie c'est de croire que l'on ne serait pas suivi...
J'ai déjà passé en revue les problématiques économiques, environnementales, institutionnelles, sociales, philosophiques et j'en passe...encore une fois tout est là !!!
Commençons à réunir les gens. Parlons sans arrêt de la création de ce parti. Faisons une synthèse de ce qui nous rapproche. Elaborons un programme politique. Présentons nous aux élections de 2012. Changeons la face du monde...
5. abernier le 31-03-2008 à 11:29:56 (site)
Bonjour,
Après sa période de gloire, l'altermondialisme s'essouffle justement à cause de cette absence de débouché politique.
Pourtant, la tâche n'est pas si simple. Comme l'a montrée l'affaire des collectifs unitaires, un parti qui permette ce débouché devra compter avec les intérêts des organisations en place, qu'elles soient politiques ou syndicales.
Comme vous, je pense que bien des choses peuvent nous rassembler, mais ce "nous" doit être un "nous" de citoyens, ouvert sur l'extérieur, plutôt qu'un "nous" de militants accrochés à leurs appareils.
Il faut alors poser les questions sans tabous et sans craindre, effectivement, de ne pas être suivis. Le libre échange a t'il un sens? Peut-on vouloir changer de système et rester dans l'OMC? L'Union européenne est-elle réformable ou bien faut-il en envisager la sortie pour construire cette autre Europe que nous voulons?...
Le programme de gouvernement que vous évoquez devra répondre à ces questions, ce qui n'a jamais été fait jusqu'alors. C'est seulement de cette façon qu'il obtiendra la crédibilité qui échappe de plus en plus au mouvement altermondialiste. Selon moi, il devra aussi parler de contrôle des changes, de droits de douane, de nationalisations et d'encadrement des prix.
Pourtant, loin de s'ancrer dans le passé, il doit mettre en oeuvre un véritable développement durable, qui lui non plus n'a jamais encore vu le jour. Après avoir énoncé que le social, l'environnement et l'économique doivent être pris en compte, il faut enfin établir des priorités. La toute première doit être la satisfaction des besoins sociaux. Mais le progrès social se doit d'être transmissible, et doit donc tenir compte de la contrainte environnementale. Dès lors, l'économique devra se soumettre à ces choix de société.
Je pense qu'un mouvement de fond qui irait dans ce sens serait capable de transcender une partie des clivages politiques. Ma seule objection serait donc : pourquoi attendre 2012?
Bien cordialement,
Aurélien Bernier
édité le 31-03-2008 à 11:33:17
6. Bergil le 05-03-2009 à 08:58:56
Bonjour,
Je trouve que le problème des quotas carbone est assez bien expliqué sur ton site, et pourrait même être un formidable argument pour leur mise en place si tu regardais du coté du verre à moitié plein : plusieurs société ont investis des millions pour polluer moins, ce qui est le but je crois ? ca c'est positif.
Le maillon faible du dispositif, c'est le volume des quotas attribués pour les industriels par l'état : il faut que ce volume diminue d'année en année pour les obliger à polluer toujours moins. Ainsi les prix vont monter, et la pollution baisser. Si on ne fait rien, les industriels vont continuer à polluer, ca ne coute rien !
A+
7. abernier le 05-03-2009 à 12:25:34 (site)
Bonjour,
Le verre n'est pas à moitié plein : entre 1997 et 2007, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté de 35% !
Le investissements ne sont pas fait en priorité pour polluer moins, mais pour bénéficier de plus-values sur le marché du carbone. Car, le problème principal n'est pas comme vous le dites le volume de quotas attribué par les Etats. Le problème principal est d'avoir autorisé la présence sur ce marché des acteurs de la finance qui ont provoqué la crise que nous vivons actuellement, ce qui ouvre la porte à toutes les manoeuvres spéculatives.
La tonne de carbone a perdu les deux-tiers de sa valeur sur les marchés depuis l'automne 2008, car les acteurs savent que l'activité industrielle va encore baisser. Dans ces conditions, il est impossible d'avoir une politique pérenne de lutte contre le changement climatique.
Bien cordialement,
Aurélien Bernier
La triste comédie de Bali
« Les Parties ont reconnu l’urgence de la situation en matière de changement climatique et apportent maintenant une réponse politique aux alertes des scientifiques ». Si une échelle équivalente à celle de Richter permettait de mesurer la langue de bois, aucun doute que cette déclaration de M. Yvo de Boer, secrétaire exécutif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, obtiendrait la note maximale. Cette affirmation d’un optimisme débordant à la sortie de la conférence de Bali est une totale contre-vérité. Le 15 décembre dernier, la clôture de la rencontre a marqué au contraire le décalage incroyable entre la gravité de la situation environnementale et la capacité des Etats à agir politiquement.
Comme on pouvait s'y attendre, rien de ce qui ressort de Bali ne permet de penser qu'un engagement chiffré et contraignant de réduction des gaz à effet de serre pourrait être accepté par les Etats-Unis ou par les pays émergeants comme la Chine et l’Inde. La première puissance mondiale tente même avec l'applomb qu'on lui connaît de contourner le cadre des Nations Unies pour négocier sur le climat. De nombreux commentateurs ont utilisé le terme de « sabotage ». Certes, le comportement des américains est une provocation, mais encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose à saboter !
La première victoire, selon les officiels, est l'accord autour d'une « feuille de route » qui devra déboucher sur un Protocole de Kyoto bis d'ici fin 2009. Pas de quoi pavoiser lorsqu'on sait que l'intégralité du contenu du futur texte reste à écrire, et que le bilan de Kyoto se résume à dix années de perdues ! Avec ses objectifs dérisoires que de nombreux Etats n'atteindront vraisemblablement pas, le fameux protocole aurait besoin d'un succésseur qui marque une profonde rupture. Mais personne n'y croît une seconde, à juste titre. Les mêmes recettes seront conservées, comme le marché des droits à polluer – véritable aubaine pour la finance – ou les mécanismes incitatifs qui ont remplacé toute idée de réelle contrainte sur les entreprises. Avec une totale inefficacité environnementale, démontrée par les chiffres. Bali a d'ailleurs été l'occasion de constater que le transfert des technologies propres entre les pays développés et les pays en développement ne fonctionnait pas. Curieuse découverte dans un monde où le brevet s'impose jusqu'au domaine du vivant !
La question primordiale de la déforestation fut traitée avec une détermination et un courage équivalents. Que faire contre la dégradation des forêts ? Appliquer des sanctions économiques contre les Etats qui refusent d'agir ? Non, les 187 pays présents en Indonésie ont eu une bien meilleure idée : rémunérer le maintien des zones boisées. On paiera donc le fait de ne pas couper les arbres qui stockent le CO2, tout comme sera payé le reboisement. A chaque étape, la monétarisation de l'environnement s'accélère encore un peu plus.
Enfin, un fonds d'adaptation pour les pays qui seront les premières victimes du changement climatique est créé. Il sera alimenté par un prélèvement de 2% sur les projets du Mécanisme de Développement Propre (MDP). Le MDP est une disposition du Protocole de Kyoto qui prévoit de récompenser les investissements dans des pays en développement pour des projets émettant moins de CO2 que la moyenne. La récompense est constituée de « crédits d'émission », qui permettront aux industriels de continuer à polluer dans les pays développés ou de faire des profits sur le marché du carbone en les revendant. Les ressources des Etats les plus pauvres pour se protéger du changement climatique seront donc les miettes que laisseront des multinationales après s'être goinfrées du nouveau marché des MDP.
Cette fois encore, la communauté internationale a réaffirmé le choix de la voie néo-libérale pour tenter de gérer la crise climatique. En proposant la mise en place d'une « Taxe Tobin 2 » sur les flux financiers, M. Jean-Louis Borloo a joué à Bali un véritable rôle de révolutionnaire. Dans cette posture, le ministre français est aussi crédible qu'un SDF qui réclamerait mille euros aux passants, tant les négociations sont à des kilomètres de telles extrémités. Mais ce dépoussiérage de la revendication initiale d'Attac par un dirigeant de droite aura au moins le mérite de souligner à quel point les ONG sont globalement absentes ou à côté du sujet. Plus personne ne devrait sérieusement croire qu'il sera possible d'agir en matière d'environnement sans s'attaquer à la finance, au libre-échange, à cette mondialisation qui n'a jamais été que néo-libérale. Il faut le répéter : la rupture doit être économique. Puisque la comunauté internationale a déjà renoncé à l'envisager, c'est aux Etats courageux, s'il en existe, de prendre des mesures. Y compris de façon unilatérale.
Le libre-échange, arme de destruction massive de l’environnement et du social
En consacrant toute leur énergie à promouvoir un système libre-échangiste à l’échelle planétaire, les grandes entreprises occidentales poursuivent des objectifs multiples : s’approvisionner à bas prix en matières premières ; bénéficier d’une main d’œuvre peu coûteuse et corvéable à merci ; rechercher les conditions fiscales les plus avantageuses pour les détenteurs de capitaux ; trouver de nouveaux marchés dans les pays émergeants ; et, de plus en plus, profiter des réglementations environnementales les plus permissives.
Les stratégies pour y parvenir sont finalement assez claires. Il s’agit d’une part de créer les conditions pour pouvoir implanter leurs activités dans les Etats présentant de ce point de vue les plus beaux avantages, et d’autre part, d’éliminer les obstacles « non nécessaires » au commerce – et notamment les barrières douanières – afin de vendre produits et services aux meilleures conditions dans n’importe quel pays. L’essentiel des mesures défendues par les lobbies néo-libéraux s’inscrivent dans ce double mouvement. Il s’agit en quelque sorte des deux jambes sur lequel marche ce système économique : la liberté de produire où bon lui semble, et celle de vendre comme bon lui semble. Depuis des décennies, ces objectifs n’ont eu de cesse d’être théorisés, c’est à dire habillés des parures de la « science économique », puis rabâchés par les puissances dominantes et les médias. Chacun est censé savoir à présent que la concurrence possède des vertus bienfaitrices, et que pour en retirer les avantages maximums, elle se doit d’être libre, totale et mondialisée.
Malheureusement, une simple observation de la réalité nous montre que la ficelle est bien grosse : alors que la mondialisation devait être heureuse, les statistiques officielles prouvent la supercherie, le nombre de malnutris sur le globe ne cessant d’augmenter, les écarts entre riches et pauvres ne cessant de se creuser. De plus, la cohérence du discours s’arrête toujours aux limites des intérêts des firmes. Ainsi, cette concurrence libérée des contraintes politiques, à défaut d’être non-faussée, n’interdit pas aux grandes puissances de continuer à subventionner grassement leurs économies en puisant dans les fonds publics, pour peu que ces cadeaux ne soient pas trop ostentatoires. Grâce à la totale hypocrisie des règles de l’OMC, les Etats-Unis et l’Europe ont pu par exemple convertir leurs aides directes à l’agriculture en aides indirectes et pérenniser un dumping dont les conséquences pour les paysans du Sud sont réellement désastreuses.
Faussée, la concurrence l’est donc délibérément. En premier lieu, par ce choix des instruments de régulation qui resteront tolérés, ou dont la suppression sera au contraire décrétée. L’établissement de barrières douanières ne nécessite qu’une réglementation assortie d’une police pour la faire respecter. En cela, il s’agit d’un outil accessible à la plupart des nations, même parmi les plus pauvres. A l’inverse, le fait de subventionner son économie est réservé aux Etats puissants. Les accords commerciaux comme ceux de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) visent donc à priver les pays pauvres d’un outil relativement simple de protection de leur économie, tout en laissant les pays riches soutenir leurs multinationales par des biais détournés.
Mais qui plus est, en offrant aux firmes la possibilité de s’implanter où bon leur semble et de vendre leur production avec le moins de restrictions possible, le libre-échange fausse totalement la concurrence en donnant un avantage évident, en tant que terre d’accueil, aux pays pratiquant le moins-disant fiscal, social et environnemental. Ce choix politique maintient des régions entières du globe dans des conditions de vie inacceptables, à l’image de la Chine pour laquelle le quasi-esclavage auquel est soumis une grande partie de son salariat est un argument majeur pour attirer les investisseurs. Il en va de même avec l’absence de réglementation environnementale qui deviendra, au fur et à mesure que les pays développés durciront la leur, une caractéristique prisée par les grands groupes.
Et dès lors que le politique ne s’autorise plus à protéger une économie nationale de cette concurrence hautement faussée, le libre-échange tire également vers le bas les réglementations dans les pays développés. La destruction plus ou moins rapide selon les gouvernements des acquis sociaux en France et dans le reste de l’Europe est bel et bien un objectif de la mondialisation. Le mouvement de régression prend une telle ampleur que, la crainte du chômage aidant, la pression n’épargne même plus les secteurs les moins exposés aux délocalisations, comme la production d’énergie ou les services de proximité.
Dans ces conditions, il est strictement impossible d’inverser la tendance sans s’attaquer à la cause. Prétendre rétablir une réelle contrainte sur les entreprises si ces dernières peuvent y échapper en s’installant sous des cieux plus cléments est totalement illusoire. Le libre-échange mondialisé possède cette vertu incroyable de priver les Etats du moindre levier politique sérieux vis à vis des entreprises, qu’il s’agisse de fiscalité, d’environnement ou de social. Dès lors, pour tenter de convaincre l’opinion publique que la nation n’est pas tout à fait dissoute dans le néo-libéralisme, des gouvernements comme celui de M. Nicolas Sarkozy se rabattent sur des politiques ultra-sécuritaire, avec l’intention évidente de donner le change tout en détournant l’attention des questions fondamentales. Si ces rideaux de fumée sont parfois efficaces d’un point de vue électoral, ils ne modifient en rien la réalité : les pouvoirs politiques, de droite comme de gauche, se sont peu à peu interdits d’agir sur l’économie et sont devenus des gestionnaires plus ou moins complaisants du néo-libéralisme.
Pourtant, la ré-appropriation par les Etats des leviers politiques permettant d’orienter l’économie vers la satisfaction des besoins sociaux n’est pas une douce utopie, car les moyens existent. Elle suppose par contre de s’attaquer clairement et prioritairement au libre-échange, en imposant des outils de régulation qui n’ont pas grand chose de nouveau. Nous pourrions par exemple en envisager deux, qui, utilisés conjointement, stopperaient cette machine à détruire l’environnement et le social.
Le premier consisterait à rétablir ce que l’OMC s’est évertuée à éliminer, à savoir les barrières douanières. Mais, en taxant les produits importés en fonction des conditions sociales et environnementales du pays d’origine, il ne s’agirait plus de mettre en place un protectionnisme nationaliste. Il s’agirait au contraire de réintroduire dans le prix des produits les externalités, ce qui constitue un point de passage obligé pour aller vers une concurrence réellement non faussée. Si le tee-shirt chinois produit dans des conditions sociales et environnementales désastreuses doit assumer le coût de ses externalités, les entreprises réfléchiront sans doute à deux fois avant de délocaliser. Ou bien elles seront contraintes d’améliorer les conditions de travail de leurs ouvriers et d’intégrer la question environnementale dans les pays où elles exercent. Le produit de cette taxe aux frontières pourrait être réinjecté dans le pays taxé afin de mener des projets respectueux de l’environnement et des conditions sociales des travailleurs, ce qui produirait alors un véritable double-dividende.
Le deuxième outil, qui limiterait la chasse perpétuelle aux nouveaux marchés rentables dans les pays du Sud, serait la mise en œuvre d’une taxe élevée sur le rapatriement des bénéfices des multinationales. Les firmes comme Suez, qui se goinfrent de la privatisation des services de distribution des eaux dans les pays en développement, changeraient sans doute de stratégie si les profits étaient lourdement taxés à l’occasion de leur retour en France. A la place du comportement prédateur des grands groupes privés, pourrait alors émerger en matière de services publics de nouvelles formes de coopération et de transfert de technologie dans le cadre d’accords économiques basés sur l’équité.
Prises simultanément et mises en œuvre de façon progressive, ces deux mesures amorceraient un double processus : une relocalisation de la production, et une véritable perspective de développement pour les pays du Sud qui pourraient à la fois se protéger du dumping ou des conquêtes de marchés par les entreprises occidentales et bénéficier de ressources financières nouvelles.
Dans la pratique, le plus difficile sera bien-sûr de créer un contexte permettant de passer de la théorie à l’action, en se soustrayant notamment aux foudres libre-échangistes de l’Union européenne. En France, aucun parti politique, aucune association politique n’ose assumer de telles revendications. Certains, à l’extrême gauche, préfèrent les mots d’ordre sympathiques – comme celui d’interdire les délocalisations – mais éludent la question du « comment ? ». Depuis longtemps, le Parti Socialiste, et par ricochet ses alliés électoraux, a abandonné l’idée d’une rupture réelle avec le néo-libéralisme par crainte d’avoir à affronter les lobbies. Au final, les citoyens ne voient plus où trouver des alternatives crédibles. Ils votent et s’engagent par défaut. Nous devons rapidement nous attacher à combler ce vide idéologique et à faire émerger un mouvement qui, en tapant là où ça fait mal, crée l’enthousiasme sans lequel nous ne pourrons rien changer.
Aurélien Bernier
18 décembre 2007
Commentaires
1. Christian le 22-12-2007 à 14:45:56
Bravo pour ton article. Je suis totalement d'accord avec des barrières douanières pour lutter contre le dumping social et environnemental.Par contre je me demande si la taxation des profits lors de leur rapatriement en France est réalisable. Il serait facile pour les multinationales de rapatrier leurs bénéfices dans un autre état voisin, le Luxembourg par exemple. De là ils pourraient soit réinvestir ces profits dans tout pays ou les dépenser en France puisqu'il y a libre circulation des capitaux à l'intérieur de l'UE. Ai-je tort?
Amicalement.
2. abernier le 22-12-2007 à 17:57:36 (site)
Une taxation élevée du rapatriement des bénéfices devrait être mise en place par le pays dans lequel sont réalisés les investissements. Or, actuellement, c'est tout le contraire. Beaucoup de pays du Sud qui cherchent à attirer les investissements étrangers assurent un rapatriment des bénéfices le plus avantageux possible.
Il suffit de faire une recherche rapide sur Internet pour trouver des éléments qui laissent songeur... Par exemple, le Sénégal a crée une agence pour courtiser les investisseurs (http://www.investinsenegal.com).
Dans la boîte à outils (FAQ), on trouve des questions/réponses du genre:
"Existe-il une limite au rapatriement des bénéfices ?"
"Non, il n’existe pas de limite au rapatriement des bénéfices engendrés par une entreprise au Sénégal."
La Banque Mondiale chiffrait à 55,3 milliards de dollars en 2001 le total des rapatriements de bénéfices des multinationales du Nord implantées au Sud, ce qui équivalait à l'ensemble de l'aide publique au développement accordée cette année là (http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=513). En 1990, le volume des rapatriements était de 17,5 milliards. Soit une multiplication par 3 en 11 ans!
Amicalement,
Aurélien

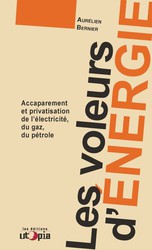
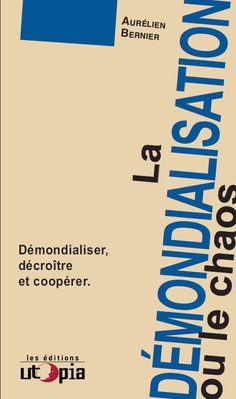
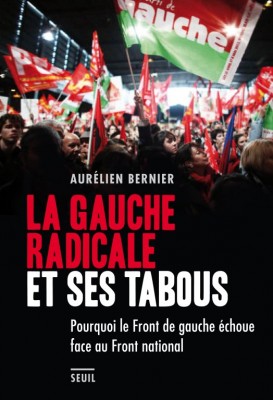



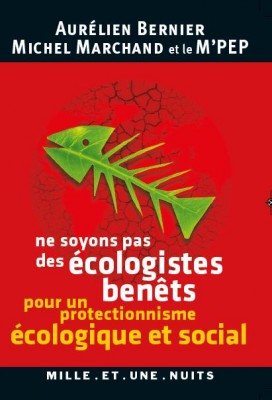
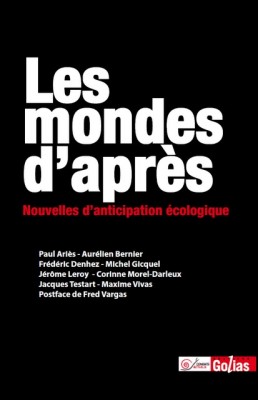

Commentaires