Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
Intervention au Contre-Grenelle de l'environnement
Intervention sur la finance carbone au deuxième Contre-Grenelle de l'environnement organisé à Lyon le 2 mai 2009 : écouter l'enregistrement



8ème Salon du livre d'Arras
Tous à Arras, le 1er mai, pour le 8ème Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale, en hommage à Fajardie.
Le programme complet est sur le site Colères du présent : http://www.coleresdupresent.com
Débat sur "Le climat, otage de la finance"
À 14h, salle polyvalente, Médiathèque d’Arras
Quand le néo-libéralisme envahit nos assiettes
Intervention à Compiègne le 26 mars 2009, sur le thème "Qu'avons-nous dans nos assiettes?" - Débat organisé par l'association AGORA 21. - Quelle nourriture mangeons-nous? Que trouvons-nous dans nos assiettes, dans nos réfrigérateurs, dans nos restaurants favoris, dans nos cantines? La réponse à ces questions simples peut rapidement faire peur : aliments transgéniques, plantes mutantes, fruits et légumes aux résidus de pesticides, viande piquée aux antibiotiques, quand elle n'est pas clonée... Une énumération qui n'est pas sans rappeler les usines Tricatel du film « L'aile ou la cuisse ».
Mais brosser ce tableau inquiétant de l'agriculture et de l'alimentation industrielle est moins important que de comprendre les raisons qui ont permis à ce modèle de s'imposer.
Deux fondamentaux expliquent cette déferlante de nouveautés culinaires toutes plus appétissantes les unes que les autres.
En premier lieu, elle est le produit d'une approche scientiste, qui véhicule une vision mécaniste du vivant. On pourrait croire qu'il s'agit là d'un débat réservé aux philosophes, mais il n'en est rien. Car si le vivant n'est qu'une mécanique et que l'on peut décrire dans les grandes lignes son fonctionnement, il devient envisageable de le modifier pour l' « améliorer » grâce à la technoscience. Ce raisonnement est bien plus utile qu'il n'y paraît, puisqu'il présente l'avantage indéniable pour les pouvoirs en place d'évacuer le débat politique. En effet, si la technoscience est en mesure de remédier à tous les maux – la malnutrition, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles... – , à quoi bon interroger notre modèle de développement? Le poids écrasant de ce scientisme a permis de détourner le mouvement d'alerte sociale et environnementale lancé par le Club de Rome dans les années 1970 pour consacrer le développement durable, qui n'envisage plus aucun changement radical et parie largement sur les progrès de la science pour sauver la planète. Contrairement à Albert Einstein, qui estimait qu'on ne peut résoudre les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés, les états répondent aux crises par la technoscience, mais aussi par la croissance, le marché, la concurrence libre et non faussée.
La technoscience est en effet intimement liée à cette seconde composante qui permet à l'industrie de l'agroalimentaire de commercialiser tout et n'importe quoi. Il s'agit bien-sûr du modèle économique, celui du capitalisme néolibéral. L'économiste Adam Smith a énoncé très tôt un principe implacable : baisser le coût de l’alimentation permet d’éviter d’augmenter les salaires – voire de les réduire – tout en laissant intact le pouvoir d’achat. Des produits alimentaires à bas prix satisfont les intérêts de l’ensemble du patronat. Il faut donc industrialiser l'agriculture pour abaisser les coûts de production. Voici la principale raison pour laquelle l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation a suivi le chemin tracé par le néolibéralisme
La mondialisation de la production et du commerce de produits alimentaires a connu trois grandes phases. L’arrivée des tracteurs équipés de moteurs à explosion au début du XXème siècle aux États-Unis constitue un premier bouleversement. En 1918, près de 30% des surfaces cultivées servaient à nourrir les animaux de trait, principalement avec de l’avoine. Quarante ans plus tard, ce chiffre était tombé à zéro. Cette évolution technologique considérable eût deux conséquences particulièrement importantes : premièrement, les terres utilisées pour l’autoconsommation étaient toujours cultivées, mais la récolte devait être vendue ; deuxièmement, les fermiers s’endettaient pour acheter leurs machines, et devaient donc dégager des revenus supplémentaires. Du fait de l’augmentation fulgurante de la productivité et des quantités mises sur le marché, les États-Unis affrontèrent dans les années 1920 et 1930 une crise des excédents agricoles, et recherchèrent de nouveaux marchés d’exportation. Pour conquérir ces marchés, ils misèrent très largement sur la culture du soja, qui permet non seulement d’accélérer la croissance du bétail, mais qui possède en outre l'avantage de fixer l’azote de l’air et de le restituer au sol, remplaçant ainsi la fumure disparue en même temps que les animaux de trait.
L'après guerre constitue également une phase de transformation importante du monde agricole. Il faut nourrir les populations meurtries par les conflits en produisant plus... et reconvertir les usines d’armes chimiques, qui trouveront une nouvelle activité dans la production d’intrans pour l’agriculture. L’Europe se place sous dépendance américaine en signant les accords de Dillon en contrepartie du plan Marshall, qui l’obligent à acheter ses oléo-protéagineux, base de l'alimentation du bétail, aux américains. Cette situation sera confortée à la fin du GATT par les accords de Blair-House, encore en vigueur aujourd’hui. L’Europe cultivera donc majoritairement des céréales, qu’elle exportera en partie, et nourrira son bétail avec du soja d’importation. Avec les crises pétrolières des années 1970, les produits agricoles européens sont une des principales monnaies d’échange utilisées pour acheter un pétrole cher. L’orientation productiviste s’en trouve évidemment renforcé.
La dernière phase de conversion de l’agriculture au modèle intensif et au libre-échange est le produit de la contre-révolution conservatrice initiée par Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 1980. Afin de redresser les taux de profit mis à mal par les acquis sociaux de l'après guerre, les grandes puissances financières se lancent dans une réorganisation à l’échelle planétaire de leurs modes de production. En effet, le développement des réseaux de transport et de communication permet d’envisager la mise en œuvre d’une stratégie connue maintenant sous le nom de mondialisation. Un formidable mouvement de dérégulation est orchestré pour permettre aux grandes entreprises de produire ce qu’elles veulent, comme elles le veulent, où elles le veulent, de vendre cette production partout sur la planète, et de rapatrier leurs bénéfices à moindre frais. Alors que la dette des pays du Sud sert à maintenir ces derniers sous contrôle, le salariat des pays développés est rediscipliné par le chômage, produit de la mondialisation. Cette réorganisation se fait au profit des États-Unis et dans une moindre mesure de l'Union européenne. L'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui régit à présent 98% du commerce mondial et englobe le marché des produits alimentaires, en est le principal vecteur. La percée de la Chine et de l'Inde, qui deviennent des acteurs majeurs du commerce international au début des années 2000, ne fera qu'accélérer ce mouvement.
L'un des meilleurs exemples permettant d'illustrer le fait que cette agriculture et cette alimentation industrielle sont avant tout le produit d'une construction politique est celui des OGM. A la fin des années 1970, des multinationales du tabac et de l'agroalimentaire s'emparent des progrès du génie génétique, qui leur offre de nouvelles perspectives. La condition indispensable est de détenir un droit : celui de breveter le vivant. Il sera obtenu de la Cour Suprême des États-Unis en 1980, puis de l'Union européenne en 1998. Dès lors, la porte est grande ouverte aux aliments transgéniques. Deuxième étape essentielle pour les firmes : éviter toute réglementation trop contraignante et donc trop coûteuse. Les États-Unis de Ronald Reagan adoptent en 1986 un principe, celui de l'équivalence en substance, qui établit qu'une plante transgénique ne sera pas évaluée différemment d'une plante traditionnelle. Les aliments transgéniques ne seront donc pas tracés. En Europe, la législation mise en place est plus hypocrite, mais tout aussi scandaleuse. Les OGM sont évalués « au cas par cas ». Mais dans la pratique, on demande aux multinationales de mener elles-mêmes les études attestant de l'innocuité de leurs produits...
En utilisant l'OMC, les pays producteurs d'OGM (États-Unis, Argentine, Canada, Brésil) exercent une pression terrible sur les pays importateur pour éviter que le commerce des OGM ne soit limité. Totalement acquise au libre-échange, la Commission européenne a systématiquement autorisé les demandes d'homologation d'OGM qui lui ont été présentées, qu'il s'agisse de mise en culture ou d'importations d'aliments. Quelques problèmes subsistent malgré tout. Ainsi, le développement de l'agriculture biologique et celui des OGM sont incompatibles. Mais là encore, l'Union européenne a trouvé la solution. Il suffit d'autoriser la présence d'OGM dans les produits biologiques, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2009, avec l'entrée en vigueur d'un règlement qui s'impose aux états membres.
Cet exemple édifiant montre, comme beaucoup d'autres, que nous trouvons dans nos assiettes le résultat d'un modèle économique. Pour réellement changer notre alimentation, au delà de la niche que représente aujourd'hui l'agriculture biologique ou « durable », il faut changer de modèle économique. Ceci suppose de remettre en cause le libre-échange. La re-localisation des activités, qu'elles soient agricoles ou industrielles, est en effet le seul moyen de restaurer un contrôle démocratique sur la production. Il faut maintenant dépasser la simple critique de cette idéologie qui produit toutes les crises possibles (financières, économiques, alimentaires, environnementales et sanitaires) et en tirer les conclusions qui s'imposent. Pour mettre en place d'autres politiques, basées sur la solidarité, la coopération, la protection de l'environnement et de la santé, il faut sortir du cadre de l'OMC et en finir avec l'euro-libéralisme. La désobéissance européenne, c'est à dire le refus d'appliquer des directives ou des règlements d'inspiration libérale est le premier point de passage obligé. Pour ne prendre qu'un exemple parmi bien d'autres, le seul moyen de répondre à la question des OGM en respectant la volonté des citoyens est de refuser l'application des directives et des règlements sur lesquels s'appuie la Commission européenne pour les imposer. Ce combat dépasse de loin les seules questions environnementales, sanitaires ou agricoles. Il s'agit ni plus ni moins de redonner à la souveraineté populaire un sens qu'elle n'aurait jamais du perdre.
Oser la désobéissance européenne
Une première version de cette tribune a été envoyée au journal l'Humanité, qui a extrait les premiers paragraphes pour les publier dans son édition du 21 février sous le titre « Nouvelle offensive pro-OGM ». L'idée principale de l'article, la désobéissance européenne, n'a donc malheureusement pas été reprise dans le quotidien. Voici le texte complet et actualisé. - Alors que tous les regards sont fixés sur la crise financière, il s'opère en coulisses une nouvelle offensive pro-OGM au niveau européen, menée tambour battant par la Commission. A quelques semaines du début des semis et à quelques mois du renouvellement du Parlement, cette dernière multiplie les pressions pour autoriser de nouvelles variétés de maïs génétiquement modifié, et surtout, pour empêcher des États comme l'Autriche, la Hongrie ou la France de s'opposer aux cultures transgéniques.
La première autorisation de mise en culture de plante génétiquement modifiée en Europe fut accordée fin 1997. Moins de deux ans plus tard, un moratoire européen a été instauré afin de compléter la législation communautaire. La publication en 2003 des règlements relatifs à la traçabilité et à l'étiquetage des produits alimentaires contenant des OGM mit fin à cette interdiction temporaire et permit d'éviter les foudres de l'Organisation mondiale du commerce. Dans l'intervalle, les surfaces d'OGM ont progressé insidieusement, mais lentement. Elles dépassaient à peine les 100 000 hectares en 2008, ce qui équivaut à moins de 1% de la production européenne de maïs et marque donc un véritable échec commercial.
En fait, le vent a tourné, et la situation n'est plus aussi favorable aux biotechnologies qu'à la fin des années 1990. Un pays comme l'Autriche a engagé très tôt une guérilla juridique pour interdire les OGM sur son territoire, entraînant dans son sillage d'autres États. Si les mesures nationales d'interdiction se sont heurtées au mur des institutions européennes, la Commission réclamant leur annulation de façon systématique, les arguments ont pourtant fait leur chemin. De plus en plus sceptiques, les États membres peuvent à présent réunir une majorité contre les positions pro-OGM de la Commission. Ainsi, le 2 mars, le Conseil des ministres de l'environnement rejetait par 282 voix sur 345 la demande de levée des moratoires hongrois et autrichiens sur le maïs MON810 de la firme Monsanto.
Si cette stratégie défensive a permis de gagner du temps, elle n'est pourtant pas viable sur le long terme. Après avoir simplifié les procédures d'autorisation de mise en culture d'OGM avec les règlements adoptés en 2003, après avoir introduit une tolérance de 0,9% d'OGM dans les produits biologiques en janvier 2009, la prochaine étape pour la Commission européenne devrait être une refonte des procédures d'évaluation de nature à évacuer tout débat politique, laissant à la science officielle le soin de trancher en faveur des biotechnologies.
Cette situation sur le cas emblématique des OGM est à rapprocher du scandale du traité de Lisbonne. Les deux affaires prouvent en effet que l'actuelle construction européenne vise tout simplement à abolir la démocratie pour préserver le libre-échange, principal outil du capitalisme néo-libéral. Le peuple peut bien dire « non » à un traité, il peut tout aussi bien refuser à plus de 80% une technologie écologiquement et socialement dangereuse, l'Union européenne ne déviera pas sa trajectoire d'un centimètre.
Puisque chaque texte qui sort du Parlement, chaque décret ou arrêté se doit absolument d'être euro-compatible, la conclusion est évidente. Un véritable gouvernement de Gauche arrivant au pouvoir en France n'aurait d'autre solution que de pratiquer la désobéissance européenne pour mettre en oeuvre ses politiques. Sur la seule question environnementale, la désobéissance s'impose dans de nombreux domaines. Il faut dénoncer la directive 2001/18 et le règlement 1829/2003 pour interdire les OGM dans les champs et dans l'alimentation. Il faut dénoncer la directive 2003/87 instaurant le système de Bourse du carbone pour démanteler le marché des droits à polluer et mener des politiques de lutte contre le changement climatique sérieuses. Il faut refuser d'abonder le budget de la Politique agricole commune tant que celle-ci financera une agriculture intensive détruisant la paysannerie et les écosystèmes. Il faut dénoncer les directives sur les marchés publics afin d'imposer la prise en compte de critères sociaux et environnementaux au lieu de se soumettre à la libre-concurrence, plus que jamais synonyme de dumping. Bien sûr, le raisonnement est tout aussi valable sur les questions sociales.
En 2005, la formidable campagne d'éducation populaire qui a accompagné le référendum sur le Traité constitutionnel européen a permis aux citoyens de prendre conscience d'une chose fondamentale : l'Europe qui se construit vise à déposséder les États de tout pouvoir d'opposition aux politiques libérales, qu'elle impose envers et contre tout. Cette Europe-là ne fera plus machine arrière. Les stratégies visant à changer le cours de la construction européenne ayant échoué, il s'agit maintenant de changer d'Europe, c'est à dire la reconstruire du sol au plafond. Changer d'Europe, c'est oser à nouveau dire « non ». Au quotidien. Chaque fois qu'une mesure de gauche se heurtera aux tables de loi de l'euro-libéralisme. Changer d'Europe commence par la désobéissance. Alors, soyons prêts à désobéir, et affirmons-le!
Commentaires
1. C Règle le 05-03-2009 à 09:18:58
D'accord sur l'ensemble mais où as tu vu "l'existence de stratégies visant à changer le cours de la construction européenne" ...
2. Baruch le 06-03-2009 à 09:49:24
Bravo, tout simplement!
La bataille idéologique de la finance carbone
Article paru dans le Sarkophage de janvier 2009

La crise financière tombe décidément bien mal. Au delà des gigantesques pertes qu'elle provoque et du chaos dans lequel elle plonge l'économie, elle marque aux yeux du public l'échec cuisant des politiques néo-libérales. Elle survient au moment même où la sphère de la finance s'apprêtait à gagner un terrain considérable, en particulier sur le plan idéologique. Comment? Grâce à l'alibi de la crise environnementale, en imposant le marché dérégulé à tous les étages où il n'était pas encore présent.
Pour la communauté internationale, le problème du changement climatique relève de la quadrature du cercle. La dérégulation bat son plein. Le libre-échange ne cesse de progresser et d'accomplir le transfert de pouvoir du politique vers les multinationales. Les mots d'ordre sont « moins d'Etat », « pas de taxe », « pas d'entrave au commerce ». L'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'emploie à supprimer toute barrière commerciale sans jamais se soucier de formation des prix, de dumping ou de cohérence dans les politiques monétaires.
Dans les années 70, les grandes puissances économiques avaient déjà apporté leur réponse à l'émergence des préoccupations environnementales dans le débat public. Il s'agissait bien-sûr du développement durable, qui évacuait toute réflexion sur le contenu de la croissance et confiait la résolution des problèmes à la techno-science et aux entreprises elles-mêmes, censées s'auto-responsabiliser. Avec le résultat que l'on sait, la dégradation des indicateurs environnementaux étant tout à fait proportionnelle au verdissement des rapports d'activité.
Malheureusement, la crise climatique est telle que ce maquillage ne suffit plus. Alors, que faire? Contraindre les grandes entreprises? Re-discipliner la finance mondiale? On voit mal comment, puisque tout est mis en oeuvre depuis des années pour leur laisser le champ libre. Il faut donc trouver une autre solution. Ce sera le marché des droits à polluer.
Souvent perçu et présenté comme quelque chose de très complexe, ce système est en fait assez simple. On attribue aux pollueurs des droits à émettre des gaz à effet de serre (des quotas), l'unité de base étant la tonne de dioxyde de carbone. On « titrise » en quelque sorte ces droits et l'on permet l'échange de ces titres sur un marché spécifique, appelé marché du carbone. Les entreprises doivent assurer un équilibre comptable en fin d'exercice entre leurs émissions réelles de polluants, inscrites au passif, et le volume de droits à polluer qu'elles détiennent, inscrites à l'actif.
Ce principe n'est pas seulement injuste du fait qu'il transforme en droit un état de fait (la pollution historique des industriels), il est également dangereux. Car évidemment, ce marché est très largement dérégulé. Il n'est pas réservé aux seules entreprises. Il est ouvert aux fonds spéculatifs, aux fonds de pensions, aux grandes banques d'affaires qui voient là une nouvelle opportunité d'engranger des profits faciles en achetant le quota le moins cher possible et en le revendant le plus cher possible.
Cette décision prise en l'absence de tout débat démocratique lors des négociations du protocole de Kyoto constitue une victoire des pouvoirs économiques. La crise écologique sera gérée par le marché. Donc, sans contrainte réglementaire forte. Kyoto n'est pas le succès environnemental que l'on a essayé de nous présenter, il s'agit d'un échec politique terrible. Cette percée du marché sur le terrain de l'écologie marque la fin de l'ère du développement durable et l'entrée dans l'écolo-libéralisme.
Qui plus est, ce marché du carbone ne se limite pas à la sphère privée. Premièrement, une partie importante des fonds d'investissement dédiés aux droits à polluer est constituée d'argent public. Le premier gestionnaire au monde de fonds carbone, la Banque mondiale, possède un portefeuille de deux milliards de dollars dont près de la moitié provient d'Etats. Deuxièmement, les quotas sont distribués par les pays aux gestionnaires des principales sources fixes d'émission. Ceci nécessite la création de Plans nationaux d'allocation des quotas (PNAQ), dans lesquels nous trouvons des collectivités. En France, par exemple, les Communautés Urbaines de Bordeaux, Lille et Brest, les centres hospitaliers de Poitiers, Angers, Dijon, Caen, Limoges, Nancy, Bordeaux, Saint-Etienne, les Universités de Dijon, Paris-Sud et Rennes I… possèdent des systèmes de chauffage dont la taille les place dans le PNAQ. Les responsables de ces établissements devront eux aussi « gérer leurs quotas » et, sans doute, en acheter en Bourse.
Mais ceci n'est qu'un début. D'une part, les « projets domestiques » vont étendre ce principe à des secteurs encore non couverts : transports, agriculture, bâtiment,... D'autre part, une réflexion est engagée sur des droits à polluer individuels. Comme son nom l’indique, il s'agit de délivrer à chaque citoyen un volume annuel de droits. Ces quotas seront crédités sur une carte à puce, et le « compte-CO2 » sera débité lors des achats d’énergie primaire : plein d’essence ou de la cuve de fuel, acquittement d’une facture d’électricité… Pour cette raison, le dispositif est souvent appelé « carte carbone », formule plus politiquement correcte que celle de « droits à polluer individuels ». En cas de déficit, les unités supplémentaires seront acquises sur des places boursières, bien évidemment. Autant dire qu’avec un tel dispositif, il vaut mieux être ingénieur à Barcelone et habiter près de son lieu de travail plutôt qu’être chômeur à Lille, propriétaire d’une vieille voiture et locataire d’une maison mal isolée…
L'acceptation de cette « carte carbone » qui nous sera bientôt présentée prendrait un sens terrible. Elle instituerait d'une part le droit à polluer payant pour les riches en lieu et place des réductions obligatoires qui devraient leur être réclamées, et elle reporterait l'essentiel du coût de la pollution sur les pauvres qui seraient, proportionnellement à leurs revenus, les plus touchés. Or, ces derniers ne disposent que d'étroites marges de manoeuvre dans leur vie quotidienne pour réduire leur impact écologique. Rappelons par exemple que la consommation d'énergie des ménages réagit très faiblement à la hausse du prix. Une augmentation de 10 % des tarifs génère une baisse de la consommation d'au maximum 1,5%. Le pauvre (voire même le « non-riche ») n'a malheureusement pas les moyens d'acheter une Smart chez son concessionnaire Mercedes favori ou d'investir dans le dernier modèle de chaudière économe.
Il est particulièrement inquiétant que des écologistes soutiennent cette aberration anti-sociale au motif qu'elles représenteraient un progrès pour l'environnement. Nous devons y voir l'une des grandes réussites des néo-libéraux, qui ont habilement fait l'éloge du comportement individuel pour mieux déconstruire les cadres collectifs. Le discours du « tous coupables », même s'il n'est pas fondamentalement faux, est amplifié jusqu'à la caricature pour masquer le recul du politique. Ainsi, on oublie de préciser que certains sont nettement plus coupables que d'autres, et que le rôle des pouvoirs publics est bien de garantir la justice sociale et environnementale. D'autre part, la somme des comportements individuels ne fera jamais une décision collective et démocratique, tout comme la somme des intérêts individuels n'aboutit pas naturellement à l'intérêt collectif.
La question du climat montre bien toute l'importance de la bataille qui se joue. Si l'on veut à ce point nous apprendre à fermer le robinet quand nous nous brossons les dents, c'est pour mieux nous détourner des véritables causes de la crise écologique et sociale : le néo-libéralisme et sa pierre angulaire, le libre-échange. L'éco-citoyenneté qu'on cherche à nous inculquer ressemble fort, au contraire, à un abandon progressifs de la citoyenneté. Renvoyés à nos comportements domestiques (moins prendre la voiture, éteindre la lumière, trier ses déchets...) et à nos choix de consommateurs (acheter bio, recyclé ou recyclable...), nous sommes soigneusement écartés des véritables décisions politiques. Finalement, la crise environnementale pose une question qui surplombe toutes les autres : alors que la mondialisation s'est attachée à la détruire, sommes-nous capables de reconquérir notre souveraineté populaire pour redevenir, sans préfixe, des citoyens à part entière ?

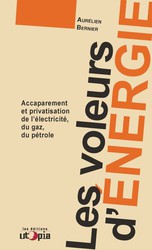
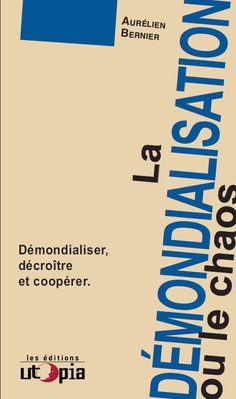
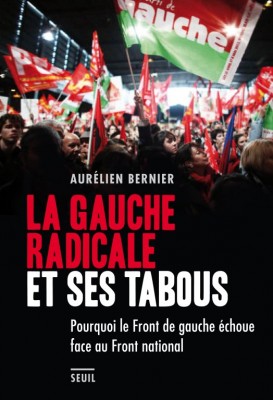



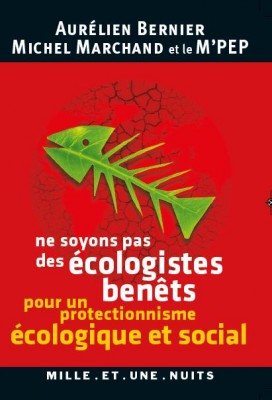
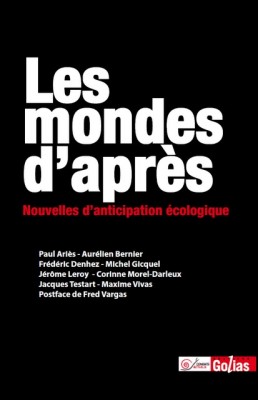


Commentaires