Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
L’étonnant Grenelle de Monsieur Sarkozy
Contrairement à ce que de nombreux commentateurs prédisaient, le Grenelle de l’environnement voulu par Nicolas Sarkozy au lendemain de son élection à la présidence de la République n’est pas qu’un coup médiatique. Si nous restons loin de la révolution écologique, il faut reconnaître que les décisions annoncées le 25 octobre ne sont pas toutes anodines et qu’aucun des précédents gouvernements n’avait été aussi loin en matière d’environnement. Le discours prononcé lors de la clôture du Grenelle reste évidemment ambigu sur plusieurs points, mais il révèle surtout une véritable stratégie sur la question environnementale.
Il est tout d’abord frappant de constater que de nombreuses actions reposent sur une intervention des pouvoirs publics : investissements en matière de transport visant à supprimer 3 millions de camions sur les routes, rénovation de logements anciens au rythme de 400 000 par an, plan d’éradication du saturnisme et nouvelle loi sur l’air… L’annonce de la réforme du code des marchés publics pour rendre obligatoire l’intégration de clauses environnementales est elle aussi caractéristique de ce volontarisme, et constitue une réelle avancée portant sur 14 à 15% du PIB national. Ce positionnement peut paraître contradictoire avec les politiques économiques que le gouvernement mène par ailleurs, où la casse des services publics et des solidarités nationales côtoie les suppressions de postes dans la fonction publique. Mais sans doute, Nicolas Sarkozy souhaite-t-il justement donner le change comme il l’a déjà fait par le passé. Les citoyens sont profondément inquiets d’une mondialisation galopant vers l’ultra libéralisme, synonyme de perte d’influence des Etats et du recul de l’idée de nation ? Le dirigeant UMP y répond de la façon la plus populiste qui soit, en intervenant sur l’immigration, la sécurité, la répression, avec le succès que l’on sait. Aujourd’hui, il semble décidé à prouver que la puissance publique peut également agir face à la crise environnementale, quitte à recourir à des mesures flirtant avec la préférence nationale, comme la taxation des camions étrangers empruntant les routes françaises. Nicolas Sarkozy joue ainsi aux prestidigitateurs en dépouillant l’Etat de sa main libérale et en le réarmant de son autre main, plus interventionniste. Le citoyen peu regardant risque bien de s’en contenter.
Deuxième enseignement du Grenelle : le pouvoir en place compte sur la question environnementale pour relancer la croissance et donner un avantage concurrentiel aux entreprises françaises. Le président de la République insiste sur cette notion de « business vert », et donne l’assurance qu’une éventuelle fiscalité écologique aura pour contrepartie une baisse de la fiscalité sur le travail. Ces incantations reprennent très fidèlement la ligne éditoriale du quotidien financier « La Tribune » du 24 octobre, qui fait l’éloge de la « croissance verte » tout au long de ses quarante pages[1]. Nicolas Sarkozy assure de la même manière que « Le développement de demain sera écologique ». Rien de surprenant, si ce n’est que dès la phrase suivante, le président annonce qu’il souhaite aussi lutter contre le dumping environnemental. Pour ce faire, il propose d’appliquer de nouveaux droits de douane aux produits d’importation provenant de pays qui ne respectent pas le Protocole de Kyoto. Cette mesure, qui figurait déjà dans le programme du candidat de l’UMP, réapparaît donc à l’issue du Grenelle. Elle s’inspire de la notion de « protectionnisme altruiste », défendue par certains courants altermondialistes. L’objectif recherché est d’aller vers une concurrence réellement non faussée en réintroduisant le coût des externalités sociales et environnementales dans le prix des produits d’importation par l’intermédiaire de barrières douanières. L’altruisme se caractérise par l’affectation du produit de cette taxe aux pays en développement, pour la réalisation de projets respectueux de l’environnement et bénéfiques pour les populations. Avec Nicolas Sarkozy, les considérations sociales et l’altruisme sont rangées au placard. Mais la taxation environnementale donne néanmoins un signal aux entreprises françaises : le gouvernement n’hésitera pas à s’inspirer de la schizophrénie américaine, en prônant la libre concurrence tout en pratiquant le protectionnisme autant qu’il sera possible de le faire.
Pour le président de la République, une telle initiative n’est évidemment pas envisageable à l’échelon national. Il s’engage donc à la défendre, comme d’autres, lors de la présidence française de l’Union européenne. La troisième grande caractéristique du discours de clôture du Grenelle est cette ambition affichée de transformer l’essai au niveau communautaire. Ce qui est valable pour les droits de douane l’est aussi pour le développement d’une agriculture et d’une pêche de haute qualité environnementale que M. Sarkozy assure vouloir promouvoir « dès le début de la présidence française de l'Union européenne ». Cette tactique est gagnante à tous les coups. En cas d’échec, ce sera la faute de Bruxelles, et en cas de réussite, le chef de l’Etat se targuera d’avoir influencé les politiques européennes dans le bon sens. Pourtant, Nicolas Sarkozy ne semble pas vouloir se contenter de déclarations. Le fait d’avoir confié à Corinne Lepage, une des seules écologistes de conviction dans les rangs de la droite, la mission de préparer la présidence française de l’Union sur la thématique environnementale est révélateur de ses ambitions. L’ancienne ministre n’étant pas femme à faire de la figuration, elle se battra sans aucun doute pour obtenir du concret. Ainsi, le président de la République agiterait un magnifique chiffon vert sous le nez des citoyens et poursuivrait tranquillement une stratégie libérale qui passe notamment par l’adoption du traité modificatif, résurgence vicieuse du Traité Constitutionnel Européen. Tel pourrait être le prix à payer d’un éventuel moratoire européen sur les OGM ou d’un verdissement de la Politique Agricole Commune.
Après six mois de mandat, il est donc clair que l’environnement est devenu une composante importante, et peut-être même essentielle, de la stratégie Sarkozy. L’efficacité de ce rideau de fumée passe par des actes concrets, qui iront sans doute dans le bon sens du point de vue de l’écologie, mais sans remettre en cause à aucun moment les politiques libérales. La totalité des commentaires à l’issue du Grenelle se sont focalisés sur les décisions, en oubliant de se poser la principale question, à savoir : pourquoi le seul candidat qui présentait un programme totalement vide en matière d’environnement s’est-il lancé dans un Grenelle une fois élu ? Peut-être parce qu’avec 10% de Gore et 90% de Thatcher, Nicolas Sarkozy a trouvé la recette de l’ultra libéralisme post-Kyoto.
Une autre évaluation des OGM

Article paru dans l'Humanité du 12 septembre 2007 - Monsieur Jean-Louis Borloo a annoncé le 23 août qu'il sortirait au moins du Grenelle de l'Environnement une loi sur les OGM. Dire quelle en sera la teneur est une autre affaire. D'un point de vue économique, nous savons ce que valent les OGM. Ce sont avant tout des plantes brevetées qui permettent aux semenciers d'imposer aux agriculteurs des « clauses d'utilisation » par l'intermédiaire de contrats de licence. Un système qui ressemble beaucoup à celui que chacun a déjà pu observer en installant un logiciel informatique breveté. Ce texte qui apparaît en début de procédure, dans une police qui en interdit définitivement la lecture à un myope et qui est accompagné d'une première option « j'accepte » et d'une seconde « je n'accepte pas », est une licence. Elle lie l'acheteur à la firme qui détient le brevet quand au respect d'un certain nombre de clauses, comme le non piratage, par exemple. Les brevets sur les OGM permettent la même chose. Une firme comme Monsanto, numéro un mondial des plantes transgéniques, fait signer au paysan un texte qui lui interdit de re-semer du grain issu de la future récolte d'OGM, et souvent, qui l'oblige à utiliser des produits de traitement...vendus par Monsanto elle-même. On comprend immédiatement tout l'intérêt d'une semence génétiquement modifiée par rapport à une semence conventionnelle. Pour les firmes bien-sûr.
Au niveau sanitaire et environnemental, les choses sont plus floues, puisqu'aucune évaluation sérieuse n'a jamais été réalisée sur les plantes transgéniques. Face à cette technologie nouvelle, les Etats-Unis ont fait le choix d'offrir purement et simplement l'économie de l'évaluation aux multinationales. Les OGM y sont utilisés depuis quinze ans comme des produits tout à fait ordinaires. L'Europe, elle, s'est montrée un peu moins généreuse. Mais beaucoup plus hypocrite. Pour homologuer une variété transgénique, une firme doit constituer un dossier et fournir des résultats d'études dont les grandes lignes sont indiquées dans les annexes de la directive européenne 2001/18. Ce dossier est alors généralement examiné par une commission d'experts dans l'état membre où la demande a été déposée (la Commission du Génie Biomoléculaire en France) et par une seconde au niveau communautaire, l'EFSA (European Food Safety Authority). Ces organismes délivrent des avis qui permettent ensuite à l'état, au Conseil ou à la Commission européenne de prendre la décision d'autoriser ou non la variété. Or, il n'a jamais été réclamé la moindre contre-expertise indépendante pour vérifier la fiabilité des résultats présentés par Monsanto et consorts, les experts se limitant à déclarer qu' « en l'état des connaissances scientifiques » et « compte-tenu des données fournies », les variétés transgéniques étudiées ne présentent aucun risque. Comme si une multinationale allait fournir un dossier pour homologation prouvant que son produit est dangereux ! Cette procédure est véritablement honteuse et constitue un déni du principe de précaution. C'est bien à elle qu'il faut s'attaquer en tout premier lieu.
Une loi responsable sur les OGM commencerait par considérer que, dans ces conditions, toutes les autorisations accordées jusqu'alors sont infondées d'un point de vue scientifique. Et donc par instaurer un moratoire. Ensuite, elle pourrait fixer une procédure très simple. Imaginons une agence dont les membres seraient recrutés pour leurs compétences, mais aussi leur indépendance vis-à-vis de l'industrie en général et du secteur de l'agrochimie en particulier. Appelons-la par exemple l'A.E.B., pour « Agence d'évaluation des biotechnologies ». Cette agence a en charge, comme son nom l'indique, l'évaluation des effets sanitaires et environnementaux des plantes transgéniques avant autorisation de mise en culture ou d'utilisation dans la chaine alimentaire. Elle met en place un protocole sérieux sur la base des annexes de la directive 2001/18 et calcule un coût moyen pour l'appliquer et en retirer des conclusions fiables. Il suffit ensuite de réclamer cette somme au pétitionnaire lors du dépôt de dossier. Ainsi, le coût de l'évaluation est bien à la charge de la firme, et non de la collectivité, mais elle est également réalisée en toute indépendance. Voilà une proposition qui serait de nature à changer radicalement le débat sur les OGM, en redonnant un peu de sérieux à la façon dont est gérée cette question de société.
Ce système ne présente qu'un risque. Que le tarif d'une véritable évaluation dissuade les firmes et que les salariés de cette A.E.B. s'ennuient ferme dans leurs bureaux. Dans ce cas, parions que le ministre de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables saura leur confier d'autres missions.
Développement durable : vingt ans de mystification
En ce qui concerne la question écologique, 2007 ne sera pas seulement l’année du grenelle convoqué par M. Nicolas Sarkozy à la rentrée et de la polémique qui l’accompagne. Elle est déjà l’occasion de commémorer un événement qu’on nous présente comme marquant dans l’histoire des politiques environnementales. Il y a tout juste vingt ans, une commission créée par l’Organisation des Nations Unies et baptisée « Commission mondiale sur l’environnement et le développement » publiait le « Rapport Brundtland », du nom de sa présidente norvégienne. Ce document restera connu comme celui qui allait populariser la notion de développement durable.
Quinze ans plus tôt, une association internationale composée de diverses personnalités de la société civile, le « Club de Rome », tirait une sonnette d’alarme qui semblait à l’époque totalement décalée. Alors que les chocs pétroliers n’avaient pas encore marqué la fin des trente glorieuses, ce cercle de réflexion s’adressait aux dirigeants des grandes puissances mondiales pour s’inquiéter de l’impact sur l’environnement d’une croissance effrénée.
Entre les deux, l’expression « développement durable », traduite de l’anglais « sustainable development », verra discrètement le jour dans les années 80. Lorsque la commission Bruntland décide de la reprendre à son compte, elle lui donne la définition suivante : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». On applaudit. Pour la première fois, on se soucie de transmettre aux prochaines générations suffisamment de ressources pour qu’elles puissent vivre correctement. Et on entérine quasiment aussitôt ce concept, lors de la Conférence des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement qui a lieu à Rio en 1992.
Il existe pourtant un léger problème avec la notion de développement durable telle que la formalise le Rapport Bruntland. Comme il n’est pas question pour les rédacteurs de remettre en cause la croissance telle que nous la connaissons, ces derniers posent comme axiome le principe d’une compensation des atteintes à l’environnement par des développements technologiques. La technologie guérira tout pour peu qu’on y mette les moyens. L’essentiel sera donc maintenant de découpler croissance et pollution (dit autrement, peu importe que la pollution augmente si elle augmente moins vite que la croissance)… et de le faire savoir à grand renfort de communication.
Comme chacun le sait, les entreprises s’engouffreront dans la brèche et seront promptes à se repeindre aux couleurs du développement durable à peu de frais. L’électricien EDF, par exemple, puisque le nucléaire permet de limiter les rejets directs de gaz à effet de serre. L’agrochimiste Monsanto, puisque certaines de leurs plantes transgéniques permettent d’éviter des épandages de pesticides… Et les cas similaires se multiplient à l’infini.
Comment une telle supercherie est-elle possible, alors que dans le même temps, tout le monde ou presque s’accorde sur le constat d’une dégradation alarmante de l’environnement ?
Le développement durable est censé s’intéresser aux interactions entre l’économique, le social et l’environnemental pour y rechercher un optimum.Or, les profits de l’économie néolibérale s’engraissent de spéculation sur les marchés financiers, mais aussi d’externalités. C'est-à-dire de la différence entre le coût global et le coût supporté par le producteur. Une paire de chaussure fabriquée en Chine coûtera une somme dérisoire à la multinationale qui la fabrique. Les ouvriers de l’usine sont traités et payés comme on le sait : mal. L’usine rejette des quantités importantes de polluants. L’activité génère des millions de kilomètres de transport. Tout ceci est au final payé par quelqu’un. Puisqu’il ne s’agit pas de la multinationale, il s’agit de la collectivité, qui dépollue ou se protège de la pollution, qui fournit plus ou moins d’aides sociales pour compenser la précarité des salariés, qui soigne les maladies professionnelles…
Une façon sérieuse de traiter le développement durable aurait été de poser la question suivante : comment réintégrer progressivement les externalités dans le coût de production ? Comment faire en sorte que le prix de la tonne de maïs cultivé en intensif contienne le coût social de l’irrigation, de l’épandage de pesticides, du séchage fortement consommateur d’énergies fossiles, etc. ?
La réponse est évidemment complexe, mais une chose est certaine. De tels changements ne pourront jamais s’effectuer en conservant des règles de libre échange qui mettent en concurrence des Etats aux législations sociales et environnementales totalement disparates. C’est pourquoi le développement durable restera une décoration offerte aux entreprises tant qu’il ne s’attaquera pas à la mondialisation néolibérale. Encourager les bonnes pratiques sur la base du volontariat sans rien changer aux lois du commerce international relève de l’arnaque pure et simple.
Il faudra donc prendre tôt ou tard des décisions éminemment politiques. Il faudra se rappeler qu’elles peuvent être de plusieurs natures : réglementaires, économiques, informationnelles, d’action publique directe... En jouant intelligemment de plusieurs instruments, un Etat peu tout à fait mettre en œuvre une réelle politique de développement durable. Le cadre réglementaire permet de définir de façon globale un niveau minimum de « performance » sociale et environnementale. Les outils économiques offrent les moyens, à l’intérieur de ce cadre, de favoriser le mieux-disant. Imaginons une liste d’indicateurs socio-environnementaux. Par la réglementation, on leur associe le minimum acceptable auquel chaque activité devra se conformer. Dans un deuxième temps, ils servent d’assiette au calcul d’une taxe, qui peut très bien toucher les activités résidentes de l’Etat en question (celles qui se déroulent sur son territoire), mais aussi les importations de produits et de services. Enfin, ces mêmes indicateurs peuvent servir de base au calcul des aides publiques aux entreprises qu’il serait enfin temps de conditionner plutôt que d’attribuer les yeux (presque) fermés.
A ce jour, de telles mesures sont évidemment difficiles à concevoir. Mais elles seraient un moyen crédible et efficace pour redonner du sens à cette notion déjà usagée de développement durable. Puisqu’aucun gouvernement ne semble avoir le courage de le faire, c'est aux citoyens de lancer le débat public sur ces questions.
Commentaires
1. JIPE le 20-06-2008 à 21:37:27
C'est un bon début de réflexion, un peu plus tard il serait nécessaire de se dire "Qu'il suffirait de ne plus en acheter pour que ça s'arrête" Le pouvoir est dans nos porte monnaie, et chaque achat est acte écologique ou criminel à moyen terme.
Avons nous besoin de politiciens pour acheter ? d'organisation ? la solidarité vis à vis de la planète suffit.
A l'origine du déséquilibre il y a aussi notre incapacité à aimer le travail de la terre originel et nourricière.
La sitation est de Coluche.
2. CA le 05-03-2010 à 19:11:34
Parmi les réflexions qui essayent d'interpréter la tendance, il faudrait peut-être regarder aussi celles qui analysent le développement durable comme le vecteur d'un nouveau processus de "gouvernementalisation", par exemple : http://yannickrumpala.wordpress.com/2008/11/16/le-gouvernement-du-changement-total/
Environnement : un levier de 300 milliards dans les mains des pouvoirs publics
Une question centrale devrait en théorie traverser ces trois groupes. Elle peut se résumer à : « comment réduire l’impact de la production et de la consommation sur l’environnement ? ». Et, bien évidemment, elle se double d’une seconde, qui est : « comment l’état peut-il favoriser cette mutation ? ».
Sans préjuger des résultats du Grenelle, il faut avouer que les premières pistes évoquées laissent sceptique.Le 6 juillet, M. Dominique Bussereau, ministre des transports, indique qu’il proposera au Grenelle l’instauration d’une taxe sur les poids lourds, étant entendu que cette dernière ne se superposerait pas aux péages autoroutiers. Si l’idée est tout à fait louable, l’élu UMP n’ira toutefois pas jusqu’à s’avancer sur un taux ni sur une affectation de son produit.
M. Nicolas Sarkozy s’est engagé quand à lui à faire passer la fiscalité écologique de 2,3% actuellement, à 5% du PIB en 2010. Mais, d’une part, cette notion de fiscalité écologique est particulièrement floue. Elle inclut par exemple la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers (TIPP), qui pèse à elle seule 24 milliards d’euros sur les 42,8 milliards qui entrent dans les calculs. D’autre part, le Président de la République ne dit pas qui devra assumer cette hausse de la fiscalité. S’il s’agit encore une fois d’augmenter la TIPP ou de taxer les consommations domestiques sans discernement, elle pénalisera lourdement les couches sociales les moins favorisées.
Il existerait pourtant un moyen efficace d’obtenir une amélioration notable et rapide de l’impact des modes de production et de consommation sur l’environnement tout en laissant intacte la sacro-sainte compétitivité des entreprises.
La commande publique, qui regroupe les achats de biens, de services et les prestations de travaux de l’Etat et des collectivités locales, se monte à 234 milliards d’euros par an. Les aides publiques aux entreprises sont évaluées à 65 milliards par an. La somme des deux se chiffre donc à près de 300 milliards d’euros et représente 17,5% du PIB national. 300 milliards d’euros d’argent public qui sont versés chaque année directement aux entreprises.
Imaginons deux mesures. La première consiste à rendre obligatoire l’intégration de considération environnementales dans la commande publique : exigence d’écolabels, utilisation de bois certifié, de matériaux recyclés, produits alimentaires issus d’une agriculture durable… La seconde est un conditionnement des aides publiques aux entreprises au respect de critères environnementaux. Ce qu’on appelle une éco-conditionnalité. Dans un cas comme dans l’autre, aucun obstacle technique n’empêche de les mettre en œuvre.
Pour la commande publique, il suffit de définir des cahiers des charges types (qui existent déjà en grande partie sous forme de préconisations et autres guides) et de s’assurer que les collectivités et que les services de l’Etat les intègrent à leurs marchés. Le Comité des Finances Locales, qui est l’organisme de contrôle pour la répartition des principaux concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, pourrait être renforcé et se voir attribuer une nouvelle fonction de contrôle de l’éco-responsabilité de leur commande publique. Le versement de la Dotation Globale de Fonctionnement (39 milliards d’euros en 2007), qui est une base de ressources régulières fournie par l’Etat aux collectivités locales, pourrait être conditionné au respect des principes d’éco-responsabilité dans les passations de marchés.
En matière d’aides publiques, un travail préalable est nécessaire. Ce domaine est en effet une véritable jungle dans laquelle aucun gouvernement ne s’est réellement s’aventuré. Le « Rapport sur les aides publiques aux entreprises » de décembre 2006, réalisé par l’Inspection générale des Finances, l’Inspection générale des Affaires sociales et l’Inspection générale de l’Administration estime que le nombre cumulé des dispositifs d’aides s’élève à au moins six mille ! Les rédacteurs proposent leur recensement, leur harmonisation et leur évaluation. Dès lors, on pourrait y ajouter sans difficulté le conditionnement à des pratiques éco-responsables, qui n’est qu’une affaire de volonté politique. M. Nicolas Sarkozy et les membres de son gouvernement l’auront-elle ? Rien n’est moins sûr. Durant son mandat de Premier Ministre, en janvier 2001, M. Lionel Jospin avait créé la Commission nationale des aides publiques aux entreprises (CNAPE). La mission de cet organisme était justement d’évaluer les impacts des aides publiques aux entreprises et de rendre au Parlement un rapport annuel sur le sujet. Elle fut abrogée par M. Jean-Pierre Raffarin le 20 décembre 2002, peu de temps après son arrivée au pouvoir.
La conjugaison de l’obligation d’éco-responsabilité dans la commande publique et de l’éco-conditionnalité des aides aurait pourtant un impact immédiat sur les pratiques des entreprises. Elle renforcerait en même temps la compétitivité des firmes européennes, qui sont plus en avance que leurs concurrentes sur la fabrication de produits respectueux de l’environnement. Alors, pourquoi ne pas en faire une double exigence de la société civile lors du Grenelle ? 300 milliards d’euros, c’est presque 500 fois le budget 2006 du ministère de l’écologie et du développement durable…
Commentaires
1. elodilili le 28-11-2007 à 14:58:05
le principe d'éco-conditionnalité existe en agriculture depuis un bon moment déjà, il commence juste à être contrôlé...
cela fait des années que l'agriculture se soucie de l'environnement et de l'impact écologique de son activité ...
Ca déjà, c'est en place ...
Quand l’écologie devient anti-sociale
En mars 2003, le groupe Metaleurop liquidait sa filiale Metaleurop-Nord, qui exploitait une fonderie de plomb et de zinc à Noyelles-Godault, près de Lens. L’opération laissait 830 ouvriers sur le carreau et abandonnait à la collectivité un des sites les plus pollués de France. Prétextant la concurrence chinoise, Metaleurop, qui voulait à tout prix fermer cette fonderie, entreprit de déstructurer peu à peu son activité. L’arrêt du site marqua la fin d’un véritable coulage, organisé pour mener à bien un projet de délocalisation. Comme pour venir à bout d’un service public, il est facile de rendre inefficace une structure privée, en décidant par exemple d’une logistique aberrante ou en laissant le matériel se dégrader. Dans le cas de Metaleurop-Nord, le groupe n’hésita pas non plus à jouer d’un argument terriblement efficace : celui de l’écologie. La pollution sur des dizaines de kilomètres carrés, dont les dirigeant s’étaient toujours parfaitement accommodés, allait devenir un argument pour justifier la fermeture. On fit venir des élus Verts, pour constater les dégâts. Ces derniers iront s’épancher dans les médias en assurant que, effectivement, le site de Noyelles-Godault devait stopper son activité. Les salariés en lutte s’en souviendront longtemps, et peu d’entre eux seront encore susceptibles de voter écologiste un jour. Pourtant, loin de constituer un triste souvenir du temps où les industriels ne parlaient pas encore de « croissance verte », cet exemple terrible en annonce bien d’autres.
Aujourd’hui, la pression environnementale s’est largement accrue avec la question du changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les entreprises européennes sont soumises depuis 2005 à un système de quotas de GES échangeables, souvent appelé « marché de droits à polluer ». Pour la période 2008-2012 durant laquelle s’appliquera le Protocole de Kyoto, le volume global de quotas délivré aux industriels par les gouvernements de l’Union européenne sera réduit par rapport à la période 2005-2007, et le principe du marché des GES s’étendra aux autres Etats signataires. Mais comme souvent, les firmes tentent par tous les moyens d’échapper à la contrainte, notamment grâce au « Mécanisme de Développement Propre » (MDP). En réalisant des projets faiblement émetteurs de GES dans les pays en développement, les industriels peuvent en effet obtenir des quotas supplémentaires utilisables en Europe. Les coûts d’investissement étant sensiblement plus faibles en Chine ou en Inde, chaque réduction des volumes de quotas délivrés par les pays occidentaux à leurs installations résidentes constituera donc une nouvelle incitation à délocaliser. En dépit des bonnes intentions climatiques, voici à quoi mène une mondialisation libérale qui organise le libre-échange entre des pays aux normes sociales et environnementales diamétralement opposées. C’est dans ce cadre que des groupes comme Arcelor-Mittal procèdent déjà à un chantage aux délocalisations à mots à peine couverts, réclamant à corps et à cris des quotas supplémentaires pour continuer à émettre des GES comme ils l’entendent.
Si les salariés occidentaux risquent de subir de plein fouet les conséquences d’une approche libérale de l’écologie, les citoyens ne seront pas épargnés, bien au contraire. D’une part, il est une question taboue qui mérite pourtant d’être posée : comment éviter que la contrainte environnementale, qui impose à la production des coûts supplémentaires, ne soit répercutée sur les prix de vente par les industriels ? De la même manière, comment éviter que les aides publiques aux particuliers ne génèrent une inflation aboutissant à faire de l’écologie un privilège réservé aux familles aisées ? Depuis des années, les aides publiques accordées aux particuliers pour l’accès aux énergies renouvelables n’ont fait que transiter par les ménages. A cause d’une augmentation ahurissante des marges sur le matériel, elles alimentent en fait les caisses des entreprises. Or, dans le « Grenelle » voulu par Nicolas Sarkozy, ces deux sujets sont encore une fois soigneusement éludés. Mais il y a encore plus grave. Par les temps qui courent, où le climat focalise toutes les attentions, le comble de l’écologie anti-sociale se retrouve dans un projet qui ressemble à une mauvaise blague : celui des quotas individuels de GES. Le gouvernement britannique envisage très sérieusement d’allouer un volume annuel de quotas à chaque citoyen majeur. Crédité sur une carte à puce, ce volume serait débité à chaque paiement d’une facture d’électricité, lors du remplissage d’une cuve de gaz ou de fuel, ou à chaque plein d’essence, proportionnellement aux émissions de GES générées. Si le compte est vidé avant la fin de l’année, le citoyen devra racheter des quotas supplémentaires en bourse. Ainsi, le smicard qui parcourt 40 kilomètres par jour dans une vieille voiture pour aller travailler et qui loue un logement mal isolé dans une région froide sera laminé au nom de la crise écologique. Ce qui n’empêche pas des environnementalistes comme Mme Dominique Voynet d’approuver ce système.
En réponse à des logiques aussi mortifères, il est urgent d’impulser un mouvement aux ambitions radicalement différentes. Sur la base d’une écologie sociale et solidaire, nous devons porter des propositions concrètes dont la mise en œuvre puisse se faire sans attendre. En premier lieu, l’Etat doit reprendre un contrôle réel sur les activités économiques afin d’orienter à la fois la production et la consommation. Au niveau national, cette re-politisation de l’économie passe d’abord par le conditionnement ferme des 65 milliards d’aides publiques accordées chaque année aux entreprises et par le renforcement des exigences sociales et environnementales dans la commande publique, qui pèse 234 milliards. Ensuite, le durcissement de la réglementation sur les émissions de polluants doit être défini comme une priorité absolue, en particulier pour les 200 sites qui pèsent 86% des quotas de GES délivrés en France. Il doit se doubler d’un système de taxation, en particulier d’une taxe carbone/énergie, qui produise dans des délais très courts de profondes mutations technologiques. Mais comme cette taxe seule possèdera toujours les deux mêmes effets pervers, à savoir la répercussion sur les prix et l’incitation aux délocalisations, il est indispensable d’aller plus loin. Il ne faut l’envisager qu’avec deux corollaires : la mise en place de nouveaux droits de douane sur la base de critères sociaux et environnementaux et une nouvelle politique d’administration des prix par les gouvernements. La première mesure, qui revient à remettre enfin en cause le libre-échange, est sans doute la seule à même de mettre un coup d’arrêt aux mouvements de délocalisation. La seconde serait un moyen d’éviter que les entreprises ne fassent payer le coût de la protection de l’environnement aux citoyens. Si nous n’ouvrons pas rapidement le débat public sur ces questions, nous risquons encore longtemps de laisser le champ libre à une écologie de plus en plus libérale.
Commentaires
2. yoyo le 28-11-2007 à 12:50:21 (site)
le thème de ton blog est vraiment très intéressant! j'ai hâte de lire la suite...
et bienvenue sur vef!
3. Djulian le 14-07-2008 à 12:40:37 (site)
"On fit venir des élus Verts, pour constater les dégâts. Ces derniers iront s’épancher dans les médias en assurant que, effectivement, le site de Noyelles-Godault devait stopper son activité."
Je serais assez curieux de savoir à quel passage média il est fait référence ici, la position des Verts ayant toujours porté sur le risque sanitaire que faisait courir l'activité du site sur les travailleurs et leur famille, mais nullement de se réjouir de la fermeture du site.

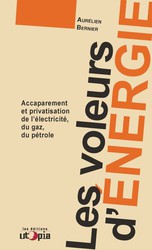
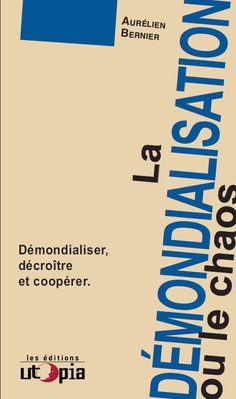
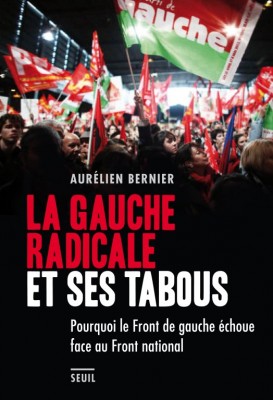



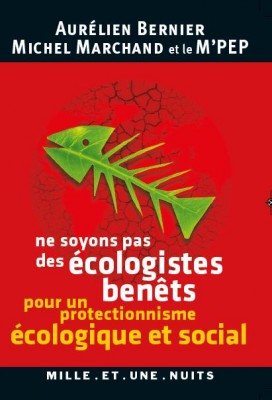
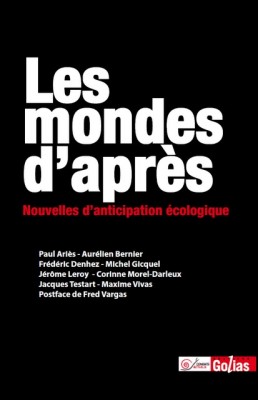

Commentaires
1. soussy le 14-09-2008 à 19:00:56
salut je suis presque nouvelle dans vefblog et svp visite mon blog et dite moi ton avis et je veux faire connaissance
2. soussy le 14-09-2008 à 19:01:01
salut je suis presque nouvelle dans vefblog et svp visite mon blog et dite moi ton avis et je veux faire connaissance