Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
Le mirage des emplois « verts »

Du ministère français chargé de l'environnement aux Nations Unies en passant par les grands partis politiques, chacun nous assure que la solution aux problèmes du chômage et de la dégradation de la planète se trouve dans l'emploi « vert ».
Pour l'Union européenne, le développement des énergies renouvelables créerait 410 000 postes d'ici 2020. Avec leur Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo annonçaient 535 000 emplois « créés ou maintenus » en dix ans. Des millions de postes sont promis par le Bureau international du travail si l'économie « verte » poursuit son envolée. Quant à Europe Ecologie, ils visent 10 millions d'emplois en 10 ans à l'échelle communautaire.
Les économistes chevronnés qui calculent ces chiffres ont sans doute longuement travaillé la question. On pourra néanmoins douter de leur objectivité à la lumière de quelques éléments, peut- être terre à terre, mais qui ont leur importance.
Tout d'abord, certains de ces emplois « verts » semblent presque aussi fictifs que ceux de la mairie de Paris à la grande époque du RPR. Dans la plupart des méthodologies, on y intègre des activités comme la gestion des déchets, le bâtiment (pour peu qu'on y pose quelques panneaux d'isolant thermique), ou l'entretien des espaces naturels. Quelle révolution écologique ! Surtout, on ne sait que rarement à la lecture des communiqués si les emplois promis sont de véritables créations ou des reconversions. Dans le détail des rapports, on comprend que ces « nouveaux » postes viennent le plus souvent en contrepoids de destructions qui, elles, ne font l'objet d'aucun chiffrage.
Il semble également que la couleur de l'emploi dissimule un peu facilement les conditions de travail. Pour l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), les 235 000 postes créés dans le bâtiment par le Grenelle correspondent en fait à 75 000 équivalents temps plein, et à des situations très précaires.
Aux Etats-Unis, un rapport de l’organisation Good jobs first dénonçait en 2009 la précarité dans le secteur des technologies « vertes », en particulier des salaires souvent inférieurs à ceux des autres industries. Constat d’autant plus scandaleux que les entreprises sont soutenues avec de l’argent public : dans une des centrales solaires américaines étudiée par les rapporteurs, le montant des aides publiques s’élève quand même à 326 000 dollars par emploi créé.
Mais pouvoirs publics et écologistes s'attardent rarement sur ce point, car ils possèdent un autre argument : les emplois « verts » ne seraient pas délocalisables puisqu'ils se situent soit dans la haute technologie (énergies nouvelles, véhicules peu polluants...) soit dans le service de proximité (bâtiment, entretien des espaces naturels...). Et c'est bien là que se trouve la principale erreur.
La mondialisation a montré qu'une production mise au point dans les pays occidentaux est rapidement expédiée dans les pays à bas coût de main d'oeuvre sitôt la technologie maîtrisée. La fabrication des biens « verts » n'échappe pas à la règle. Déjà, les productions de panneaux solaires ou d'éoliennes sont délocalisées pour augmenter les profits. Dès 2007, la Chine devenait le premier producteur mondial de modules photovoltaïques et fabriquait 56% des composants pour éoliennes vendus sur la planète, dans des conditions sociales et environnementales déplorables. Les pays émergeants se positionnent d'autant plus rapidement sur ce créneau que deux paramètres ont changé en quelques années. D'une part, ils ont à présent de sérieuses compétences dans des technologies de pointe. D'autre part, la Chine détient à elle seule plus de 95% des ressources en métaux rares qui, justement, sont indispensables pour produire des équipements « verts ». Or, le gouvernement n'autorise les firmes étrangères à accéder à ces gisements que si elles viennent produire en Chine.
Restent les emplois de proximité. Pour eux, l'Union européenne a imaginé la directive « services », adoptée en 2006, dont l'objectif assumé est de permettre la « libre circulation des services » entre le vingt-sept Etats. Autant dire la concurrence acharnée. Encore un peu de patience et les chantiers du Grenelle seront effectués à moindre coût par des salariés bulgares.
La morale de cette histoire saute aux yeux. La conversion écologique de la production ne peut se faire qu'après avoir relocalisé toute la production utile, qu'elle soit polluante ou « propre », pour la mettre sous contrôle démocratique. Il faut rompre avec l'Organisation mondiale du commerce et sa stratégie du libre-échange, désobéir aux orientations ultralibérales de l'Union européenne, et mettre en oeuvre le droit opposable à l'emploi. D'ici là, il serait bon que les partis, les syndicats ou les militants ne se laissent pas abuser par des stratégies qui confortent le capitalisme.
Article paru dans l'Humanité Dimanche du 16 septembre
La Vie
Brève parue dans l'édition du 23 septembre 2010
C'est le bon moment de lire Ne soyons pas des écologistes benêts, d'Aurélien Bernier et Michel Marchand (Mille et une nuits, 3,50 €). un petit livre qui pourfend "le capitalisme vert" et promeut "un protectionnisme écologique et social". Décapant.

Le localisme est décalé par rapport aux enjeux, le mondialisme est illusoire

Depuis le tournant ultralibéral des années 1970, les politiques environnementales suivent deux directions à première vue contradictoires : le localisme et le mondialisme. Le localisme, c’est faire croire que la planète sera sauvée par les actions de proximité qui, aussi intéressantes soient-elles, ne risquent pas de remettre en cause l’ordre économique. À l’inverse, le mondialisme consiste à enterrer les ruptures en les renvoyant à un niveau mondial. Pour pouvoir agir, il faudrait un accord international sur le climat, une Organisation mondiale de l’environnement ou une taxe globale sur les transports…
Si le localisme est totalement décalé par rapport aux enjeux, le mondialisme est, lui, totalement illusoire. Il n’existe aucune chance de voir émerger de consensus, alors que la mondialisation consiste justement à jouer du dumping écologique et social. L’Organisation mondiale du commerce ne permettra jamais que des clauses environnementales viennent entraver les échanges. Et Nicolas Sarkozy – ou d’autres – peut bien faire semblant de vouloir une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne puisque le traité communautaire l’interdit purement et simplement.
Mais cette double stratégie poursuit en fait un seul objectif : faire reculer l’État et la démocratie pour libérer les forces du marché. Les grandes puissances économiques ont mis le libre-échange au cœur de leur projet. Pour les multinationales, le libre-échange, c’est pouvoir s’implanter n’importe où sur la planète, produire ce qu’elles veulent dans les pires conditions, vendre cette production sans entrave et maximiser leurs profits. Cerise sur le gâteau, le libre-échange permet de tirer vers le bas les normes dans les pays riches par la mise en concurrence de tous contre tous. Les seules « solutions » environnementales tolérées doivent être compatibles avec ce système, à l’image du scandaleux marché des droits à polluer. Et pour que cette machine bien rodée fonctionne, il faut abattre l’État protecteur, régulateur, redistributeur, cet État qui pourrait mettre en œuvre des politiques différentes. Le bilan du capitalisme néolibéral est sans appel. Ces dix dernières années, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté d’au moins 25 %. Tous les indicateurs écologiques sont au rouge et les indicateurs sociaux suivent le même chemin. Le sommet de Copenhague fut bien l’échec cuisant auquel nous devions nous attendre, le grand absent des débats ayant été, comme d’habitude, le commerce international. Nous devons maintenant tirer deux conclusions de ce désastre. La première est que le libre-échange doit être combattu en priorité. Il faut réguler le commerce international, en limitant ou en interdisant certaines productions et en taxant les importations en fonction de critères sociaux et environnementaux. Mais comme l’objectif n’est pas de pénaliser les populations des pays pauvres, cette mesure doit s’accompagner de mécanismes forts de solidarité internationale : redistribution du produit de cette taxe aux frontières, annulation de la dette des pays du Sud et reconnaissance de la dette écologique, création d’un statut de réfugié climatique. Briser la spirale du libre-échange, c’est casser le chantage aux délocalisations. C’est se donner les moyens de relocaliser l’économie avec pour objectif le plein-emploi et le contrôle démocratique de la production. Le second enseignement est qu’il faut arrêter d’attendre un accord international illusoire et rompre dès maintenant avec le capitalisme néolibéral. Si la gauche arrivait au pouvoir dans un pays comme la France, elle devrait prendre des mesures unilatérales qui, loin de l’isoler, donneraient au contraire des idées et des espoirs aux autres peuples. Elle devrait dénoncer les règles de l’OMC et pratiquer la désobéissance européenne, c’est-à-dire construire un droit national juste, même si ce droit est contraire au droit européen. Comme interdire une fois pour toutes les OGM, stopper l’agriculture productiviste, taxer les profits des grandes firmes pour financer des politiques ambitieuses. La seule « avancée » de Copenhague est d’avoir montré que nous n’avons plus d’autre choix.
Aurélien Bernier
Auteur de le Climat, otage de la finance (2008, Mille et une nuits) et Ne soyons pas des écologistes benêts (à paraître).
Article paru dans l'Humanité du 10 avril 2010
L'Humanité
(1) Éditions Mille et Une Nuits, 3,50 euros.

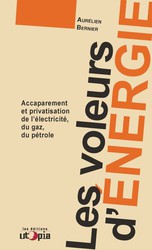
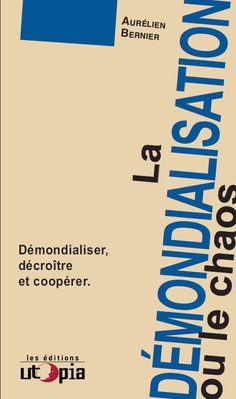
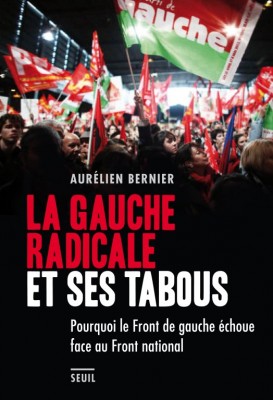



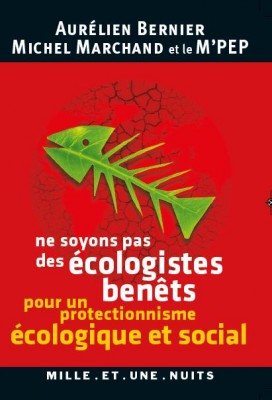
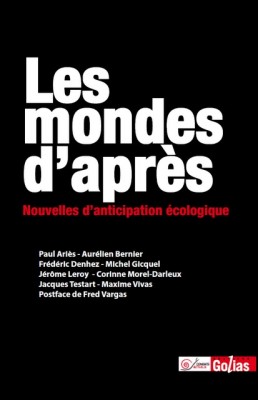



Commentaires