
Après le rejet, en France et aux Pays-Bas, du Traité constitutionnel de 2005 et l'adoption dans la foulée de son clone, le Traité de Lisbonne, on pouvait penser que l'Union européenne avait atteint le fond du trou libéral. Qu'après avoir écarté d'un revers de main l'expression démocratique de ses citoyens pour imposer le libre échange et la libre concurrence, elle ne pouvait tomber plus bas. Erreur : après avoir touché le fond, elle s'est mise à creuser !
Ce dont il est question aujourd'hui avec le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), c'est de l'abandon pur et simple du peu qu'il reste de souveraineté populaire dans les Etats membres au profit de Bruxelles.
Pour l'Union européenne, la crise gravissime que la zone euro traverse actuellement n'est pas due à la spéculation des marchés financiers.
Ni au renflouement des banques par les pouvoirs publics.
Ni à l'absence de régulation du commerce international.
Ni à une monnaie unique viscéralement nuisible pour la plupart des Etats, à l'exception de l'Allemagne.
Pas plus qu'à des politiques libérales qui interdisent d'augmenter les recettes en taxant les richesses...
Non, pour l'Union européenne, la crise est due à la mauvaise gestion des Etats.
Des Etats qui dépensent trop en finançant des services publics, des prestations sociales, des hôpitaux ou des enseignements de qualité...
Il faut donc réduire ces dépenses somptuaires, encadrer les déficits et stopper l'endettement.
Pour ce faire, 25 Etats de l'Union européenne, parmi lesquels figurent tous les pays de la zone euro, ont adopté en mars 2012 le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG).
Ce texte n'apporte pas grand chose de nouveau, sur le fond, aux politiques communautaires, mais procède à un renforcement des règles d'orthodoxie budgétaire.
Dans les considérants, il est rappelé que « [les] États membres de l'Union européenne doivent s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union dans le cadre de l'union économique ».
Ces objectifs, nous les connaissons très bien.
Il s'agit d'aller toujours plus loin vers le libre échange et la libre concurrence d'une part, et vers la rigueur budgétaire et monétaire d'autre part.
Revenons quelques instants sur ces principes ultralibéraux, ces « règles d'or », que nous subissons déjà depuis plus de trente ans.
Premier principe : la circulation des biens, des services, des capitaux doit être « libre », c'est à dire débarrassée de toute entrave réglementaire, de toute taxation ou limitation par des quotas ; la concurrence entre Etats et à l'intérieur des Etats doit être « non faussée ».
Dès ses premiers pas, la « construction européenne » fut imaginée comme la construction d'un espace de libre échange.
Pourquoi ?
Parce qu'à la sortie de la Seconde guerre mondiale, les Etats-Unis craignent une crise de la surproduction liée à la reconversion de leur industrie de guerre.
Ils doivent donc conquérir de nouveaux marchés, et l'Europe de l'Ouest dévastée par les conflits représente un débouché rêvé.
En faisant de l'Europe de l'Ouest une zone de libre échange ouverte aux produits américains et, bien-sûr, une zone d'influence politique, les Etats-Unis font coup double : ils consolident leur économie et contiennent la progression des idées communistes.
Pour le patronat d'Europe de l'Ouest, c'est une période de rénovation du capitalisme qui s'ouvre avec l'adoption du libre échange et de la libre concurrence.
Les grands dirigeants comprennent assez vite que, grâce au libre échange, il sera encore plus facile de mettre au pas les salariés en invoquant la « contrainte extérieure » puis le risque de délocalisations.
Il sera d'autant plus facile de maintenir des bas salaires, des conditions de travail « flexibles », un taux de chômage élevé, que les salariés craindront la concurrence asiatique ou des pays de l'Est.
Le libre échange est donc une arme redoutable contre les peuples.
Mais le second principe fondateur de l'Europe libérale, le monétarisme, est tout aussi dangereux.
Selon ce principe, il faut supprimer l'intervention de l'Etat en matière de politiques monétaires, et se plier à des règles automatiques.
Notamment, il faut limiter l'inflation (la hausse des prix et des salaires) en limitant la création monétaire.
D'autre part, en maintenant dans la mesure du possible des taux d'intérêt élevés pour les Etats et les entreprises (c'est à dire en rendant l'emprunt coûteux), on oriente les investissements vers des activités rapidement rentables.
Ainsi, on fait le bonheur des détenteurs de capitaux, qui peuvent prêter à des conditions très lucratives et dont la rente n'est pas rognée par l'inflation.
Ces politiques monétaires voulues par les ultralibéraux renforcent l'effet destructeur du libre échange.
L'euro fort pénalise les exportations mais favorise l'achat d'entreprises ou de pièces détachées hors zone euro.
La boucle est bouclée : Renault ou Peugeot pourront d'autant plus facilement acheter des unités de production ou des pièces au Brésil ou en Roumanie que le cours de l'euro est élevé, et les règles de libre échange leur permettront d'écouler sans entrave leur production délocalisée.
La fermeture de PSA ou le saccage de la sous-traitance automobile ont une seule et même cause : les politiques commerciales et monétaires de l'Union européenne.
Un grand coup d'accélérateur a été donné dans le milieu des années 1980.
A partir de 1985, l'horrible Jacques Delors prépare l'Acte unique européen, qui lui vaudra les félicitations des grandes multinationales ou de Margaret Thatcher.
Ce traité organise la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne, autour du libre échange et prévoit l'adoption de centaines de directives de libéralisation et de dérégulation.
L'Acte unique est la source du flot de directives qui nous submerge en permanence et contre lesquelles nous devons lutter au quotidien : directive postale, directive services, directive sur l'énergie, directive ferroviaire, etc.
Un second coup d'accélérateur a lieu en 1992, avec l'adoption du Traité de Maastricht qui prépare la monnaie unique et introduit déjà la rigueur monétaire et budgétaire : les candidats à l'euro doivent respecter des « critères de convergence », parmi lesquels la stabilité des prix (et des salaires), un déficit maximum de 3 % du PIB et un endettement public maximum de 60 % du PIB.
Le TSCG contre lequel nous nous mobilisons aujourd'hui donne un tour de vis supplémentaire.
Ce texte réaffirme l'exigence d'équilibre budgétaire et de maîtrise de la dette.
Mais il va plus loin, en estimant que le déficit structurel d'un Etat (c'est à dire le déficit corrigé des variations de la conjoncture), ne doit pas dépasser 0,5 % de son PIB.
Surtout, il fixe des règles de retour dans le droit chemin libéral et des sanctions automatiques pour les Etats déviants.
En France, ramener le déficit dans la limite autorisée des 0,5 % signifie procéder à 87 milliards d'économies par an.
Ramener l'endettement à 60 % du PIB suppose de « trouver » 26 milliards supplémentaires.
Ce sont donc 113 milliards de dépenses qui doivent être coupées pour satisfaire aux critères de Bruxelles.
On ne parle même pas des saignées correspondantes en Grèce, en Espagne, au Portugal ou en Italie !
Pour atteindre ce niveau délirant d'austérité, un Etat doit présenter un programme de réformes contraignantes à la Commission et au Conseil.
Ses projets d'émission de la dette doivent également obtenir l'aval de Bruxelles.
En cas de non respect, les sanctions sont quasi automatiques : il faudrait en effet qu'une majorité d'Etats signataires (72 % des voix du Conseil) s'y oppose pour que les sanctions financières ne soient pas appliquées.
Et si le pays est sanctionné, la Commission pourra intervenir directement dans l'élaboration du budget d'un Etat pour demander des « réformes structurelles », c'est à dire des politiques de rigueur.
Soyons clair : ce Traité est une arme de destruction massive de la souveraineté populaire et de la démocratie représentative.
Les législateurs passaient déjà le plus clair de leur temps à transcrire des directives européennes ou à mettre le droit national en conformité avec le droit européen.
Avec « l'indépendance » des banques centrales, les élus du peuple s'étaient vus ôter des mains l'outil essentiel des politiques monétaires.
Avec le TSCG, les gouvernements seront directement placés sous la tutelle budgétaire de Bruxelles, elle-même au service des marchés financiers et des multinationales.
Lorsqu'il s'agissait de pays pauvres soumis au diktat du Fonds monétaire international (FMI), les mesures de correction identiques à celles prévues dans le TSCG portaient un nom : des Plans d'ajustement structurels.
Et bien aujourd'hui, c'est la France et les autres pays récalcitrants qui sont soumis à des Plans d'ajustement structurels qui n'avouent pas leur nom.
C'est pourquoi nous devons lancer une mobilisation éclair et massive contre le TSCG.
Les parlementaires doivent rejeter ce texte ou bien le soumettre à référendum, car il serait intolérable qu'une telle régression soit validée sans que les citoyens soient consultés.
Cette mobilisation contre le TSCG sera difficile, mais elle peut être victorieuse, comme le fut en 2005 la campagne pour le « non » au Traité constitutionnel.
Pour autant, stopper le TSCG n'est pas suffisant.
La question européenne est la grande question politique du moment et des années qui viennent.
Or, pour espérer gouverner à gauche, nous devons porter un programme clair et radical de rupture avec l'eurolibéralisme.
Nous devons mettre fin à plus de trente années de soumission
Nous devons être prêts à désobéir à l'Union européenne, c'est à dire à sortir de son carcan juridique qui empêche toute politique de gauche.
Ceci n'est possible qu'en réformant la Constitution, pour restaurer la primauté du droit national sur le droit européen.
Alors, nous pourrons rompre avec le libre échange, les privatisations, la destruction programmée de l'industrie des pays européens au profit des multinationales qui exploitent la main d'oeuvre sous payée des pays émergents.
Mais il faut également rompre avec le monétarisme et l'orthodoxie budgétaire.
Est-ce possible en restant dans la zone euro, sous la coupe de la Banque centrale européenne ?
Je suis persuadé que non.
Nous devons poursuivre le débat sur la monnaie unique, à l'intérieur du Front de gauche et avec la population, car il est tout à fait possible de coopérer, de bâtir de nouvelles solidarités, de poser les bases d'un nouvel internationalisme en retournant à des monnaies nationales et en rendant le pouvoir financier, commercial et monétaire aux Etats.
C'est non seulement possible, mais c'est indispensable.
Aujourd'hui, l'urgence est de faire échec au TSCG, et nous devons y consacrer tous les moyens disponibles, sans hésiter.
Mais demain, en juin 2014, nous aurons à voter pour élire les députés européens.
Nous pouvons faire de ces échéances un véritable référendum contre l'eurolibéralisme, et nous pouvons gagner ce référendum.
Les citoyens y sont prêts.
Un sondage Ifop publié hier dans Le Figaro donne des résultats sans appel.
Les conséquences de la monnaie unique sont jugées « nettement négatives sur la compétitivité de l'économie française » par 61 % des sondés.
63 % pensent que l'euro est mauvais pour l'emploi et 89 % qu'il provoque une hausse des prix.
60 % rejettent une intégration européenne renforcée avec une politique économique et budgétaire unique.
Enfin, si le référendum sur Maastricht avait lieu à nouveau, 64 % des personnes interrogées voteraient « non ».
Les Français sont donc bien moins aveugles que leurs dirigeants !
Si nous ne voulons pas laisser au Front national le bénéfice de cette situation, nous devons présenter aux électeurs un véritable projet de rupture avec l'eurolibéralisme, avec le libre échange, avec l'orthodoxie monétaire.
Alors, nous ne serons plus seulement sur la défensive.
Nous ne serons plus cantonnés dans l'opposition à des politiques toujours plus libérales, pour éviter que les derniers vestiges de nos acquis sociaux, ceux du Conseil national de la Résistance, soient définitivement balayés.
Nous pourrons enfin reprendre notre destin en main et avancer vers ce qui nous réunit : la sortie du capitalisme et la mise en place d'un socialisme du XXIè siècle.

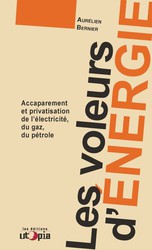
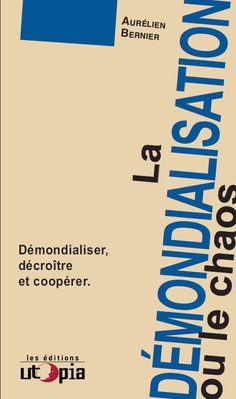
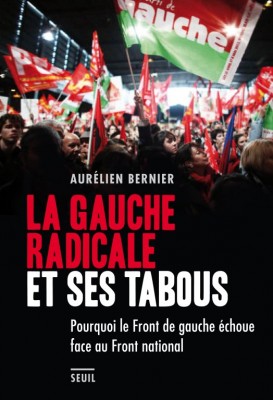



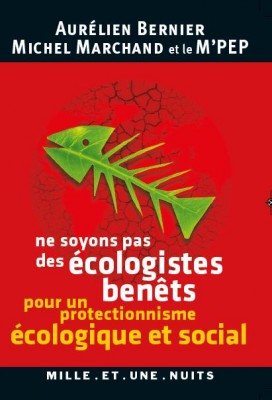
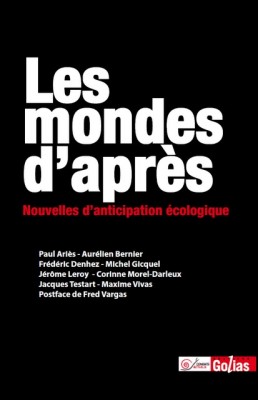





Commentaires