Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
Sortie de "La démondialisation ou le chaos"
Comment ne pas voir que toutes les « crises » économiques, environnementales et démocratiques, ainsi que les dérives identitaires – du terrorisme à l’extrême droite –, ne sont que le résultat d’un seul et même processus : celui de la mondialisation et de la financiarisation de l’économie, provoquant un désastre économique, social, culturel et verrouillant l’ordre international ?
Partout dans le monde, les luttes sociales se heurtent au libre échange, au chantage aux délocalisations et à la fuite de capitaux. En l’absence de perspective de sortie « par la gauche » de cet engrenage, les nombreuses victimes de cette mondialisation se résignent ou choisissent la stratégie du pire.
Pour ne pas sombrer petit à petit dans le chaos et redonner de l’espoir, il faut démondialiser. Non pas pour défendre un capitalisme national, mais pour mettre en œuvre un projet politique de rupture qui repose sur trois piliers : la démondialisation pour rompre avec le capitalisme, la décroissance pour répondre aux crises environnementales et la coopération internationale pour renouer avec l’idée de justice sociale au sens le plus global.
Ce livre contribue à engager une nouvelle bataille des idées pour lutter contre l’extrême droite et le terrorisme, mais aussi pour combattre le fatalisme qui conduit à la soumission, à l’abstention et au désengagement.
Il vise également à dépasser le débat opposant à gauche nation et internationalisme.
Aurélien Bernier est essayiste et conférencier. Il collabore régulièrement au Monde diplomatique.
Dernières publications : Désobéissons à l’Union européenne (Mille et une nuits, 2011) ; Comment la mondialisation a tué l’écologie (Mille et une nuits, 2012) ; La gauche radicale et ses tabous (Seuil, 2014)
Aurélien Bernier, La Démondialisation ou le chaos, aux Editions Utopia, Paris, octobre 2016, 160 pages, 10 euros.
En librairie le 17 octobre
Penser en dehors du cadre imposé
Article paru dans le N°34 de Causeur, Avril 2016 sous le titre "Une seule solution : la démondialisation".
Le contenu du projet de loi El Khomri ne devrait étonner personne. Ce texte s'inscrit dans un long et vaste mouvement de dérégulation du marché du travail entamé dès la seconde moitié des années 1970, lorsque les premiers effets de la concurrence internationale – que l'on appelait alors la « contrainte extérieure » – commencèrent à toucher l'Europe de l'Ouest. Ressassé depuis une quarantaine d'années, l'argument est toujours le même : pour gagner en compétitivité, il faut flexibiliser le marché du travail. C'est à dire accéder aux demandes du grand patronat, même si les précédentes mesures en ce sens n'ont produit aucun résultat sur l'emploi. Peu importe, puisque la classe dirigeante considère que si le libéralisme ne fonctionne pas, c'est parce que nous ne sommes pas allés assez lois dans l'ultralibéralisme.
Le préambule du projet porté par le gouvernement de M. Manuel Valls estime que « nos modes de régulation des relations du travail, hérités de l’ère industrielle, ont été réformés à de multiples reprises, mais sans jamais être véritablement refondés. » Or, « la mondialisation, la part croissante des services dans notre économie » ont introduit de profonds changements. Surtout, d'après ses rédacteurs, « le numérique bouleverse un à un tous les secteurs économiques et change la vie quotidienne au travail. » Ce serait donc l'informatisation de la société, le développement du commerce en ligne, l'apparition d'Uber ou de Airbnb, qui justifieraient de réduire encore le périmètre du droit du travail pour gagner en compétitivité.
Le projet de loi El Khomri reprend à son compte, presque mot pour mot, l'analyse de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Pour ces inconditionnels du libéralisme, « la mondialisation 2.0 accentue la fragmentation du processus de production, dont les étapes intermédiaires sont réalisées par des fournisseurs différents, avec une interconnexion des emplois par-delà les frontières via les chaînes de valeur mondiales »[1]. Rien de nouveau, donc, si ce n'est que le développement des réseaux accélère encore la mondialisation et rend la concurrence internationale toujours plus violente.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que face à cette réalité – la mondialisation – deux réponses sont possibles. La première consiste à accepter la concurrence internationale comme on accepte le fait que la Terre soit ronde, qu'elle tourne et qu'il y ait des saisons. Si la concurrence est un phénomène inévitable, alors, effectivement, il faut chercher à gagner en compétitivité. Il faut tenter de rivaliser avec le modèle chinois ou indien, qui fait l'économie de quasiment toutes les protections sociales et environnementales, qui ne connaît pour ainsi dire pas la grève. Il faut être concurrentiel face aux travail détaché permis, sans surprise, par l'ultralibérale Union européenne. Pendant que s'écrivait le projet de loi El-Khomri, l'Urssaf et l'Inspection du travail contrôlaient une société hongroise qui intervenait sur un chantier photovoltaïque en Gironde : rémunérés huit heures pour une durée effective de travail de 11 heures 30, six jours sur sept, les salariés détachés touchaient 2,22 euros par heure[2]. Voilà vers quoi nous mène, lentement mais sûrement, la « refondation » du travail dans un contexte de mondialisation.
La deuxième façon de réagir est au contraire de refuser la concurrence internationale, d'en sortir. J'ai conscience du caractère quasi-inconcevable de cette affirmation. On nous a tellement présenté cette concurrence comme un phénomène naturel que nous l'avons intégré à notre imaginaire social. Pourtant, aucune loi naturelle ne dit que nous devons sacrifier nos emplois pour acheter moins cher des produits issus de délocalisations. Aucun principe physique ne conduit à la destruction des acquis sociaux en Europe, alors même que les acquis sociaux pour les classes populaires ne progressent pas d'un iota dans les pays à bas coût de main d’œuvre. Depuis les années 1970, nos dirigeants successifs, de droite ou prétendument socialistes, ont fait le choix de la mondialisation. Mais ce choix, nous pouvons le défaire.
Comment ? En instaurant du protectionnisme, bien-sûr, de façon à produire localement ce qui peut l'être. En sortant de l'euro, cette monnaie unique surévaluée, conçue dans la plus pure logique libérale, et qui nous place sous la tutelle des marchés financiers. En sortant de l'Union européenne qui, directive après directive, impose les dogmes ultralibéraux et interdit aux États de créer du droit qui ne serait pas compatible avec eux. Cette rupture avec l'ordre économique porte un nom : la démondialisation. Pas celle, en plastique, d'Arnaud Montebourg, qui fait semblant de croire qu'un « protectionnisme européen » est possible, mais celle du philosophe altermondialiste Walden Bello, qui a toujours pensé le protectionnisme national comme une mesure progressiste, de gauche, comme un moyen de rompre avec la domination des grandes entreprises et de la finance.
Cette démondialisation de gauche n'a rien à voir avec son pendant de droite. Il ne s'agit pas de restaurer la compétitivité de la France dans une concurrence internationale inchangée. Il ne s'agit pas de renouer avec les Trente glorieuses et leur productivisme aveugle. Il s'agit d'en finir avec la concurrence et de la remplacer, progressivement, par d'autres relations entre États, basées sur la coopération.
Ce qui fait toute la complexité de la tâche, mais qui lui confère en même temps une incroyable puissance, c'est le fait que la France se trouve au cœur de la mondialisation. En dépit de tous les discours débilitants sur le déclin français, nous disposons du quatrième réseau de multinationales au monde. Imaginons un instant que nous prenions le contrôle social de ces firmes en expropriant leurs actionnaires. Nous disposerions alors de tous les leviers, à la fois pour changer les choses en profondeur en France (répartir les richesses, le travail, réduire la consommation mais améliorer de façon spectaculaire la qualité de vie...) mais aussi pour transformer nos relations internationales dans un sens progressiste. Impossible ? Non. Seulement impensable, car nous avons perdu l'habitude de penser en dehors du cadre qui nous est imposé.
Faire ouvertement front au projet européen
La séquence de « négociations » entre la Grèce et l'Union européenne s'est achevée de la pire façon qui soit : par la signature, le 13 juillet, d'un accord renforçant l'austérité et détruisant encore un peu plus la souveraineté du peuple. Un accord accepté par le gouvernement de gauche radicale, élu justement pour en finir avec l'austérité et l'humiliation vécue par les Grecs depuis de longues années.
En rendant les armes, la majorité de Syriza emmenée par le premier ministre Alexis Tsipras n'a pas totalement trahi son programme électoral. Ce dernier, en effet, n'a jamais évoqué le fait de rompre avec l'Union européenne ou de sortir de la zone euro. Par contre, le référendum du 5 juillet, qui a vu le peuple dire massivement Non à un premier projet d'accord, interdisait absolument à Alexis Tsipras de signer un plan aussi proche du projet rejeté dans les urnes et aussi défavorable à la Grèce.
Le premier ministre a cru que la large victoire du Non le 5 juillet suffirait à assouplir la position des créanciers. Ce fut exactement le contraire. Mais cette erreur d'appréciation n'est rien à côté de la faute politique commise par la suite. Un référendum n'est pas un simple sondage d'opinion. Il engageait Alexis Tsipras à obtenir de meilleures conditions ou à refuser de signer. Quitte à démissionner en cas de blocage complet des négociations, lui qui avait mis cette démission sur la table huit jours plus tôt, à l'occasion du scrutin.
En acceptant l'ultimatum des créanciers, Syriza envoie un message terrible, à savoir que la rupture avec l'Union européenne serait encore pire que l'extrême austérité et la mise sous tutelle politique qui figurent dans l'accord. C'est une victoire de Margaret Thatcher à titre posthume : il n'y aurait aucune alternative à l'eurolibéralisme. C'est évidemment faux. Certes, il fallait envisager d'autres alliances (avec la Russie, la Chine...) qui n'auraient pas été sans contreparties, il fallait s'attendre à des représailles de la part des dirigeants européens et il fallait surtout avoir le courage de nationaliser largement, de dévaluer, de relancer la production et la consommation nationales. Mais on imagine difficilement que ce « plan B » puisse donner de pires résultats que le « plan A » qu'Alexis Tsipras a signé.
Peut-être la majorité de Syriza mise-t-elle sur un coup de billard à trois bandes pour se soustraire, à posteriori, à certaines clauses de l'accord. En attendant, ceux qui ont voté Non le 5 juillet ont bel et bien été trahis. Et les conséquences de cette faute sont prévisibles : le parti d'extrême droite Aube dorée s'est déjà positionné comme dernier rempart face à l'Union européenne ; il risque fort de progresser de façon spectaculaire lors des prochains scrutins.
Les répercussions seront également sévères dans le reste de l'Europe. Pour Podemos en Espagne tout d'abord, qui a cru bon de soutenir la majorité de Syriza après l'accord du 13 juillet. Dans ces conditions, où la coalition de gauche annonce à l'avance qu'elle aussi préférera se coucher plutôt que de rompre avec Bruxelles, on voit mal pourquoi les Espagnols la porteraient au pouvoir. Le renoncement de Syriza se paiera cher aussi en France. On imagine déjà Marine Le Pen renvoyer cet échec de la gauche radicale grecque à la figure de Jean-Luc Mélenchon ou de Pierre Laurent, qui auront bien du mal à trouver des arguments convaincants pour se défendre.
Les difficultés actuelles et celles qui s'annoncent sont très largement dues à la myopie de la gauche radicale sur la véritable nature de l'Union européenne. Pendant dix ans, entre le Non français du 29 mai 2005 et aujourd'hui, elle n'a cessé de prétendre, en dépit du bon sens, que les institutions communautaires étaient réformables. L'Union européenne pouvait bien imposer le traité de Lisbonne, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), martyriser et humilier les pays du Sud, négocier avec les États-Unis le Grand marché transatlantique... les Syriza, les Front de gauche et les Podemos n'en démordaient pas : la négociation avec Bruxelles, Francfort et Berlin permettrait de « changer l'Europe ». Et de faire de l'euro un outil au service des peuples... Le plus tragique est de ne pas avoir perçu que ce discours, même s'il est plus virulent dans sa forme, n'est qu'une réplique de la propagande sociale-démocrate : demain, l'Europe sociale ! Les promesses trahies de François Mitterrand, de Lionel Jospin puis de François Hollande suffisaient à disqualifier totalement cette stratégie. Mais la gauche radicale s'entêtait. Jusqu'à la séquence grecque de 2015 qui fait définitivement voler en éclat l'illusion de la « réforme de l'intérieur ».
Il est bien temps aujourd'hui d'entrouvrir ces débats, tout en les canalisant pour qu'ils ne nous emmènent pas trop loin. Clémentine Autain (Ensemble) estime que l'on peut à présent douter du fait que l'union monétaire soit le paradis sur Terre et que, par conséquent, on est en droit de remettre en cause son existence. Tout en précisant aussitôt que refuser l'euro ne veut pas dire refuser l'Union européenne. En Belgique, le trotskiste Daniel Tanuro accepte enfin d'envisager la sortie de la Grèce de la zone euro... avant d'indiquer que cette solution n'est pas valable pour la France ou d'autres pays. Je repense alors aux écrits de mon ami et camarade Samir Amin, au lendemain du 29 mai 2005 : « On ne pourra jamais faire évoluer "de l'intérieur" l'Europe engagée dans la voie du libéralisme atlantiste, en direction d'une "Europe sociale" et indépendante (des États-Unis). C'est en faisant front ouvertement au projet européen tel qu'il est qu'on maximisera les chances d'une construction alternative authentique1. » Et je me dis que nous avons perdu dix ans.
J'ai défendu de mon côté l'idée de « désobéissance européenne », en lui donnant un contenu très clair : restaurer la souveraineté juridique et monétaire au niveau national pour mener des politiques de gauche. Je considérais qu'à partir du moment où un État dirigé par la gauche radicale recouvrait sa souveraineté, l'appartenance formelle aux institutions communautaires était secondaire. Cela reste techniquement vrai, mais le sort qui est fait aujourd'hui à la Grèce change la donne. Le simple fait d'être membre de l'Union européenne est devenu politiquement intolérable pour la gauche. Il ne s'agit plus seulement de rompre avec l'eurolibéralisme. Il s'agit d'affirmer que nous n'avons absolument rien en commun, ni du point de vue des objectifs, ni du point de vue des valeurs, avec ces institutions conçues dans une logique de classe, pour lutter contre les peuples, et qui se sentent à présent assez puissantes pour ne plus faire le moindre compromis. Le seul objectif valable est d'en sortir et de les démanteler.
1« Quel "projet européen" ? », Samir Amin, 21 juin 2005.
Commentaires
1. Cyril G le 24-07-2015 à 15:08:01 (site)
Je pense qu'il n'y a pas de mystère. Cette "Europe", c'est l'Europe des BANQUIERS (Goldman Sachs, Rothschild, etc.). La seule chose qui les intéresse c'est le profit par les intérêts des dettes et la spéculation sur la non-possibilité des pays endettés à pouvoir rembourser cette "dette". Pour ma part, j'appelle ça de l'escroquerie.
2. Henri Marteau le 27-07-2015 à 19:15:32
Ce que nous redoutions est arrivé.
Les masques sont tombés. l'UE avec sa monnaie unique sont irréformables. On ne réforme pas des institutions totalitaires, on les renverse.
Maintenant, les futurs gouvernements qui oseront se mettre en travers des institutions européennes savent ce qui les attend. Cela devrait servir de leçon à Podemos en Espagne qui rêve encore pouvoir changer le fonctionnement européen de l'intérieur.
Il ne faut plus se faire d'illusion sur la Gauche radicale pour engager le débat sur l'Euro et l'UE car ses dirigeants font l’amalgame entre valeurs universelles et supranationalité ce qui les amènent à considérer les Etats-Nations comme le mal absolu.
Le drame est qu'il n'existe aucune offre politique dans notre pays et en Europe proposant de s'affranchir de la camisole des institutions européennes, et cet espace laissé vacant par les partis politiques nourrit l'extrême droite qui s'y engouffre.
L'heure est peut-être venue pour tous ceux qui comme toi Aurélien, considèrent la démocratie, la monnaie, le budget indissociables de la souveraineté, d'envisager d'unir vos compétences pour faire avancer cette idée dans l'opinion ? Je pense à Jacques Sapir, Frédéric Lordon, Coralie Delaume, Cédric Durand, Raul-Marc Jennar et bien d'autres, ... Car il ne faut malheureusement pas compter sur les partis politiques devenus des syndicats d'élus pour engager le débat sur l'UE et l'Euro.
3. Mido le 16-08-2015 à 13:46:36
l'irréformabilité de l'Union Européenne, c'est exactement le leitmotiv en France de l'UPR, parti de François Asselineau. Pourquoi éludez vous l'existence même de ce parti que vous devez pourtant connaître ?
L'UPR est justement le seul parti en France qui prône dans sa Charte fondatrice même la sortie de l'UE par l'article 50, de l'euro et de l'OTAN.
Comment se fait il donc que dans cet article, vous n'en fassiez pas mention ?
4. Baptiste H le 16-08-2015 à 19:57:34 (site)
Bonjour, je partage votre analyse qui me réconcilie profondement avec les idées de la gauche radicale, que je voyais danser sur un pied depuis des années, écartelée par sa vision universaliste et l'appartenance forcée au carcan de l'UE. En revanche, comme Mido, je m'étonne de ne pas y voir une jonction avec les analyses de François Asselineau et de l'UPR qui sont celles qui m'ont permis de sortir de cet européisme béat dans lequel j'étais plongé. A quand une participation de la gauche radicale au nouveau programme du CNR de l'UPR ? A quand une dénonciation claire de cette dictature néolibérale dont nous pourrions sortir légalement, en toute quiétude, et restaurer notre souveraineté pour enfin mettre en place des politiques sociales concretes ? Merci - Baptiste
5. cording le 04-09-2015 à 21:53:39
Tsipras-Syriza ont négocié en position de faiblesse en refusant l'hypothèse d'une sortie de l'euro et l'UE au moins par chantage également sur un défaut sur la dette. Ces "partenaires" de l'Eurogroupe ( qui n' a aucune existence légale) ne se sont jamais privés de faire savoir clairement le caractère nul et non avenu non seulement des souhaits ( et non exigences) mais aussi l'existence politique d'un tel gouvernement. Juncker "les traités européens sont supérieurs à la démocratie".
En conséquence Tsipras-Syriza ont perdu faute d'envisager une sortie de l'euro pour répliquer à la politique d'étranglement financier de la Grèce par la BCE. Ils auraient pu, ce qui est possible par les traités, réquisitionner la Banque centrale de Grèce pour l'obliger à émettre les euros nécessaires.
Depuis quand un prisonnier négocie sa liberté avec son geôlier? sa sortie du carcan de fer nommé euro ?
6. jogo le 13-09-2015 à 15:15:14 (site)
Je suis très heureux de voir que certains à gauche se réveillent enfin pour comprendre l'impasse de l'euro. Il était très déprimant de voir uniquement le Front national ou Dupond-Aignant sur ce thème.
La monnaie est un domaine trop important pour la laisser à des institutions si peu démocratiques.
Mais sortir de l'euro pour reprendre une monnaie nationale oblige à davantage de maturité et de sens des responsabilités de la part des politiques.
Barbaries
Comme beaucoup d'autres, sans doute, je me réveille depuis deux jours avec une boule au ventre. Je suis triplement touché par le massacre perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo, le 7 janvier : comme être humain, comme auteur et comme militant de gauche. Cela ne me donne aucun droit particulier. Ma peine et ma peur n'ont pas plus de valeur que celle des autres. Mais, au fur et à mesure que l'abrutissement se dissipe, il faut bien tenter d'ordonner les idées, d'envisager la suite, de savoir comment continuer à vivre, à écrire, à militer avec ça.
En tant qu'être humain, je suis effaré par cette violence qui nous saute à la gueule. Je suis effaré lorsque je ressens ma haine, mon écœurement et ma peur, et que je sais qu'elle est le quotidien d'une partie de la population mondiale. Comment peut-on supporter cette barbarie, qu'elle soit heureusement exceptionnelle ou malheureusement habituelle ? On ne peut pas. Pas sans devenir fou et soi-même barbare ou sans tout faire pour y mettre fin. Il n'y a que deux réactions possibles : l'escalade de la violence ou la politique. Confrontés à la nullité et à la trahison d'une partie de nos dirigeants, nous avons tendance à l'oublier : la politique est le seul moyen de régler les conflits autrement que par la violence. Faire de la politique, c'est s'accorder sur des valeurs et produire du droit pour les mettre en pratique. Le retour de la barbarie, évident depuis le début des années 2000, nous rappelle que nous avons en grande partie échoué. Plus que jamais, nous avons besoin de reconstruire nos sociétés, nationales et internationales, c'est à dire de faire de la politique.
Je suis profondément choqué, évidemment, que l'on s'en prenne à un média, et que l'on exécute des gens pour leurs idées. J'ai longtemps lu Charlie Hebdo, « mon » journal d'adolescent et de jeune adulte. C'est même Charlie Hebdo qui m'a donné l'envie d'écrire, à une époque où, dans un seul journal, je trouvais les analyses économiques de Bernard Maris, mais aussi les bijoux littéraires de Fajardie et de Gébé. Plus tard, j'ai été pris entre deux sentiments contradictoires. D'un côté, mon anti-cléricalisme me poussait à soutenir ce combat contre l'intégrisme religieux, qui doit pouvoir passer par la satire. D'un autre côté, ma raison politique me faisait croire qu'il était dangereux, dans un contexte extrêmement tendu, de persister dans la provocation, de conforter les fous dans leur folie. Quoi qu'on en pense, cela ne peut cautionner aucun acte violent.
Tuer est la dernière extrémité, le moyen ultime pour faire taire. Mais réfléchissons aussi à la façon dont se déroulent, de nos jours, les débats d'idées. C'est un climat d'intolérance qui s'est généralisé dans les grands médias, sur les réseaux sociaux, dans les salles de réunions publiques. Créer l'amalgame, dégainer l'insulte, abaisser l'autre, ne plus interroger ni nos théories ni nos pratiques. Le 7 janvier, la liberté d'expression a pris plusieurs rafales dans le corps, mais elle est indestructible. Il y a plus grave encore : c'est notre capacité d'exprimer des idées contradictoires sans sombrer dans la violence – verbale, symbolique ou physique – qui est globalement menacée. Faire société implique de faire de la politique et la politique implique de s'exprimer. Or, nous perdons chaque jour un peu plus notre capacité à nous exprimer pacifiquement, y compris au sein d'une même famille politique. La mienne, la gauche, par les valeurs qu'elle défend, a le devoir d'être exemplaire. Nous devons réfléchir, écrire, parler en refusant la violence et le schéma des jeux du cirque imposé par les grands médias. Cela s'appelle la dignité. Nous en avons besoin dès maintenant, pour affronter ce drame, et pour la suite, qui promet d'être rude.
Pourtant, il faut dire les choses, et aller au bout de l'analyse politique, qui ne peut certainement pas être neutre. Après les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France est touchée par la barbarie du terrorisme. Cette barbarie terroriste répond à d'autres barbaries. Celle qui consiste à faire perdurer un ordre mondial fondé sur les inégalités et l'exploitation, dans une logique néo-coloniale, qui cultive le désir de vengeance et crée de toute pièce le fanatisme dans les pays les plus pauvres. Celle qui consiste à laisser, dans un pays très riche, une part croissante de la population vivre dans des conditions indignes et humiliantes, tout en faisant du luxe et de la richesse des marqueurs de réussite sociale, ce qui produit le désespoir et la haine au cœur même de notre société dite « développée ». Je ne parle pas d'un passé que je laisse à mes ancêtres, d'une dette « historique » pour laquelle il faudrait se flageller, mais du présent, du monde et de la France dans lesquels je vis.
Les injustices n'excusent en rien la barbarie terroriste, mais elles l'expliquent. D'autres barbares ne sont toujours pas recherchés par la police : les dirigeants de l'industrie française de l'armement, heureux d'augmenter leurs profits grâce à la violence ; les dirigeants politiques et les économistes libéraux qui les conseillent, heureux de redresser la balance extérieure de la France grâce aux ventes d'armes (premier poste excédentaire, et de loin) ; les traders « investissant » sur les marchés de matières premières et déclenchant des drames humains en quelques clics de souris ; les multinationales françaises pillant les ressources des pays du Sud ; les prescripteurs d'austérité pour les couches populaires alors même que nous débordons, en France, de richesses créées. Autant d'injustices qui créent des fous, tuant des innocents. Une folie dont nous n'arriverons jamais à nous protéger.
Car tous les gens sains d'esprit s'en doutent, il est physiquement impossible de lutter contre le terrorisme par la répression sécuritaire. Toutes les polices, toutes les armées, tous les systèmes de surveillance ne suffiront jamais à « protéger » les lieux publics ou privés. Le seul moyen de lutter contre le terrorisme est d'en supprimer les causes, de ne plus créer ces opprimés, qui deviendront désespérés, et dont une infime minorité sombrera dans la folie. La seule solution est la justice, dans la société française comme dans les relations internationales. Une justice définitivement incompatible avec le capitalisme, dont Jaurès disait qu'il porte en lui la guerre « comme la nuée porte l'orage ». La guerre a changé de forme, mais elle reste toujours aussi barbare, et le capitalisme porte toujours en lui cette barbarie.
On peut, à contre-coeur, supporter le temps du deuil une union nationale de citoyens. Mais si les dirigeants français actuels, socialistes ou de droite, avaient un soupçon de dignité, ils reconnaîtraient leur échec, changeraient radicalement de politique ou bien quitteraient le pouvoir. Nous savons tous qu'il n'en sera rien. Nous avons donc une grande responsabilité : penser la suite et construire un projet de société qui nous sauve de la barbarie. Comme l'a dit Noam Chomsky,« Tout le monde s'inquiète de stopper le terrorisme. En fait, il existe un moyen simple : arrêter d'y participer ». L'espace politique est partagé en deux : ceux qui continueront à alimenter la barbarie et ceux qui s'engageront pour y mettre fin. J'ignore quel nom donner aux premiers. Comment désigner une catégorie politique qui comprend des socialistes, des réactionnaires, des ultra-libéraux, des extrémistes de droite ? Les seconds, par contre, n'ont pas ce problème. Ils sont la gauche. Nous sommes la gauche.
9 janvier 2015
Commentaires
1. colea le 10-01-2015 à 17:35:56 (site)
et si on commençait par ne plus chanter "qu'un sang impur abreuve nos sillons"???
2. Niurka le 14-01-2015 à 13:39:37
Je pense qu'il ne s'agit pas de "fous" mais d' êtres faibles et qui se laissent manipuler puis fanatiser.
S'il s'agissait de fous, il n'y aurait pas grand chose à faire car il est difficile de repérer la folie. En pensant qu'ils sont fous, les gouvernements, les citoyens vont se dédouaner car on ne peut rien faire fondamentalement, c'est à dire changer globalement la société. Et il faut, certes, en premier lieu, empêcher de nuire les vrais instigateurs.
Amicalement
Niurka
3. ChristineBou le 19-01-2015 à 00:23:59
Merci Aurélien ...
Et nous sommes toujours et encore à la recherche de ce qui peut unir sur des bases solides...d'un côté, approfondir pour comprendre (ce qui peut amener à débattre âprement, même avec les plus proches) et de l'autre se rassembler sur des bases larges, mais rigoureuses en ce qui concerne l'humanité et le monde que nous voulons....
Et la laïcité est un cadre porteur d'avenir pour ces raisons.
Amicalement
Christine
4. Figari le 17-08-2015 à 15:25:00
et envahir des pays comme l'a fait l'otan avec le soutien de la france ! n'es ce pas du terrosrisme ? combien de morts en Syrie ? , Lybie ? Ukraine ? Irak ? Afganistan ? etc....
Les classes populaires se sentent profondément trahies par la gauche
Interview parue sur le site comptoir.org.
Aurélien Bernier est un essayiste et militant politique proche de la gauche radicale. Ancien membre du conseil d'administration d'Attac et du M'Pep, sa réflexion s'articule principalement autour de l'écologie - dont la décroissance -, le souverainisme et l'internationalisme. Il est notamment l'auteur de « Désobéissons à l'Union européenne ! » (éditions Mille et une nuits), « Comment la mondialisation a tué l'écologie » (idem) et « La gauche radicale et ses tabous : pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national » (édition Seuil). Nous avons souhaité discuter avec lui de plusieurs sujets au cœur du débat politique : l'Union européenne, la souveraineté, l'écologie et la décroissance.
À l'heure actuelle, un système de protection sociale à la française est-il envisageable à une échelle européenne ? Ce type de système de solidarité peut-il dépasser les frontières ?
Aurélien Bernier : Les systèmes de protection sociale en Europe ont été mis en place par les États. Les choix faits en France sont le produit d'un compromis entre une partie de la droite et de la gauche : celui du Conseil national de la Résistance. Même s'il n'est pas parfait, il s'agit d'un édifice à abattre pour les libéraux, comme l'a avoué en son temps Denis Kessler, dirigeant du Medef. Or, dans cette entreprise de destruction, l'Union européenne joue un rôle essentiel de coordination et de justification. Non seulement le droit européen, totalement voué à la concurrence et à la dérégulation, pousse à la casse sociale, mais « l'Europe » est l'argument ultime pour faire accepter ces reculs. Comme Nicolas Sarkozy avant lui, François Hollande se défausse sur la « contrainte de Bruxelles ». Mais il n'en reste pas moins que le droit européen s'impose aux États. La droite et les sociaux-démocrates jouent ce double-jeu depuis des décennies. Comme le disent Antoine Schwartz et François Denord, « l'Europe sociale n'aura pas lieu » dans le cadre de l'Union européenne.
L'Union européenne a-t-elle été un frein ou une aide cruciale dans le progrès des mesures écologistes ?
Dans le milieu écologiste français, une vieille légende se transmet de génération en génération : la construction européenne serait bénéfique pour l'environnement, car elle forcerait les États récalcitrants à prendre des mesures. On cite souvent la qualité de l'eau, la chasse ou même la réduction des gaz à effet de serre. Mais c'est une véritable imposture. D'une part, les lobbies sont tout aussi actifs et puissants à Bruxelles qu'au niveau national, et les conflits d'intérêt entre commissaires européens et entreprises sont innombrables. D'autre part, quand l'Union européenne adopte une malheureuse directive nitrate, elle soutien en parallèle de manière honteuse l'agriculture intensive. Les politiques générales de l'Union européenne sont un véritable désastre pour l'environnement. Je me demande comment font certains écologistes pour ne pas s'en rendre compte.
On vante souvent le rôle de l'Union européenne en matière d'agriculture, avec notamment la Politique agricole commune (PAC). Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
La Politique agricole commune a été, à une époque, un outil de régulation. Il était loin d'être parfait, puisque nous étions déjà dans une logique de libre-échange, mais en cercle fermé : celui des membres de la Communauté européenne. Mais aujourd'hui, la PAC ne vise que la compétitivité internationale de l'agriculture européenne. C'est un désastre pour les paysans, pour l'environnement et pour l'aménagement du territoire.
Pensez-vous que la gauche de la gauche soit encore en état de proposer un projet souverainiste, décroissant et anticapitaliste ou est-ce que le salut viendra de mouvements citoyens et populaires ?
Le rôle d'un parti politique est de porter un programme électoral devant les électeurs. Je crois que la gauche radicale peut et doit construire un programme de démondialisation, de décroissance et de solidarité internationale. Mais si les partis ne sont pas poussés par des mouvements citoyens non partisans, ils vont d'élection en élection, de calcul électoral en stratégies d'alliance. Ce n'est pas insultant que de dire ça, c'est un état de fait. Le succès d'Attac (dont j'ai fait partie au début des années 2000) a été de produire des idées et des mobilisations en dehors d'un calendrier électoral. Il n'y avait pas de considération tactique autre que celle de faire progresser ces idées. Aujourd'hui, des intellectuels comme Frédéric Lordon, Jacques Sapir, Emmanuel Todd ou d'autres jouent un rôle crucial en poussant la gauche radicale à la cohérence. Le « salut » dont vous parlez viendra le jour où la gauche radicale sera obligée d'être cohérente parce que les intellectuels et les mouvements citoyens l'auront mise au pied du mur.
Certains auteurs, comme Frédéric Lordon, distinguent la « souveraineté populaire » de la « souveraineté nationale ». En faites-vous autant ?
Bien sûr. La souveraineté nationale peut très bien être obtenue par la dictature. Ce n'est donc pas une fin en soi, car la démocratie, c'est garantir la souveraineté du peuple. En revanche, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire. La stratégie des ultralibéraux vise à démanteler les souverainetés nationales, car ce qu'ils craignent plus que tout, c'est l'arrivée au pouvoir d'une gauche qui rejouerait le Conseil national de la Résistance en développant des mesures sociales, en nationalisant, en régulant... Le moyen qu'ils ont utilisé pour rendre ce cauchemar impossible, c'est la supranationalité ou la soumission à des institutions internationales : l'Union européenne, l'euro, l'Organisation mondiale du commerce... Comme ces institutions sont impossibles à réformer, il faudra rompre au niveau national pour se redonner la possibilité de mener des politiques de gauche.
À vous lire, on peut avoir l'impression que pour vous la question de la souveraineté expliquerait à elle seule la montée du FN et l'effondrement de la gauche de la gauche. Ne sous-estimez-vous pas les conséquences culturelles de la mondialisation néolibérale, ce que des intellectuels comme Christophe Guilluy ou Laurent Bouvet nomment « l'insécurité culturelle » ?
Non, je partage l'analyse de Laurent Bouvet sur « l'insécurité culturelle », cette perte globale de valeurs sous l'effet de la mondialisation. Certaines de ces valeurs mériteraient d'ailleurs d'être remises en cause, d'autre pas. Ce que j'ai analysé dans mon dernier livre, La gauche radicale et ses tabous, c'est moins la montée du Front national dans son ensemble que la victoire du Front national sur la gauche radicale, qui tient à la conquête, depuis 1992 et le référendum de Maastricht, d'une part croissante des classes populaires par l'extrême droite. Ces dernières se sentent profondément trahies par la gauche. Par Mitterrand et Delors, bien sûr, mais aussi par le Parti communiste français quand il participe, entre mars 1983 et juillet 1984, entre 1997 et 2002, à un gouvernement qui renonce à mener des politiques de gauche ou qu'il refuse, depuis 2012, à couper les ponts avec François Hollande. Cette relation PS-PCF a conduit les communistes à abandonner des sujets essentiels, comme leur critique radicale de la construction européenne pour se convertir, finalement, à la stratégie de « l'Europe sociale ». Marine Le Pen fait la différence en donnant l'impression qu'elle va rompre avec Bruxelles et avec le libre-échange. Il y a donc ce malaise diffus de l'insécurité culturelle auquel répond le Front national, et cette question beaucoup plus précise de l'emploi, des délocalisations, de la concurrence internationale auquel il répond aussi sans recourir uniquement à la vieille rengaine de la chasse aux immigrés. Le Front national joue sur les deux tableaux, mais je pense que c'est le scénario de Marine Le Pen sur les questions économiques qui, de plus en plus, emporte l'adhésion des classes populaires.
La décroissance a-t-elle partie liée avec la démondialisation ? Si oui, le concept de démondialisation n'induit-il pas un paradoxe ? Car pour être efficace la démondialisation doit être mondialisée...
Dans ma réflexion, je lie trois choses : la démondialisation, la décroissance et la coopération internationale. La démondialisation est indispensable pour retrouver la possibilité de gouverner à gauche. La décroissance s'impose à nous. On peut dire « antiproductivisme » parce que l'on a peur de prononcer le mot « décroissance » (ce qui fut mon cas pendant longtemps), mais cela revient au même : nous n'aurons plus jamais, et heureusement, les taux de croissance des « Trente glorieuses ». Le produit intérieur brut, tel qu'il est calculé aujourd'hui, baissera. Donc, soit on change d'indicateur, soit on dit « oui, le PIB va baisser, ce qui est la définition de la décroissance, mais nous allons améliorer la vie du plus grand nombre de façon spectaculaire ». Comment ? En piquant l'argent où il est : chez les riches. Et nous les empêcherons de le planquer en Suisse ou ailleurs car nous rétablirons un contrôle strict et permanent des capitaux. Et nous relocaliserons l'activité, nous développerons les services non-marchands, de façon à assurer le plein emploi. Nous sortirons de la concurrence internationale par du protectionnisme mais nous contraindrons les entreprises en France et les entreprises françaises à l'étranger à respecter des règles écologiques et sociales. Nous mènerons une véritable politique de solidarité internationale (que je détaillerai dans un prochain bouquin), car notre projet politique est fondamentalement internationaliste. Il n'y a pas de paradoxe : la démondialisation et la décroissance se mondialiseront, mais de proche en proche, car un pays qui en a les capacités aura donné l'exemple.
Dans notre société, la croissance est élevée en vraie religion. Dans le même temps, la mondialisation semble s'imposer d'elle-même. Les concepts de « démondialisation » et de « décroissance » n'impliquent-t-il pas nécessairement au préalable ce que Serge Latouche appelle une « décolonisation de l'imaginaire » ?
Oui, c'est certain. Mais il ne suffit pas de décoloniser, il faut remettre en marche l'imaginaire. Et donc redonner l'espoir du changement à une échelle suffisamment vaste. C'est là le rôle du politique. Que ça nous plaise ou non, la conquête du pouvoir est indispensable.
La « mondialisation » du principe de décroissance ne doit-elle pas être fondée sur une lutte acharnée contre l'ethnocentrisme capitaliste et l'idée que le développement économique rime avec l'accumulation matérielle ? Et si le vrai combat de la décroissance c'était tout simplement celui de lutter contre toute forme de domination culturelle ?
Le développement capitaliste ne repose pas que sur l'accumulation matérielle, mais aussi sur son renouvellement. C'est la stratégie de l'obsolescence provoquée par la mode ou par la technique. La lutte contre la domination culturelle est indispensable, mais elle prendra du temps. La décroissance doit passer par des mesures plus rapides : la lutte juridique contre l'obsolescence programmée, la relocalisation pour contraindre les entreprises à respecter des règles, la baisse et l'arrêt de productions nuisibles ou inutiles comme certains produits de luxe ou l'armement.
Si la décroissance signifie un retour aux « choses essentielles de la vie » et un rejet de la société consumériste, ce mouvement ne risque-t-il pas d'être taxé de « réactionnaire » ?
J'assume ma part de conservatisme s'il s'agit de défendre des valeurs de gauche issues de la Révolution française, des luttes sociales, de la Résistance ou des valeurs écologistes. Les « choses essentielles de la vie », ce sont l'amour, l'amitié, la reconnaissance, la culture, mais aussi pouvoir subvenir à ses besoins, vivre correctement de son travail, se sentir bien dans son logement, avoir droit à la protection sociale, à la liberté d'expression... Je ne suis pas prêt à vivre en marge de la société, au bord d'un lac, comme Henry David Thoreau.
Dans votre dernier ouvrage, La gauche radicale et ses tabous, vous restez assez vague sur la question de l'immigration. Pouvez-vous préciser votre position ?
Je ne suis pas resté vague, je n'ai rien écrit sur le sujet ! Pour une raison simple : je n'avais pas travaillé ce thème et je ne prétendais pas traiter en un livre tous les problèmes programmatiques de la gauche radicale. Sur l'immigration, cette dernière a un discours très sommaire, qui consiste à prôner la « liberté de circulation ». Or, la question est loin d'être si simple. Une politique migratoire, ce sont des flux de personnes, mais aussi des conditions d'accueil des migrants. La situation actuelle est scandaleuse en termes de travail, de logement, d'éducation, de droits...
Je pense qu'une vraie politique de gauche sur l'immigration doit reposer sur cinq mesures. La première, c'est la régularisation de tous les sans-papiers présents sur le territoire au moment de l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir. Nous hériterions d'une situation qui n'est pas de notre fait, et le seul moyen humainement acceptable de la régler est la régularisation. La deuxième, c'est la mise en place d'un véritable service public de « l'intégration », même si ce mot est devenu suspect. Il faut des cours gratuits de français, d'éducation civique, de droit... qui permettent aux migrants de ne pas rester à la merci des patrons-voyous et des marchands de sommeil, de faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Troisièmement, il faut une politique irréprochable en matière de droit d'asile, qui protège les exilés. Quatrièmement, il faut ce que refuse de faire la gauche radicale aujourd'hui : définir une politique pour l'immigration de travail. Si l'on est sérieux, cette politique ne peut pas être celle de la liberté totale de circulation. Elle doit dépendre des capacités de l'État à fournir un logement digne, un emploi, à « former » les nouveaux arrivants. Elle doit être généreuse, la plus généreuse possible, mais il est évident qu'elle ne peut être illimitée. Le dernier aspect, qui est absolument crucial et dont la gauche radicale ne parle jamais en profondeur, c'est le type de relations internationales que la France devra adopter. Il faut mettre les moyens pour améliorer radicalement les conditions de vie dans les pays du Sud. Nous avons mille façons de le faire : annuler la dette, orienter l'aide au développement vers des projets vraiment utiles, coopérer en matière d'éducation, de santé, dans le domaine juridique... Et nous avons surtout un puissant réseau de multinationales françaises implantées dans les pays du Sud dans des secteurs d'activité variés : banques, assurances, industrie, grande distribution... Exproprions les actionnaires et nationalisons ces firmes pour en faire des instruments de coopération internationale. Voilà sans doute le moyen le plus efficace de « mondialiser la démondialisation ».
Entretien réalisé par Aurélien Beleau, Noé Roland, Kevin « L'Impertinent » Victoire & Galaad Wilgos

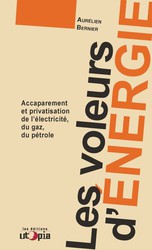
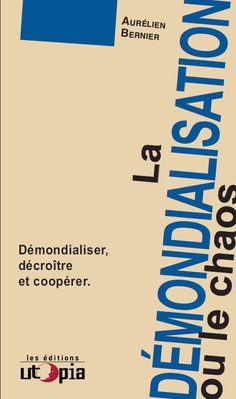
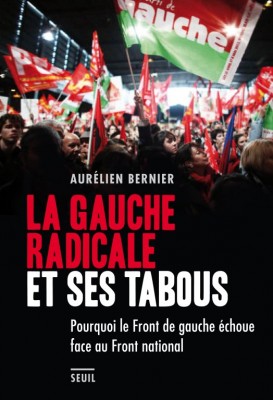



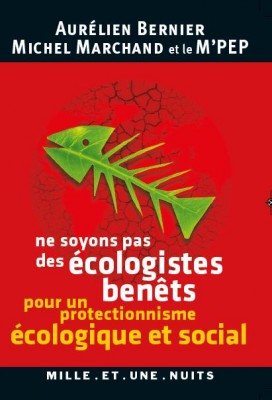
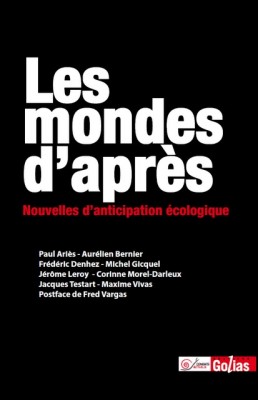

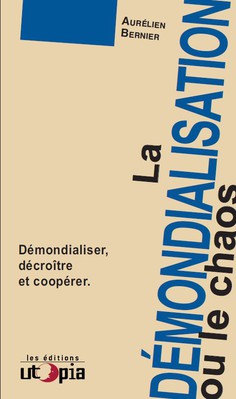

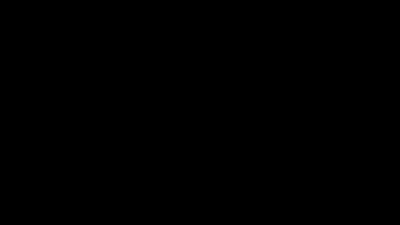
Commentaires
1. colea le 19-10-2016 à 16:56:50 (site)
Intéressant, mais comment se débarrasser de la bourse, du système des actions et des entreprises cotées en bourse, de la spéculation et de l'économie virtuelle?
2. Cocoyoc 1974 le 13-12-2016 à 09:23:39
Votre livre est dense et un résumé sur cette "démondialisation". Votre titre ressemble au livre de René Dumont : l'utopie ou la mort en 1973-1974.
Il y a un programme politique en France, pour démondialiser et se débarrasser des marchés financiers et de la bourse.
Bravo pour votre pédagogie ! La démondialisation sera un processus très hétérogène selon les pays.
3. ptit-n-ange le 03-02-2019 à 10:50:02 (site)
Bonjour,
je pense comme vous,oui il faut sortir de lUE et de la mondialisation qui ne sont que la mise en esclavage des peuples sans compté que depuis que la mondialisation à commencée,il n'y à jamais eu autant d'enfant à travailler dans ce monde aux ordes du fric.
Amicalement