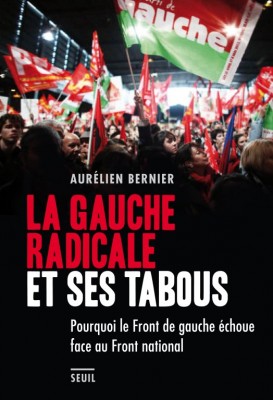Auteur : abernier
Date de création : 28-11-2007
Les classes populaires se sentent profondément trahies par la gauche
Interview parue sur le site comptoir.org.
Aurélien Bernier est un essayiste et militant politique proche de la gauche radicale. Ancien membre du conseil d'administration d'Attac et du M'Pep, sa réflexion s'articule principalement autour de l'écologie - dont la décroissance -, le souverainisme et l'internationalisme. Il est notamment l'auteur de « Désobéissons à l'Union européenne ! » (éditions Mille et une nuits), « Comment la mondialisation a tué l'écologie » (idem) et « La gauche radicale et ses tabous : pourquoi le Front de gauche échoue face au Front national » (édition Seuil). Nous avons souhaité discuter avec lui de plusieurs sujets au cœur du débat politique : l'Union européenne, la souveraineté, l'écologie et la décroissance.
À l'heure actuelle, un système de protection sociale à la française est-il envisageable à une échelle européenne ? Ce type de système de solidarité peut-il dépasser les frontières ?
Aurélien Bernier : Les systèmes de protection sociale en Europe ont été mis en place par les États. Les choix faits en France sont le produit d'un compromis entre une partie de la droite et de la gauche : celui du Conseil national de la Résistance. Même s'il n'est pas parfait, il s'agit d'un édifice à abattre pour les libéraux, comme l'a avoué en son temps Denis Kessler, dirigeant du Medef. Or, dans cette entreprise de destruction, l'Union européenne joue un rôle essentiel de coordination et de justification. Non seulement le droit européen, totalement voué à la concurrence et à la dérégulation, pousse à la casse sociale, mais « l'Europe » est l'argument ultime pour faire accepter ces reculs. Comme Nicolas Sarkozy avant lui, François Hollande se défausse sur la « contrainte de Bruxelles ». Mais il n'en reste pas moins que le droit européen s'impose aux États. La droite et les sociaux-démocrates jouent ce double-jeu depuis des décennies. Comme le disent Antoine Schwartz et François Denord, « l'Europe sociale n'aura pas lieu » dans le cadre de l'Union européenne.
L'Union européenne a-t-elle été un frein ou une aide cruciale dans le progrès des mesures écologistes ?
Dans le milieu écologiste français, une vieille légende se transmet de génération en génération : la construction européenne serait bénéfique pour l'environnement, car elle forcerait les États récalcitrants à prendre des mesures. On cite souvent la qualité de l'eau, la chasse ou même la réduction des gaz à effet de serre. Mais c'est une véritable imposture. D'une part, les lobbies sont tout aussi actifs et puissants à Bruxelles qu'au niveau national, et les conflits d'intérêt entre commissaires européens et entreprises sont innombrables. D'autre part, quand l'Union européenne adopte une malheureuse directive nitrate, elle soutien en parallèle de manière honteuse l'agriculture intensive. Les politiques générales de l'Union européenne sont un véritable désastre pour l'environnement. Je me demande comment font certains écologistes pour ne pas s'en rendre compte.
On vante souvent le rôle de l'Union européenne en matière d'agriculture, avec notamment la Politique agricole commune (PAC). Quel est votre point de vue sur ce sujet ?
La Politique agricole commune a été, à une époque, un outil de régulation. Il était loin d'être parfait, puisque nous étions déjà dans une logique de libre-échange, mais en cercle fermé : celui des membres de la Communauté européenne. Mais aujourd'hui, la PAC ne vise que la compétitivité internationale de l'agriculture européenne. C'est un désastre pour les paysans, pour l'environnement et pour l'aménagement du territoire.
Pensez-vous que la gauche de la gauche soit encore en état de proposer un projet souverainiste, décroissant et anticapitaliste ou est-ce que le salut viendra de mouvements citoyens et populaires ?
Le rôle d'un parti politique est de porter un programme électoral devant les électeurs. Je crois que la gauche radicale peut et doit construire un programme de démondialisation, de décroissance et de solidarité internationale. Mais si les partis ne sont pas poussés par des mouvements citoyens non partisans, ils vont d'élection en élection, de calcul électoral en stratégies d'alliance. Ce n'est pas insultant que de dire ça, c'est un état de fait. Le succès d'Attac (dont j'ai fait partie au début des années 2000) a été de produire des idées et des mobilisations en dehors d'un calendrier électoral. Il n'y avait pas de considération tactique autre que celle de faire progresser ces idées. Aujourd'hui, des intellectuels comme Frédéric Lordon, Jacques Sapir, Emmanuel Todd ou d'autres jouent un rôle crucial en poussant la gauche radicale à la cohérence. Le « salut » dont vous parlez viendra le jour où la gauche radicale sera obligée d'être cohérente parce que les intellectuels et les mouvements citoyens l'auront mise au pied du mur.
Certains auteurs, comme Frédéric Lordon, distinguent la « souveraineté populaire » de la « souveraineté nationale ». En faites-vous autant ?
Bien sûr. La souveraineté nationale peut très bien être obtenue par la dictature. Ce n'est donc pas une fin en soi, car la démocratie, c'est garantir la souveraineté du peuple. En revanche, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire. La stratégie des ultralibéraux vise à démanteler les souverainetés nationales, car ce qu'ils craignent plus que tout, c'est l'arrivée au pouvoir d'une gauche qui rejouerait le Conseil national de la Résistance en développant des mesures sociales, en nationalisant, en régulant... Le moyen qu'ils ont utilisé pour rendre ce cauchemar impossible, c'est la supranationalité ou la soumission à des institutions internationales : l'Union européenne, l'euro, l'Organisation mondiale du commerce... Comme ces institutions sont impossibles à réformer, il faudra rompre au niveau national pour se redonner la possibilité de mener des politiques de gauche.
À vous lire, on peut avoir l'impression que pour vous la question de la souveraineté expliquerait à elle seule la montée du FN et l'effondrement de la gauche de la gauche. Ne sous-estimez-vous pas les conséquences culturelles de la mondialisation néolibérale, ce que des intellectuels comme Christophe Guilluy ou Laurent Bouvet nomment « l'insécurité culturelle » ?
Non, je partage l'analyse de Laurent Bouvet sur « l'insécurité culturelle », cette perte globale de valeurs sous l'effet de la mondialisation. Certaines de ces valeurs mériteraient d'ailleurs d'être remises en cause, d'autre pas. Ce que j'ai analysé dans mon dernier livre, La gauche radicale et ses tabous, c'est moins la montée du Front national dans son ensemble que la victoire du Front national sur la gauche radicale, qui tient à la conquête, depuis 1992 et le référendum de Maastricht, d'une part croissante des classes populaires par l'extrême droite. Ces dernières se sentent profondément trahies par la gauche. Par Mitterrand et Delors, bien sûr, mais aussi par le Parti communiste français quand il participe, entre mars 1983 et juillet 1984, entre 1997 et 2002, à un gouvernement qui renonce à mener des politiques de gauche ou qu'il refuse, depuis 2012, à couper les ponts avec François Hollande. Cette relation PS-PCF a conduit les communistes à abandonner des sujets essentiels, comme leur critique radicale de la construction européenne pour se convertir, finalement, à la stratégie de « l'Europe sociale ». Marine Le Pen fait la différence en donnant l'impression qu'elle va rompre avec Bruxelles et avec le libre-échange. Il y a donc ce malaise diffus de l'insécurité culturelle auquel répond le Front national, et cette question beaucoup plus précise de l'emploi, des délocalisations, de la concurrence internationale auquel il répond aussi sans recourir uniquement à la vieille rengaine de la chasse aux immigrés. Le Front national joue sur les deux tableaux, mais je pense que c'est le scénario de Marine Le Pen sur les questions économiques qui, de plus en plus, emporte l'adhésion des classes populaires.
La décroissance a-t-elle partie liée avec la démondialisation ? Si oui, le concept de démondialisation n'induit-il pas un paradoxe ? Car pour être efficace la démondialisation doit être mondialisée...
Dans ma réflexion, je lie trois choses : la démondialisation, la décroissance et la coopération internationale. La démondialisation est indispensable pour retrouver la possibilité de gouverner à gauche. La décroissance s'impose à nous. On peut dire « antiproductivisme » parce que l'on a peur de prononcer le mot « décroissance » (ce qui fut mon cas pendant longtemps), mais cela revient au même : nous n'aurons plus jamais, et heureusement, les taux de croissance des « Trente glorieuses ». Le produit intérieur brut, tel qu'il est calculé aujourd'hui, baissera. Donc, soit on change d'indicateur, soit on dit « oui, le PIB va baisser, ce qui est la définition de la décroissance, mais nous allons améliorer la vie du plus grand nombre de façon spectaculaire ». Comment ? En piquant l'argent où il est : chez les riches. Et nous les empêcherons de le planquer en Suisse ou ailleurs car nous rétablirons un contrôle strict et permanent des capitaux. Et nous relocaliserons l'activité, nous développerons les services non-marchands, de façon à assurer le plein emploi. Nous sortirons de la concurrence internationale par du protectionnisme mais nous contraindrons les entreprises en France et les entreprises françaises à l'étranger à respecter des règles écologiques et sociales. Nous mènerons une véritable politique de solidarité internationale (que je détaillerai dans un prochain bouquin), car notre projet politique est fondamentalement internationaliste. Il n'y a pas de paradoxe : la démondialisation et la décroissance se mondialiseront, mais de proche en proche, car un pays qui en a les capacités aura donné l'exemple.
Dans notre société, la croissance est élevée en vraie religion. Dans le même temps, la mondialisation semble s'imposer d'elle-même. Les concepts de « démondialisation » et de « décroissance » n'impliquent-t-il pas nécessairement au préalable ce que Serge Latouche appelle une « décolonisation de l'imaginaire » ?
Oui, c'est certain. Mais il ne suffit pas de décoloniser, il faut remettre en marche l'imaginaire. Et donc redonner l'espoir du changement à une échelle suffisamment vaste. C'est là le rôle du politique. Que ça nous plaise ou non, la conquête du pouvoir est indispensable.
La « mondialisation » du principe de décroissance ne doit-elle pas être fondée sur une lutte acharnée contre l'ethnocentrisme capitaliste et l'idée que le développement économique rime avec l'accumulation matérielle ? Et si le vrai combat de la décroissance c'était tout simplement celui de lutter contre toute forme de domination culturelle ?
Le développement capitaliste ne repose pas que sur l'accumulation matérielle, mais aussi sur son renouvellement. C'est la stratégie de l'obsolescence provoquée par la mode ou par la technique. La lutte contre la domination culturelle est indispensable, mais elle prendra du temps. La décroissance doit passer par des mesures plus rapides : la lutte juridique contre l'obsolescence programmée, la relocalisation pour contraindre les entreprises à respecter des règles, la baisse et l'arrêt de productions nuisibles ou inutiles comme certains produits de luxe ou l'armement.
Si la décroissance signifie un retour aux « choses essentielles de la vie » et un rejet de la société consumériste, ce mouvement ne risque-t-il pas d'être taxé de « réactionnaire » ?
J'assume ma part de conservatisme s'il s'agit de défendre des valeurs de gauche issues de la Révolution française, des luttes sociales, de la Résistance ou des valeurs écologistes. Les « choses essentielles de la vie », ce sont l'amour, l'amitié, la reconnaissance, la culture, mais aussi pouvoir subvenir à ses besoins, vivre correctement de son travail, se sentir bien dans son logement, avoir droit à la protection sociale, à la liberté d'expression... Je ne suis pas prêt à vivre en marge de la société, au bord d'un lac, comme Henry David Thoreau.
Dans votre dernier ouvrage, La gauche radicale et ses tabous, vous restez assez vague sur la question de l'immigration. Pouvez-vous préciser votre position ?
Je ne suis pas resté vague, je n'ai rien écrit sur le sujet ! Pour une raison simple : je n'avais pas travaillé ce thème et je ne prétendais pas traiter en un livre tous les problèmes programmatiques de la gauche radicale. Sur l'immigration, cette dernière a un discours très sommaire, qui consiste à prôner la « liberté de circulation ». Or, la question est loin d'être si simple. Une politique migratoire, ce sont des flux de personnes, mais aussi des conditions d'accueil des migrants. La situation actuelle est scandaleuse en termes de travail, de logement, d'éducation, de droits...
Je pense qu'une vraie politique de gauche sur l'immigration doit reposer sur cinq mesures. La première, c'est la régularisation de tous les sans-papiers présents sur le territoire au moment de l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir. Nous hériterions d'une situation qui n'est pas de notre fait, et le seul moyen humainement acceptable de la régler est la régularisation. La deuxième, c'est la mise en place d'un véritable service public de « l'intégration », même si ce mot est devenu suspect. Il faut des cours gratuits de français, d'éducation civique, de droit... qui permettent aux migrants de ne pas rester à la merci des patrons-voyous et des marchands de sommeil, de faire valoir leurs droits les plus élémentaires. Troisièmement, il faut une politique irréprochable en matière de droit d'asile, qui protège les exilés. Quatrièmement, il faut ce que refuse de faire la gauche radicale aujourd'hui : définir une politique pour l'immigration de travail. Si l'on est sérieux, cette politique ne peut pas être celle de la liberté totale de circulation. Elle doit dépendre des capacités de l'État à fournir un logement digne, un emploi, à « former » les nouveaux arrivants. Elle doit être généreuse, la plus généreuse possible, mais il est évident qu'elle ne peut être illimitée. Le dernier aspect, qui est absolument crucial et dont la gauche radicale ne parle jamais en profondeur, c'est le type de relations internationales que la France devra adopter. Il faut mettre les moyens pour améliorer radicalement les conditions de vie dans les pays du Sud. Nous avons mille façons de le faire : annuler la dette, orienter l'aide au développement vers des projets vraiment utiles, coopérer en matière d'éducation, de santé, dans le domaine juridique... Et nous avons surtout un puissant réseau de multinationales françaises implantées dans les pays du Sud dans des secteurs d'activité variés : banques, assurances, industrie, grande distribution... Exproprions les actionnaires et nationalisons ces firmes pour en faire des instruments de coopération internationale. Voilà sans doute le moyen le plus efficace de « mondialiser la démondialisation ».
Entretien réalisé par Aurélien Beleau, Noé Roland, Kevin « L'Impertinent » Victoire & Galaad Wilgos