Démondialiser et coopérer
Blog d'Aurélien BERNIER
La désobéissance européenne

Intervention à l’université d'été du M'PEP, 28-30 août 2009, Lille - De toutes les questions taboues en politique, la plus taboue est sans doute celle-ci : peut-on encore mener une politique de gauche dans le cadre de l'Union européenne ? Il est évident que le respect des traités européens ne peut conduire qu'à accepter des politiques libérales. Pour une gauche radicale qui prétend gouverner un jour, il n'existe donc que deux options. La première est de renoncer, une fois élue, au programme qu'elle s'était engagée à mettre en œuvre, au motif que le droit européen le lui interdit. La seconde est de désobéir à l'Union pour pouvoir gouverner à gauche. Il n'y a aucune autre alternative. C'est la raison pour laquelle le M'PEP lance le débat autour de cette notion de « désobéissance européenne », qui consiste à refuser le diktat de l'Union européenne pour mener des politiques progressistes.
I.- POURQUOI LA DESOBEISSANCE EUROPEENNE ?
A.- Une construction européenne totalement verrouillée
Le libéralisme gravé dans le marbre des traités
La construction communautaire s’est faite par l'adoption de traités successifs : celui de Rome (1957), l’Acte unique (1986), celui de Maastricht (1992), celui d’Amsterdam (1997) et celui de Nice (2001). Or, ces traités sont fondamentalement libéraux. Le libre-échange et la concurrence y sont inscrits comme principes fondateurs de l'Union européenne. Il suffit de lire la version consolidée du traité instituant la communauté européenne, en ligne sur le site de la Commission, pour constater que les politiques libérales étaient gravées dans le marbre des textes communautaires bien avant le projet de traité constitutionnel (TCUE) refusé par la France et les Pays-Bas en 2005.
Dans les principes de l'UE (Première partie), l'article 4 consacre l'économie de marché et le libre-échange en des termes équivalents à ceux utilisés par l'Organisation mondiale du commerce :
« L’action des États membres et de la Communauté comporte [...] l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des États membres, [...] conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. »
Ces principes ne s'appliquent pas simplement au marché intérieur. En effet, plus loin, l'article 131 du titre IX consacré à la politique commerciale précise qu'en établissant une union douanière entre eux, « les États membres entendent contribuer, conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières. »
Cet alignement des politiques économiques des États sur l'étalon libéral n'est pas optionnel. Il s'agit bien d'une obligation, comme le précise l'article 10 :
« Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité [...] Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. »
Ainsi, dès le dixième article d'un texte de plusieurs centaines de pages, la mise en œuvre d'une politique de gauche par un État membre est tout simplement interdite. Pour ceux qui n'en seraient pas convaincus, rendez-vous au chapitre 4 concernant les capitaux et les paiements. Les articles 56 et 57 sont explicites :
« [...] Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. » « L’unanimité est requise pour l’adoption de mesures [...] qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers » Autant dire que ce « pas en arrière » est concrètement impossible, puisqu'il supposerait l'accord des 27 États.
Bien-sûr, les États membres sont surveillés et sanctionnés en cas de non respect de ces exigences. « Le Conseil [...] surveille l’évolution économique dans chacun des États membres et dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations [des traités] » (Article 99). Si cette conformité n'est pas au rendez-vous, le Conseil adresse « les recommandations nécessaires à l’État membre concerné. » Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du Conseil, arrivent les sanctions, qui peuvent prendre la forme d'une révision des politiques de prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI), d'un dépôt obligatoire auprès de la Communauté en attente de la régularisation ou d'une amende « appropriée ».
Le Parlement européen peut-il mener des politiques de gauche?
La Commission, dont les membres sont nommés par les États et qui est censée penser et agir « européen », a le monopole des propositions législatives. Les règlements, qui s'imposent aux États et les directives, qui doivent être transcrites en droit national, proviennent exclusivement de la Commission. Cette dernière dispose également de tous les pouvoirs en matière de concurrence et ne se prive pas de les utiliser.
Même si le Parlement européen (PE) a vu ses compétences étendues au fil des traités, même s'il peut censurer la Commission, il ne dispose ni de l'initiative des lois, ni du dernier mot sur celles-ci. Contrairement à un Parlement traditionnel, le PE ne possède aucun pouvoir de contrôle du « gouvernement », puisque le Conseil n’est contrôlé par aucune assemblée. Or, c’est ce dernier qui adopte à la majorité qualifiée ou à l’unanimité les directives et les règlements de l’UE qui ensuite s’imposent à tous.
Il existe dans l'histoire un seul cas où le Parlement européen, dans le cadre de la procédure de la « codécision », a rejeté un projet de directive. Il s'agit de la directive de libéralisation des services portuaires refusée lors d'un vote en novembre 2003. Mais ce rejet est essentiellement du à une mobilisation massive des dockers, et rien ne garantit que la Commission ne revienne pas encore à la charge avec un nouveau projet de directive, puisque la libéralisation des services pour les soumettre à la concurrence est une logique inscrite dans les traités.
La plupart du temps, le Parlement est spectateur des véritables prises de décision, dont les modalités sont établies pour s'affranchir de la démocratie.
Mais le plus important reste que le PE ne dispose d'aucune compétence sur les traités. Dans la plupart des démocraties représentatives, les traités sont ratifiés par le Parlement. Or, dans le cadre de l’Union européenne, le Parlement est mis à l’écart de l'élaboration, de la révision ou de la dénonciation des traités, qu’il s’agisse de traités de l’Union européenne ou d’autres traités comme les accords internationaux en matière de commerce.
Il n'existe donc strictement aucune chance à court ou moyen terme que les traités ultralibéraux qui fondent l'Union européenne soient modifiés par voie parlementaire. Dans le meilleur des cas, le rôle du PE se limiterait à de la résistance, à condition toutefois qu'il dispose d'une majorité antilibérale, ce qui est loin d'être le cas.
Une majorité d'Etats peut-elle contrer la Commission ?
Supposons qu'une majorité d'Etats soit en désaccord avec les politiques européennes. Pourraient-ils infléchir le cours des avancées libérales de l'Union en s'appuyant sur le droit européen ? La réalité montre malheureusement que non.
Ainsi, sous la pression de leurs populations, les États européens sont majoritairement opposés à la mise en culture d'OGM sur leur territoire. Mais ce n'est pas suffisant. Pour rejeter une demande d'autorisation de cultiver une nouvelle variété d'OGM déposée par une multinationale, le Conseil des ministres doit obtenir une majorité qualifiée. Sans cette majorité qualifiée, qui n'est pour l'instant jamais obtenue, c'est à la Commission que revient de prendre la décision. Or, cette dernière tranche toujours en faveur des multinationales.
Marché commun oblige, une autorisation accordée est valable dans chaque pays de l'Union. Un pays ne pourrait activer une « clause de sauvegarde » qu'en apportant des preuves scientifiques irréfutables du danger immédiat que représente la culture d'OGM pour la santé ou l'environnement. Une étude scientifique étant toujours soumise à controverse, ces conditions ne sont concrètement jamais réunies, et les interdictions nationales toujours contestées par la Commission.
A l'origine, la directive 2001/18 qui encadre la dissémination des OGM soumettait l'autorisation au Conseil des ministres de l'environnement. Depuis 2003, la procédure a été modifiée, et ce sont les ministres en charge de l'agriculture, bien plus sensibles aux lobbies des biotechnologies, qui doivent se prononcer. A terme, la stratégie développée devrait aboutir à supprimer tout arbitrage politique pour confier à une instance scientifique – l'EFSA, Agence européenne de sécurité des aliments (totalement vouée aux firmes) -, le soin d'autoriser les OGM. On voit bien au travers de cette procédure jusqu'où peut aller l'hypocrisie européenne.
S'opposer à l'ultralibéralisme mis en œuvre par la Commission tout en respectant à la lettre le droit communautaire demanderait aux États une énergie incroyable, sans aucune chance de réussite dans la plupart des cas. L'échec sur le dossier des OGM, alors que les États les plus importants de l'Union partagent les mêmes positions, montre bien qu'il n'y a rien à attendre de ce côté.
La Cour de justice des communautés européennes peut elle faire autre chose que consolider le néo-libéralisme ?
La Cour de Luxembourg veille à l’application du droit européen. Compte tenu de la nature des traités, elle contribue inévitablement à consolider les valeurs fondatrices de l'Union, à savoir celles du néo-libéralisme. Ses arrêts, obligatoires, ne sont pas susceptibles de recours.
La Cour a instauré en 1964 le principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux. De plus en plus, le travail des parlementaires nationaux consiste à transposer des directives européennes. La privatisation de la Poste qui est en cours en France n'est que l'application de la directive européenne, dite « directive postale ». Le morcellement puis la privatisation progressive d'EDF n'est que la conséquence de la directive de libéralisation du marché de l'énergie, elle-même application directe des traités.
Jean-Luc Mélenchon déclarait dans une interview à l'Humanité que 80% du travail des députés français consiste à transposer des directives européennes. En fait le chiffre exact importe peu. La seule chose qui compte vraiment est que 100% du travail de ces mêmes parlementaires doit être totalement compatible avec le droit européen.
Plusieurs arrêts de la CJCE montrent bien quel est le sens de la marche, en légitimant le dumping social dans le marché communi.
Dans l’affaire Viking, jugée le 11 décembre 2007, une compagnie finlandaise réimmatricule un ferry en Estonie afin d’échapper à une convention collective finlandaise qui fixe les salaires des marins. La CJCE a donné tort aux syndicats qui s’opposaient à une telle manœuvre.
Dans l’affaire Laval, jugée le 18 décembre 2007, un syndicat suédois avait tenté, en organisant le blocus des chantiers de l’entreprise en Suède, de contraindre un prestataire de services letton à signer une convention collective comme c’est l’usage dans ce pays pour fixer les rémunérations des ouvriers. La CJCE a donné raison aux entreprises qui plaidaient une atteinte à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.
Dans l’affaire Rueffert, jugée le 3 avril 2008, la CJCE a condamné le Land de Basse-Saxe pour entrave à la liberté d’établissement d’une entreprise polonaise. Cette dernière versait des rémunérations inférieures au salaire minimum s’imposant à toute société de construction obtenant un marché public.
Dans l’affaire Commission contre Luxembourg, jugée le 19 juin 2008, la CJCE a donné raison à la Commission européenne, qui reprochait au Luxembourg d’avoir transcrit la directive de 1996 de manière trop restrictive en droit luxembourgeois. L’indexation des salaires sur le coût de la vie et les informations à fournir à l’inspection du travail ont été jugées « superfétatoires » par la cour.
La liberté d’établissement et la libre prestation de services sont donc des libertés fondamentales. Nul besoin pour cela du TCUE ou du Traité de Lisbonne : ces décisions de justice s'appuient bel et bien sur le traité de Rome, prouvant ainsi que la soumission des droits sociaux aux droits des entreprises est une caractéristique centrale de la construction européenne.
Les coopérations renforcées sont-elles des alternatives au libéralisme ?
Définie dans le traité de Maastricht, la « coopération renforcée » désigne un groupe de pays ayant décidé de renforcer leur action commune sur un sujet donné, sur le mode de la coopération intergouvernementale. Elle est possible dans les domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Des coopérations renforcées peuvent-elles permettre à un groupe de pays opposé aux avancées libérales de l'Union européenne de mettre en place des politiques de gauche ? Non, bien-sûr.
L'article 27 A du traité en vigueur stipule que « Les coopérations renforcées [...] ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent :
les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique,
les compétences de la Communauté européenne, et
la cohérence entre l’ensemble des politiques de l’Union et son action extérieure. »
L’article 280A du traité de Lisbonne, même s'il n’est pas encore en vigueur, est encore plus précis : « Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l’Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci. ». Aucune coopération renforcée ne peut donc être en rupture avec les politiques libérales si l'on accepte de se conformer au traité.
De toute évidence, le dispositif est donc bien verrouillé. L'Union européenne, telle qu'elle est et telle qu'elle le restera encore longtemps, interdit toute politique de gauche. Or, face à cette situation inacceptable, la gauche ne sait faire aujourd'hui que deux choses : renoncer à toute rupture ou donner des perspectives très lointaines de refonte des institutions communautaires qui ne laissent aucun espoir de changements à court terme.
B.- La gauche piégée par l'Union européenne
La gauche renonce à lutter vraiment contre l'eurolibéralisme
En juin 1972, le Parti communiste français (Georges Marchais), le Parti socialiste (François Mitterrand) et le Mouvement des radicaux de gauche (Robert Fabre) signaient le « Programme commun de gouvernement ». Voici un extrait du chapitre IV, « La France et la Communauté économique européenne » :
« Le gouvernement aura à l’égard de la CEE un double objectif :
* d’une part participer à la construction de la CEE, à ses institutions, à ses politiques communes avec la volonté d’agir en vue de la libérer de la domination du grand capital, de démocratiser ses institutions, de soutenir les revendications des travailleurs et d’orienter dans le sens de leurs intérêts les réalisations communautaires ;
* d’autre part de préserver au sein du marché commun sa liberté d’action pour la réalisation de son programme politique, économique et social.
En tout état de cause, le gouvernement gardera le droit d’invoquer les clauses de sauvegarde prévues par le traité de Rome. Il exercera le droit, du reste non limité par le traité, de définir et d’étendre le secteur public de l’économie sur son territoire. Il se réservera de définir et d’appliquer sa propre politique nationale du crédit et d’utiliser tous autres moyens propres à réaliser la planification démocratique nationale. Il sera responsable devant l’Assemblée nationale, comme dans tout autre domaine, de sa politique, des décisions que les représentants gouvernementaux prendront dans les organes de la Communauté. »
Presque 40 après, nous ne pouvons que constater le virage à 180 degrés accompli. Qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition, la Gauche « se couche » devant les injonctions de « Bruxelles », alors que l'Union européenne est pourtant bien plus libérale qu’à l'époque où fut écrit ce texte.
Le résultat est terrible du point de vue des politiques menées, puisque l'Union européenne pratique le néolibéralisme le plus débridé et l'impose aux Etats.
Mais il est également terrible – et peut-être encore plus – à cause du fatalisme qu'il génère. En effet, les citoyens comprennent très bien que toutes les politiques libérales subies dans les États membres proviennent de l'Union européenne ou s'y réfèrent. Les traités européens sont devenus la bible des gouvernements conservateurs, qui invoquent « L'Europe » pour justifier leur action. Mais ces mêmes traités constituent aussi l'excuse rêvée pour la social-démocratie, qui utilise « L'Europe » pour justifier son inaction.
Or, face à cette impasse, les partis de Gauche ne proposent qu'une perspective : changer l'Union européenne des 27 pour avoir ensuite – et ensuite seulement ! – le droit de mener des politiques de Gauche. En matière de fiscalité, par exemple, où règne la règle de l'unanimité, cela implique d'attendre que les 27 basculent à gauche pour s'engager dans une fiscalité socialement juste et écologiquement responsable.
La constituante européenne n'est pas une solution de court terme
Des personnalités politiques comme Cécile Duflot (secrétaire nationale des Verts) ou Jean-Luc Mélenchon (député européen Front de Gauche) ont proposé de donner un mandat constituant au Parlement européen afin de rédiger un nouveau traité d’organisation des pouvoirs.
Pour ce faire, il faudrait que les députés disposent d'une légitimité populaire, c'est à dire qu'ils aient été élus pour cela, et que cette élection n'affiche pas les taux d'abstention que nous connaissons actuellement.
Surtout, compte-tenu du rapport de forces très favorable au système – droite, socio-démocrates et chrétiens-démocrates –, ce Parlement érigé en constituante accoucherait d’une constitution forcément réactionnaire.
Pour que l'idée d'une constituante devienne envisageable, il faudrait non seulement voir émerger une notion de « peuple européen » qui n'a à l'heure actuelle aucune réalité, mais également assister à un changement politique majeur, avec un basculement du Parlement vers la gauche antilibérale. Autant dire que nous sommes encore très loin de cette éventualité et qu'il est impossible d'invoquer cette stratégie pour sortir de l'eurolibéralisme.
II.- QU'EST-CE QUE LA DESOBEISSANCE EUROPEENNE ?
Pour un gouvernement de gauche radicale qui serait élu dans un pays comme la France, il n'existe que deux options. Pas une de plus.
La première consisterait à se résigner à vivre dans une Europe libérale. Ce renoncement peut se dissimuler par un verbiage du type « Une autre Europe est possible » ou « changer l’Europe » sans qu’aucune mesure concrète ne soit envisagée pour mettre en accord ces grandes déclarations et la manière de les traduire en réalités. Mais attendre (jusqu’à quand ?) un changement radical d’orientation de l’Union européenne revient exactement au même, tant ce changement paraît absolument impossible. Il faudrait en effet que les 27 pays membres basculent tous à gauche et se mettent d’accord pour modifier les traités de façon radicale.
La seconde option est tout simplement de ne plus obéir aux injonctions néolibérales de l’Union. Bien évidemment, la seule solution acceptable est de s’affranchir des obligations communautaires. C'est ce que le M'PEP nomme la « désobéissance européenne ».
Concrètement, la désobéissance européenne comporte deux niveaux : un niveau défensif et un niveau offensif.
La désobéissance européenne défensive correspond à la nécessité, pour chaque pays qui le souhaite, de se protéger contre les politiques néolibérales de l’Union européenne.
Elle englobe :
- le refus de transposition de directives lorsque celles-ci sont contraires à l'intérêt général (par exemple, la directive 2001/18 sur les OGM, la directive postale...)
- la dénonciation de directives déjà transposées ou de règlements en vigueur (par exemple, la directive 96/92/CE "marché intérieur de l'électricité")
- le refus d’abonder le budget communautaire lorsque ces fonds sont utilisés pour mener des politiques libérales. Ainsi, dans le domaine crucial de l’agriculture, il est nécessaire de ne plus abonder le budget de la Politique agricole commune (PAC) tant que celle-ci aura pour objectif le développement de l’agriculture intensive.
La désobéissance européenne offensive correspond à la nécessité de ne plus seulement résister, mais d'inverser la tendance et de mettre en œuvre de politiques de gauche interdites par l'Union.
Cette désobéissance comprend :
- la construction d’un droit national socialement juste et protecteur de l’environnement, de l’industrie et des régimes sociaux, quitte pour ce faire à se mettre dans l’illégalité vis-à-vis du droit communautaire. Ceci comprend notamment la mise en œuvre de mesures fiscales redistributives, la fin de la libre-circulation des capitaux, l'instauration d'un protectionnisme écologique et social, un paquet législatif anti-délocalisation...
- Le refus de payer des astreintes en dépit des condamnations qui ne manqueront pas d’arriver de la part de l’Union.
- L'utilisation des fonds qui ne seront plus versés à l'Union européenne pour financer des politiques de gauche. Ainsi, dans le domaine de l'agriculture, les anciennes contributions au titre de la PAC seront mobilisés pour soutenir la conversion à une agriculture respectueuse de l’environnement, pour créer des emplois non-marchands notamment en zones rurales et pour développer des partenariats agricoles avec d’autres pays, États membres ou non, souhaitant s’engager dans des voies similaires.
La désobéissance européenne s’appuiera sur la souveraineté populaire et résultera de trois mécanismes démocratiques :
- Le principe de la désobéissance européenne doit être intégré aux programmes des partis politiques de gauche, accompagné de propositions concrètes. Comme ces programmes seront soumis aux électeurs, d’une part les élus de ces partis seront engagés, et d’autre part ils disposeront de toute la légitimité populaire pour agir conformément au programme sur lequel ils se seront faire élire.
- En cours de mandat, le Parlement sera amené à voter des lois. La désobéissance européenne serait doublement légitimée : par le peuple au travers des programmes électoraux sur lesquels il se sera prononcé, et par les députés, représentants du peuple.
- Enfin, en cas de crise ou de situation particulière, des référendums peuvent être organisés pour rejeter telle ou telle directive ou pour engager la France dans telle ou telle action. Comme la bataille avec les forces néolibérales sera permanente, la simple acceptation de la désobéissance européenne dans les programmes politique ne peut suffire. Rappelons ici que l’article 11 de la Constitution française stipule qu’il est possible de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. ».
Un exemple concret et immédiat de désobéissance européenne pourrait être de réformer le code des marchés publics en dépit des directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE qui le régissent.
Dans le cadre d'un programme de lutte contre le changement climatique, la France pourrait par exemple intégrer un critère de réduction des gaz à effet de serre dans la commande publique, qui deviendrait un critère de choix des offres et porterait sur toute la chaîne de chaque prestation. Cette mesure serait tout à fait efficace, puisqu'elle génèrerait notamment une forte baisse des besoins de transports. Elle serait d'autre part largement incitative puisque la commande publique, qui englobe les marchés de travaux, de biens et de services passés par l'Etat et par les collectivités locales, représente 240 milliards d'euros chaque année. Pourtant, un tel changement est totalement prohibé par l'Union européenne, puisqu'il constitue une entrave à la concurrence. Alors que l'Union prétend hypocritement être en pointe dans la lutte contre les dérèglements du climat, la priorité est toujours donnée au libre-échange. La désobéissance européenne sur cette question des marchés publics est indispensable pour mettre fin à cette situation. Très simple à mettre en œuvre, elle recevrait à n'en pas douter un large soutien populaire.
III.- CE QUE LA DESOBEISSANCE EUROPEENNE N'EST PAS
A.- La désobéissance européenne n'est pas la désobéissance civile
Même si le terme retenu renvoie volontairement à la notion de désobéissance civile, la désobéissance européenne ne pose pas les mêmes problèmes et n'apporte pas les mêmes réponses.
La désobéissance civile comprend quatre caractéristiques :
- l’opposition à l’ordre juridique représentant un pouvoir politique démocratiquement désigné. Contrairement aux actions de type révolutionnaire, elle se situe au sein du système juridique et vise à faire changer la loi.
- le positionnement de l’acte de désobéissance au sein de l’espace public. A la différence de l’objection de conscience, qui est individuelle, la désobéissance civile est collective et politique.
- le rattachement de l’acte de désobéissance à des valeurs éthiques. La désobéissance est « civile » si elle agit pour le bien de la cité.
- la volonté de participer à une transformation des valeurs et d’influencer le contenu des décisions publiques.
Néanmoins, en refusant l'ordre juridique et en renvoyant l'action à des valeurs éthiques, la désobéissance civile ouvre une boîte de Pandore. Où se trouve la limite « morale » entre une bonne et une mauvaise loi? Où se trouve la limite entre la désobéissance civile et le refus des principes de la République pour défendre des intérêts individuels?
Pendant des années, les faucheurs d'OGM ont revendiqué le droit à la désobéissance civile pour détruire les cultures transgéniques. Aussi légitime que soit ce combat, le fait de transgresser la loi n'est pas sans poser problème. Rapidement, des agriculteurs intensifs ont invoqué la désobéissance civile pour refuser de respecter les restrictions d'arrosage de leurs cultures... Cet exemple montre bien qu'il existe un risque de récupération de cette notion, et qu'au final, on risque de remplacer la loi, qui peut effectivement être injuste ou arbitraire, par l’arbitraire de la conscience.
A l'inverse, on peut être parfaitement légaliste et pratiquer la désobéissance européenne. Cette dernière ne remet pas en cause la force contraignante de la loi, mais remet seulement en cause un élément de hiérarchie du droit, à savoir la soumission des lois nationales au droit communautaire. Elle n'est pas sujette aux critique que l'on peut faire à la désobéissance civile, puisque la force contraignante de la loi nationale demeure entière.
D'autre part, contrairement à la désobéissance civile, la désobéissance européenne sera mise en œuvre par un gouvernement démocratiquement élu, alors que l’Union européenne produit un droit qui ne s’appuie à aucun moment sur une quelconque souveraineté populaire. La désobéissance européenne est donc une nécessité démocratique dont la légitimité sera totale, face à un droit communautaire illégitime.
B.- La désobéissance européenne n'est pas un repli sur les frontières nationales
Refuser le diktat de l'Union européenne n'est absolument pas synonyme de souverainisme ou de nationalisme. Ces accusations, qui sont utilisées systématiquement pour discréditer les opposants à la mondialisation néolibérale, sont tout bonnement ridicules. Contrairement à ce que les tenants du capitalisme véhiculent, et que des militants « altermondialistes » reprennent malheureusement, les concepts d'Etat ou de Nation ne sont pas dépassés.
Dans la période qui suit la seconde guerre mondiale, les institutions, les lois, les impôts ont incorporé progressivement des acquis démocratiques et sociaux dans de nombreux pays. Des services publics et des réglementations se sont développés. Bien-sûr, la peur de voir le socialisme gagner du terrain au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n’était pas pour rien dans ce compromis concédé aux travailleurs par les classes dirigeantes des pays industrialisés. Les États-Unis et les firmes transnationales dominaient déjà le monde capitaliste, mais les « États-nations » jouissaient d’une assez grande latitude pour définir leur politique économique et sociale.
Depuis les années 70, ce « compromis fordiste » et une politique économique « keynésienne » ont permis une nette amélioration des niveaux de vie et une certaine réduction des inégalités au sein de chaque pays. Mais ce compromis a été progressivement remis en cause avant d'être torpillé par la contre-révolution conservatrice des années 1980. Pour cette nouvelle politique de « mondialisation », les nations, les États, les services publics, les réglementations devenaient des obstacles à la « libre circulation » des capitaux et des marchandises.
La construction européenne est peut-être la preuve la plus criante de cette volonté de détruire la souveraineté populaire et de désarmer les États pour les empêcher de mener des politiques de gauche.
Faire le chemin inverse grâce à la désobéissance européenne est donc un moyen de reconquérir de la démocratie. Dès lors, si un État courageux décide de désobéir, il n'y a aucune raison pour que d'autres États ne procèdent pas de la même manière. Il deviendrait alors possible d'établir des alliances au sein de l’Union européenne pour des « coopérations renforcées » en rupture avec les politiques libérales. A terme, l'idée est bien de construire « une autre Europe », mais en agissant dès maintenant, sans attendre que l'Union européenne actuelle soit prête à sortir du néolibéralisme.
Plus largement, il faut réorienter la diplomatie et les alliances de la France sur la base, notamment, de la Charte de La Havane, qui repose sur la coopération commerciale internationale. Le contenu de la Charte de La Havane serait proposé à chaque pays membre de l’Union européenne, mais également à tous les autres pays dans le cadre de traités bilatéraux.
Élaborée en 1947 et 1948 par 53 pays, la Charte de la Havane devait déboucher sur une Organisation Internationale du Commerce (OIC), dans le cadre de l’ONU, en complément du FMI et de la Banque mondiale. Il s’agissait de reconstruire un ordre économique international cohérent après la Seconde Guerre mondiale. Cette OIC n’a jamais vu le jour car le Congrès américain, qui venait de changer de majorité, s’est opposé à sa ratification. Il estimait que les États-Unis devaient s’assurer une totale liberté pour écouler leur surplus de marchandises aux pays victimes de la guerre.
Les points les plus importants de la Charte de la Havane sont :
- L’article 1, qui en fixe les buts, indique clairement qu’il s’agit « d’atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies, particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement ». De même, l’article 2 précise que « la prévention du chômage et du sous-emploi est une condition nécessaire pour (…) le développement des échanges internationaux et par conséquent pour assurer le bien-être de tous les autres pays ».
- La recherche de l’équilibre de la balance des paiements (art. 3- 4- 21) est le principe essentiel de la Charte : « Aucun pays, à long terme ne peut fonctionner avec une balance déficitaire ». Le texte précise que « les États membres chercheront à éviter les mesures qui auraient pour effet de mettre en difficulté la balance des paiements des autres pays ». Tout ceci est à l’opposé de la concurrence effrénée pour la conquête des marchés et de la « priorité aux exportations » pratiquées dans le cadre de l’OMC et de l’UE. La Charte n’hésite pas à avoir recours à des mesures de protection, diabolisées par le néolibéralisme. Grâce à ce principe d’équilibre de la balance des paiements, le commerce international devient une pratique de coopération et non d’affrontement : c’est la fin de la guerre commerciale.
- Le contrôle des mouvements de capitaux (art. 12). Les investissements étrangers sont autorisés mais c’est à chaque État membre de déterminer s’il les « autorisera (…) et dans quelle mesure et à quelles conditions il les autorisera ». Chaque État membre pourra de plus prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires pour s’assurer que ces investissements étrangers « ne serviront pas de base à une ingérence dans ses affaires intérieures ou sa politique nationale ». L’application de ce texte aurait donc évité un certain nombre de pratiques bien connues actuellement : OPA, fusions et acquisitions transfrontalières…
- L’intervention de l'État est autorisée (art. 13, 14 et 15). L’article 13 propose que « les États membres reconnaissent que, pour faciliter l’établissement, le développement ou la reconstruction de certaines branches d’activité industrielle ou agricole, il peut être nécessaire de faire appel à une aide spéciale de l'État et que, dans certaines circonstances, l’octroi de cette aide sous forme de mesures de protection est justifié ». Les articles suivants énumèrent ces protections telles que subventions, contrôle des prix… Les accords préférentiels entre plusieurs pays sont même autorisés mais tout ceci se négociera dans le cadre de l’OIC entre tous les États concernés. Toutes ces mesures sont aux antipodes des idées du libre-échange qui s’acharne à supprimer tous les « obstacles » au développement du commerce et tout particulièrement les aides des États.
- L’interdiction du dumping (art. 26). Le dumping est interdit car « aucun État membre n’accordera directement ou indirectement de subvention à l’exportation d’un produit quelconque, n’établira ni ne maintiendra d’autre système, lorsque cette subvention ou ce système aurait pour résultat la vente de ce produit à l’exportation à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs du marché intérieur ». Son application aurait permis d’échapper à la disparition presque complète en France de secteurs économiques comme le textile, la chaussure, l’ameublement…
- La possibilité de « restrictions quantitatives » (art. 20). Tout en recommandant de les éliminer, la Charte les autorise dans des conditions très précises et sous le contrôle de l’OIC. Ici, les mesures de protection ne sont donc pas taboues mais strictement encadrées.
On le voit, il est tout à fait possible de pratiquer la désobéissance européenne sans s'isoler, et de construire un internationalisme qui s'appuie sur les souverainetés populaires. A l'inverse d'un hypothétique gouvernement mondial ou de nouvelles organisations internationales souhaitées par certains mondialistes (telle une Organisation mondiale de l'environnement dont il n'existe à ce jour pas la moindre base), ce nouvel internationalisme pourrait émerger rapidement.
IV.- LA DESOBEISSANCE EUROPEENNE, UNE NOTION PROFONDEMENT REPUBLICAINE
En visant la reconquête de la souveraineté populaire et l'utilisation du droit, la désobéissance européenne s'inscrit dans une approche fondamentalement républicaine.
D'une part, le républicanisme reconnaît un rôle essentiel à l'État comme garant de la non-domination. Alors que l'Union européenne assure la domination des grands pouvoirs économiques sur les peuples européens et que ses institutions sont verrouillées, la recherche de rupture ne peut se faire que du côté de l'État. Sans désobéissance européenne, cette reprise de pouvoir est impossible. Y renoncer, c'est abandonner purement et simplement les valeurs républicaines.
D'autre part, le républicanisme pose qu'une règle sociale (la loi) peut être génératrice de liberté. Avec la désobéissance européenne, il s'agit bien de cela : redonner au peuple, par le droit, une liberté qui fut confisquée par les institutions européennes.
En appelant à de nouvelles coopérations renforcées sur des bases antilibérales et à de nouvelles alliances internationales, la désobéissance européenne est également en phase avec l'universalisme républicain, qui considère que la liberté, l'égalité et la fraternité s'appliquent à tous les êtres humains et que la volonté librement exprimée d'un avenir commun prime sur les critères de langue, de religion ou d'origines ethniques ou géographiques.
V.- EN CONCLUSION : METTRE LES VRAIS DÉBATS SUR LA TABLE
Une analyse précise de la situation montre qu'il est totalement illusoire de vouloir mettre fin à l'eurolibéralisme sans se préparer à la désobéissance européenne. L'erreur fondamentale de la gauche radicale est de ne pas oser le dire, le revendiquer, le mettre en première ligne dans son programme. Prôner la désobéissance européenne est le seul moyen de redonner au citoyen l'espoir du changement à court ou moyen terme et de faire gagner à nouveau la gauche.
Nous connaissons déjà toutes les critiques que nous aurons à affronter : souverainisme, nationalisme, irresponsabilité, passéisme... Non seulement elles ne sont pas nouvelles, mais nous avons même tout intérêt à les subir pour mieux les démonter. Ce faisant, nous mettrons les vrais débats sur la table, et nous opposerons un à un nos arguments, qui sont ceux de la solidarité, de la justice, des valeurs de la République.
Intervention à la Fête de l'Humanité : « Quel programme ? Contre la présidentialisation, la 6e République »
Débat organisé par le Parti de Gauche - 11 septembre 2009, Avec Roger Martelli, débat animé par Pascale Le Neouannic, Conseillère Régionale Ile de France
Malgré l'intitulé du débat, je ne parlerai pas de sixième ni de cinquième république, mais bien de République tout court. En effet, puisque nous abordons le problème des institution, il nous faut d'abord soulever la question la plus taboue de toutes les questions politiques : est-il encore possible de parler de République dans le cadre des institutions européennes? Est-il encore possible de mener des politiques de gauche – la vraie gauche, celle que nous qualifions de radicale et républicaine – en respectant le droit communautaire?
Je ne vous ferai pas l'insulte de revenir sur les valeurs républicaines, que vous connaissez mieux que moi : la liberté, l'égalité, la fraternité, mais également l'universalisme, ou encore le fait de concevoir la loi comme le moyen de produire de l'émancipation et de la liberté. Puisque nous savons tous, au Parti de Gauche comme au M'PEP, que ces valeurs sont aux antipodes de celles de l'Union européenne, le problème qui nous est posé est simple. Pour une gauche radicale qui prétend gouverner, il n'existe que deux options. La première serait qu'elle renonce, une fois élue, au programme qu'elle s'était engagée à mettre en œuvre, au motif que le droit européen le lui interdit. La seconde serait qu'elle désobéisse à l'Union pour pouvoir gouverner. Il n'y a aucune autre alternative.
A l'époque où la gauche française n'était pas encore acquise à la social-démocratie, elle osait clairement choisir entre la question sociale et la question européenne. Dans son chapitre consacré à l'Europe, la programme commun de 1972 du Parti communiste français, du Parti socialiste et du Mouvement des radicaux de gauche indiquait : « Le gouvernement aura à l’égard de la Communauté économique européenne un double objectif. D’une part, participer à la construction de la CEE, à ses institutions, à ses politiques communes avec la volonté d’agir en vue de la libérer de la domination du grand capital, de démocratiser ses institutions, de soutenir les revendications des travailleurs et d’orienter dans le sens de leurs intérêts les réalisations communautaires ; d’autre part de préserver au sein du marché commun sa liberté d’action pour la réalisation de son programme politique, économique et social. »
Presque quarante ans plus tard, nous constatons qu'un virage à cent-quatre-vingt degrés a été pris. Qu'elle soit au pouvoir ou dans l'opposition, la gauche se couche devant les injonctions de « Bruxelles », alors que l'Union européenne est pourtant bien plus libérale qu’à l'époque où fut écrit ce texte.
Le résultat est terrible du point de vue des politiques menées, puisque l'Union européenne pratique le néolibéralisme le plus débridé et l'impose aux États.
Mais il est également terrible – et peut-être plus encore – à cause du fatalisme qu'il génère. En effet, les citoyens comprennent très bien que toutes les politiques libérales subies dans les États membres proviennent de l'Union européenne ou s'y réfèrent. Les traités européens sont devenus la bible des gouvernements conservateurs, qui invoquent « L'Europe » pour justifier leur action. Mais ces mêmes traités constituent aussi l'excuse rêvée pour la social-démocratie, qui utilise « L'Europe » pour justifier son inaction.
Or, face à cette impasse, les partis de gauche ne proposent qu'une perspective : changer l'Union européenne des 27 pour avoir ensuite, et ensuite seulement, le droit de mener des politiques de gauche.
Pourtant, un examen sérieux de la situation montre qu'il n'existe, de l'intérieur des institutions, strictement aucune perspective de changement rapide. Nous avons dit en 2005, au moment de la campagne sur le Traité constitutionnel européen, que son adoption « graverait dans le marbre » l'orientation ultralibérale de l'Union. Mais l'ultralibéralisme est déjà gravé dans le marbre du traité en vigueur ! C'est bien le Traité de Nice qui indique dans son article 131 que « les États membres entendent contribuer, conformément à l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières ». C'est ce même texte qui précise dans son article 56 que « Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites », rendant impossible une politique fiscale de gauche. Nul besoin d'attendre le Traité de Lisbonne pour que la Cour de justice des communautés européennes mette en pratique la casse des acquis sociaux, comme c'est le cas avec les arrêts Viking ou Laval.
Nous savons tous également que le rôle du Parlement européen se limite à un rôle d'observateur, dans le meilleur des cas de lanceur d'alerte, et ceci pour deux raisons. D'une part, la Commission conserve toujours et conservera l'exclusivité en matière de propositions législatives, et d'autre part, le Parlement est incompétent sur les Traités communautaires et les accords internationaux. Ce n'est pas un hasard s'il n'existe qu'un exemple dans l'histoire de mise en échec par le Parlement d'une proposition de directive – la directive portuaire – dans le cadre des procédures de co-décision. Et encore, ce rejet tient bien plus à la mobilisation déterminée des dockers qu'au volontarisme de l'assemblée élue pour représenter les peuples d'Europe.
L'affaire des OGM détruit quant à elle l'espoir qu'un groupe de pays puisse influencer les politiques européennes dans un sens moins libéral : alors qu'une majorité de citoyens et d'États membres souhaiterait interdire les cultures transgéniques, la Commission continue de les imposer au nom du libre-échange.
L'idée de Constituante, enfin, est une idée louable. Mais elle est surtout une proposition de très long terme, qui ne peut s'appuyer aujourd'hui sur aucune réalité. Non seulement le Parlement ne dispose pas de légitimité en la matière, en particulier du fait des taux d'abstention records aux scrutins qui permettent de l'élire, mais surtout, l'Union européenne ne pourrait accoucher en l'état des rapports de forces que d'une constitution ultralibérale.
Soyons donc lucides, et osons dire qu'aucune politique de gauche ne pourra respecter les orientations et le droit communautaire. Si nous voulons être crédibles, nous devons revendiquer haut et fort la désobéissance européenne, qui est un premier pas obligé pour sortir du capitalisme. Concrètement, cette stratégie comporte deux niveaux.
Le premier niveau est celui de la résistance. Il s'agit de refuser la transcription des directives et l'application de règlements ultralibéraux. Une gauche radicale au pouvoir pourrait-elle transcrire la directive postale, qui organise le démantèlement du service public? Bien-sûr que non. De la même manière, elle serait dans l'obligation de dénoncer des directives déjà transposées, comme la directive 96/92/CE « marché intérieur de l'électricité ». Enfin, il serait totalement aberrant de continuer à abonder le budget communautaire qui sert à mener des politiques avec lesquelles nous sommes en complet désaccord, à l'image de la Politique agricole commune.
Mais ce niveau défensif n'est pas suffisant. Notre objectif est bien de renverser la tendance et de poser les bases d'un tout autre modèle de société. Nous devrons construire un droit juste, émancipateur, protecteur de l'environnement, et il est absolument évident que ce droit ne sera pas compatible avec le droit communautaire. Et alors? Pourquoi en avoir peur? Au nom de quoi la désobéissance européenne serait-elle taboue alors qu'il s'agit du seul moyen de mettre fin à la libre-circulation des capitaux, d'instaurer un protectionnisme écologique et social, ou de voter un paquet législatif anti-délocalisations? Cette démarche de construction d'un nouveau droit suppose bien-sûr de refuser le paiement de la moindre astreinte qui viendrait la sanctionner et de réorienter les fonds qui ne seront plus versés à l'Union européenne pour financer des politiques de gauche et pour lancer notamment des coopérations renforcées sur des bases progressistes.
Pour ne prendre qu'un exemple concret et immédiat de désobéissance européenne nous pouvons citer la réforme du code des marchés publics. Dans le cadre d'un programme de lutte contre le changement climatique, la France pourrait intégrer un critère de réduction des gaz à effet de serre dans la commande publique, qui porterait sur toute la chaîne de chaque prestation et deviendrait un critère de choix des offres. Cette mesure serait tout à fait efficace, puisqu'elle générerait une forte baisse des besoins de transports et favoriserait les productions moins polluantes. Elle serait largement incitative puisque la commande publique, qui englobe les marchés de travaux, de biens et de services passés par l'État et par les collectivités locales, représente 240 milliards d'euros chaque année. Pourtant, un tel changement est totalement prohibé par l'Union européenne, puisqu'il constitue une entrave à la concurrence. Alors que l'Union prétend hypocritement être en pointe dans la lutte contre les dérèglements du climat, la priorité est toujours donnée au libre-échange. La désobéissance européenne sur cette question des marchés publics, régie par les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, est indispensable pour mettre fin à cette situation. Cette décision est non seulement très simple à mettre en œuvre, mais elle recevrait également un large soutien populaire.
Voici un exemple, pris parmi des dizaines d'autres, qui montre que la désobéissance européenne est une notion profondément républicaine. On peut la revendiquer en étant parfaitement légaliste, puisqu'elle ne remet pas en cause la force contraignante de la loi, mais vise à bousculer la hiérarchie du droit pour restaurer la souveraineté populaire. Le jour où la gauche osera la porter dans le débat public, l'inscrire sur ses banderoles et l'afficher dès les premières lignes de son programme, elle redeviendra victorieuse, puisqu'elle redonnera au citoyen ce qu'il a perdu : l'espoir d'un changement radical.
(Merci à Jean-Charles pour les photos )
Le grand tournant ? / L'état du monde 2010
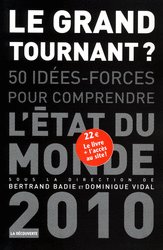
Rarement le monde a changé aussi rapidement autour de nous. En quelques mois, le président Barack Obama a marqué, au moins verbalement, la rupture avec son prédécesseur. Le krach financier s’est transformé en crise économique et sociale mondiale, montrant à quel point le temps de la souveraineté avait cédé la place à celui de l’interdépendance – même si la fragmentation et le « chacun pour soi » restaient la tentation suprême. La poussée de l’Inde et de la Chine, le retour de la Russie, les ambitions du Brésil et de l’Afrique du Sud éprouvent la volonté occidentale de renforcer son hégémonie. S’agit-il pour autant d’un « grand tournant » ? À travers 50 analyses, rédigées par les meilleurs spécialistes du champ international, L’État du monde 2010 éclaire cette question décisive pour l’avenir.
Inaugurée en 2008, la nouvelle formule de L’état du monde offre à tous les acheteurs du livre l’accès libre pour une durée d’un an aux contenus de son site l’Encyclopédie de L’état du monde < www.etatdumonde.com > (voir le cahier couleur au début du livre).
Véritable « roman de l’actualité mondiale », L’état du monde révèle, au-delà de la succession d’événements immédiate, la tonalité des changements à l’œuvre sur la planète, tandis que le site continue d’offrir toutes les ressources complémentaires de cette analyse : bilans annuels pour chaque État de la planète, tableaux statistiques, chronologies thématiques et continentales, etc.
Table des matières :
Avant-propos
Introduction. Crise dans la mondialisation, par Bertrand Badie
I. Nouvelles relations internationales
Obama, du hard power au soft power, par Sylvain Cypel
Une Chine plus puissante et mieux intégrée, par Jean-Luc Domenach
La Russie et son pouvoir à l’épreuve de la crise, par Jean Radvanyi
Réinventions stratégiques de l’« Occident » (1949-2009), par Olivier Zajec
Gouvernance régionale et crise mondiale, par Karoline Postel-Vinay
Ces guerres sanglantes du XXIe siècle, par Dominique Vidal
Faillite des think tanks américains ?, par Philippe Droz-Vincent
De nouvelles voies maritimes mondiales, par Didier Ortolland
Portrait : Dmitri Medvedev, « Yes, he can ? », par Andrei Gratchev
Les livres de l’année
Le « grand tournant » ?, par Pierre Grosser
II. Questions économiques et sociales
Économie mondiale : récession ou dépression ?, par Francisco Vergara
De la nature de la crise financière, par Akram Belkaïd
L’introuvable régulation de l’économie mondiale, par Jacques Le Cacheux
Vers un nouveau Bretton Woods ?, par Dominique Plihon
États en faillite : la fin du « miracle libéral », par Louis Gill
Les trois âges de la piraterie financière, par Jean de Maillard
Le bloc improbable des États émergents, par Michel Rainelli
Les grands enjeux énergétiques, par Nicolas Sarkis
Les nouveaux défis de la lutte contre la faim, par Damien Millet et Éric Toussaint
Les livres de l’année
La crise : récits, explications et solutions, par Christian Chavagneux
III. Sociétés et développement humain
Que reste-t-il des Objectifs du Millénaire ?, par Marcus Taylor
Les inégalités sociales dans les villes américaines, par Sophie Body-Gendrot
Revenus du travail, revenus du capital (1969-2009), par Alain Bihr et Roland Pfefferkorn
L’immigration en débat(s), par Catherine Wihtol de Wenden
Les transferts de fonds des migrants, facteur économique majeur, par El Mouhoub Mouhoud
Visages divers de l’islamisme politique, par Wendy Kristianasen
Portrait : Fernando Lugo, le président inattendu, par Pablo Stefanoni
IV. Environnement et nouvelles technologies
La lutte contre le changement climatique prisonnière de la finance, par Aurélien Bernier
Les réfugiés de l’environnement, par Donatien Garnier
Croissance verte et décroissance, par Agnès Sinaï
Les politiques énergétiques entre sécurité et défi climatique, par Patrick Criqui
Enjeux éthiques et juridiques de la brevetabilité du vivant, par Philippe Froguel et Gilles Pulvermuller
Internet et l'idéologie de la gratuité, par Serge Proulx et Anne Goldenberg
L’exploration spatiale : nouveaux horizons de recherche, par Claude Lafleur
La mégalomanie des nanotechnologies, par Dorothée Benoit Browaeys
Portrait : Ali Idrissa contre Areva, par Jean-Christophe Servant
V. Enjeux régionaux
L’Amérique latine n’est plus l'arrière-cour des États-Unis, par Jean Daudelin
Retour sur les relations russo-américaines, par Charles Urjewicz
Arc de crise en Asie du Sud-Ouest , par Max-Jean Zins
Du changement au Proche et Moyen-Orient ?, par Bernard Botiveau
Piège afghan pour l’Occident, par Syed Saleem Shahzad
L’Irak, sept ans après, par Hamit Bozarslan
L’ascension de l’Iran au Proche-Orient, par Alain Gresh
Enjeux régionaux et internationaux du « bouclier antimissile », par Georges Le Guelte
L’indépendance du Kosovo, précédent et boomerang, par Jean-Arnault Dérens
Contradictions et ambiguïtés sud-africaines, par Augusta Conchiglia
Darfour, les multiples facteurs d’un conflit complexe, par Jérôme Tubiana
L’Afrique et la communauté internationale face à la crise congolaise, par Jean-Claude Willame
Portrait : Javier Solana, de l’engagement antifranquiste au consensus euro-atlantique, par Frédéric Charillon
Le grand tournant ? / L'état du monde 2010
50 idées-forces pour comprendre
SOUS LA DIRECTION DE Bertrand BADIE, Dominique VIDAL
Commentaires
1. lucieboop83 le 18-09-2009 à 10:51:33 (site)
merci pour toutes ces précisions et informations , c'est un bon moyen de toucher le plus de monde !!
entièrement d'accord avec tout çà !! à 300/100 salut , à bientot !!
La décroissance : Taxe carbone, qui paiera?

- Quel est le principe de la taxe carbone telle qu'elle est définie par Michel Rocard pour le gouvernement ? Il s'agit de taxer les énergies fossiles en fonction des gaz à effet de serre qu'émettent leur combustion à hauteur de 32 euros par tonne de carbone dans un premier temps, puis d'accroître progressivement le niveau des prélèvements. Les factures de carburant, de gaz, de fuel et peut-être d'électricité, augmenteront donc à partir de 2010. Le gouvernement tente de faire passer la pilule en promettant un chèque « vert » sensé compenser la taxe pour les ménages les plus modestes.
- Quels peuvent être les effets pervers d'une telle taxe ? Est-elle une nouvelle mesure de greenwashing, de croissance verte ? Non, nous ne sommes plus dans le greenwashing ou la croissance verte. C'est bien pire : nous sommes dans l'écologie antisociale. En effet, les ménages les plus riches pourront se payer des voitures moins polluantes, installer des panneaux solaires ou se déplacer en train. Les plus modestes, par contre, ne pourront pas accéder à ce mode de vie « écologique ». Et ce ne sont pas simplement les tarifs du carburant et du chauffage qui vont augmenter, mais également les prix des produits et des services, qui utilisent eux aussi de l'énergie. Le « chèque vert » ne compensera jamais intégralement cette hausse.
Le plus scandaleux reste que les grands groupes industriels seront exonérés de taxe, puisqu'ils sont déjà assujettis au marché du carbone. Or, les droits à polluer leur sont alloués gratuitement par les États. S'ils manquent de quotas et doivent en acheter sur le marché, ils paient actuellement 14 euros la tonne, soit moins de la moitié de ce qui sera facturé au particulier.
Pour ne prendre qu'un exemple, à 32 euros la tonne de carbone, l'exonération de taxe représente un cadeau de 250 millions d'euros par an fait à Arcelor-Mittal. Ajoutons que la taxe carbone sera accompagnée d'une baisse des cotisations patronales, et le tableau est complet.
A présent, on comprend mieux l'intérêt du matraquage de films comme Home, avec son discours totalement dépolitisé : il s'agit, en pointant uniquement la responsabilité individuelle et jamais la responsabilité politico-économique, de faire accepter cette écologie antisociale.
- Peut-on taxer le carbone sans conforter les inégalités sociales ? Comment faire ? Bien-sûr que nous pourrions. Mais pour cela, il faut arrêter de prendre des mesures pseudo-écologiques toutes choses égales par ailleurs. Il est impossible d'exiger des comportements responsables de la part de chaque citoyen sans répartir autrement les richesses. Il faut sortir de cette écologie antisociale défendue par Sarkozy et par des imposteurs comme Cohn-Bendit. Augmenter les bas salaires et taxer le capital, puisqu'il s'agit bien de cela, suppose d'abord de casser le chantage aux délocalisations en mettant fin au libre-échange. La première revendication des écologistes doit être l'instauration d'un protectionnisme environnemental et social. C'est le seul moyen de relocaliser l'économie et donc d'exercer un contrôle démocratique non seulement sur la répartition des richesses, mais également sur les choix de production. Le jour où les mouvements sociaux et les partis de gauche porteront cette revendication, nous pourrons enfin espérer un profond changement de société.
Interview parue dans "La décroissance" de septembre 2009
Post-scriptum :
A ce jour (9 septembre), il semblerait que le montant de la taxe envisagé ne soit plus de 32 euros, mais de 14. Ceci n'enlève rien aux arguments que je développe. Le montant de la taxe est de toute façon amené à augmenter au fil des ans.
Commentaires
1. lucieboop83 le 18-09-2009 à 10:58:22 (site)
pourtant ce sont des sugets tres importants , et de temps en tant , il faudrait que les blogueurs , lachent un peu la légèreté , et le virtuel pour se plonger un peu plus dans cette réalité ,
qui nous conçerne tous , et , là , maintenant !! à plus tard !!
La taxe carbone, ou l'écologie antisociale

Article paru dans l'Humanité Dimanche du 27 août
Nous ne connaissons pas encore tous les détails de la mise en oeuvre de la future taxe carbone préparée par le gouvernement français, mais une chose est sûre : une nouvelle fois, les plus pauvres paieront à la place des vrais responsables de la crise écologique. Le principe est en effet de taxer les énergies fossiles en fonction des gaz à effet de serre qu'émettent leur combustion à hauteur de 32 euros par tonne de carbone dans un premier temps, puis d'accroître progressivement le niveau des prélèvements. Les factures de carburant, de gaz, de fuel et peut-être d'électricité, augmenteront donc à partir de 2010. Le gouvernement tente de faire passer la pilule en promettant un chèque « vert » censé compenser la taxe pour les ménages les plus modestes. Mais la ficelle est grosse. D'une part, cette compensation sera calculée sur les consommations directes d'énergie. Or, si le prix de l'énergie augmente, les prix des biens et des services augmenteront proportionnellement. Le chèque vert ne compensera jamais intégralement ces hausses. D'autre part, ce type de mesure peut prendre fin à tout moment. Aucune garantie n'a été donnée sur la pérennité de ce chèque, et nous pouvons parier qu'il sera de courte durée. Enfin, la baisse des cotisations patronales est déjà programmée, avec ses conséquences prévisibles : aucune embauche, aucune augmentation de salaire, mais une bénédiction pour les profits des grands groupes.
Pourtant, le scandale ne s'arrête pas là. Les principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans l'industrie sont déjà soumis au système des droits à polluer échangeables. Ils se voient allouer des quotas carbone qui peuvent être vendus et achetés en Bourse, la loi de l'offre et de la demande fixant le prix « optimum » pour la pollution. Or, les firmes en question seront exonérées de taxe carbone. Alors que le citoyen ou la PME paiera 32 euros à chaque tonne de carbone émise, ces grandes entreprises reçoivent leurs droits à polluer gratuitement. Par exemple, Arcelor-Mittal dispose d'environ 8 millions de quotas par an pour six usines implantées en France, ce qui équivaut à un droit à émettre gratuitement 8 millions de tonnes de carbone. A 32 euros la tonne, le cadeau fait à cette multinationale en l'exonérant de taxe carbone dépasse les 250 millions d'euros par an. Mais ce n'est pas tout. Si ces firmes manquent de droits à polluer, elle les achètent sur le marché où le prix actuel est d'environ 14 euros par tonne, soit moins de la moitié du tarif qui sera appliqué aux particuliers. Enfin, les grands groupes qui ont habilement su pratiquer le lobbying ont obtenu bien plus de quotas qu'il ne leur en fallait. Pour l'année 2008, Arcelor-Mittal disposait d'un excédent de droits à polluer d'un million de tonnes en France. Vendus sur le marché au comptant, ils représentent plus de 15 millions d'euros de bénéfices.
Voilà donc à quoi sert le discours dominant sur l'écologie qui culpabilise le citoyen et sensibilise au problèmes de la planète grâce aux images dépolitisées d'Arthus-Bertrand. A faire accepter des mesures totalement antisociales. L'imposteur Cohn-Bendit, en passe de devenir le meilleur porte-parole du gouvernement, applaudit des deux mains. Il ose même parler de « révolution ». Et tout laisse à penser que nous n'en sommes qu'au début. Grâce à l'argument de la concurrence internationale, les grandes firmes parviendront toujours à éviter la contrainte en Europe tout en redéployant leur activité dans les pays à bas coût de main d'oeuvre. A l'inverse, les petites ou moyennes entreprises et les populations paieront... jusqu'à l'explosion sociale qui pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense.
Pourtant, la taxe carbone n'est pas intrinsèquement mauvaise. Elle est comme tous les outils de fiscalité environnementale qui sont utilisés toutes choses égales par ailleurs : injuste et donc inacceptable. Il faut prendre le problème à l'envers. C'est une répartition équitable des richesses qui permettra de promouvoir ou d'exiger des comportements plus écologiques. Il faut taxer le capital et augmenter les revenus du travail avant de mettre en place des contraintes environnementales que les citoyens pourront alors assumer. Pour cela, l'objectif premier doit être de casser le chantage aux délocalisations et de reconstruire une économie locale capable d'amener le plein emploi. Il existe un outil qui permettrait d'y parvenir : le protectionnisme écologique et social. Mais les dizaines d'articles parus récemment dans les médias sur la future taxe carbone ne présentent jamais cette mesure comme un préalable à tout véritable programme de protection de l'environnement. A regarder les profits de multinationales comme Arcelor-Mittal, on comprend très bien pourquoi.
Post-scriptum :
A ce jour (9 septembre), il semblerait que le montant de la taxe envisagé ne soit plus de 32 euros, mais de 14. Ceci n'enlève rien aux arguments que je développe. Le montant de la taxe est de toute façon amené à augmenter au fil des ans.
Commentaires
1. lucieboop83 le 18-09-2009 à 10:52:46 (site)
domage , il manque des commentaires , je viendrai , car on en sait jamais assez !! merci pour tout !!

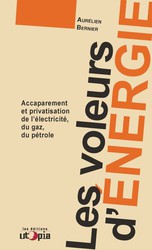
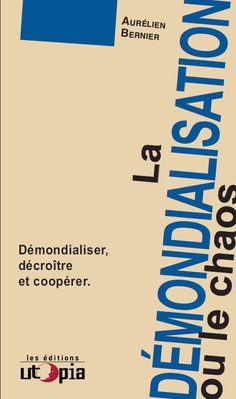
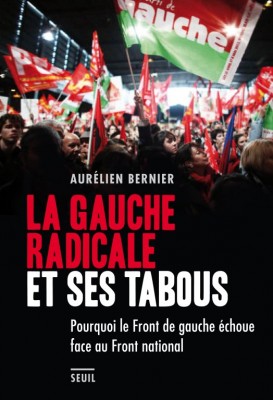



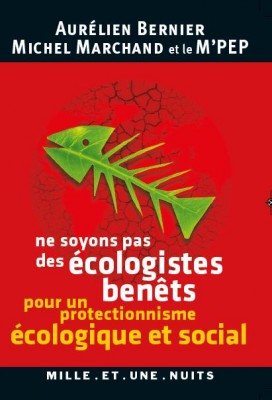
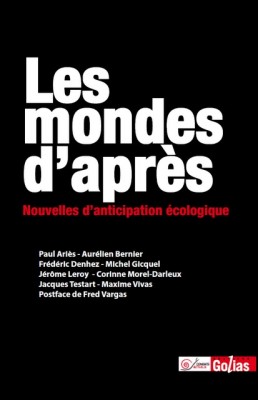







Commentaires