
Je souhaiterais commencer cette courte intervention par une citation dont vous pouvez essayer de trouver vous-mêmes l'auteur. Mais je vous préviens que ce jeu n'est pas facile. La voici.
« L'industrialisation "sauvage" qui accumule les nuisances, l'urbanisation hors d'échelle qui disloque les communautés, ne répondent plus aux aspirations et aux nécessités du temps présent. Le moment est venu de définir une nouvelle croissance. » [...]
« J'insiste, en effet, depuis plusieurs années, et dans diverses circonstances, sur la nécessité d'une croissance différente, plus humaine et plus économe. Cette nouvelle croissance n'est pas seulement un concept, un sujet de réflexion ou de rêve, elle peut se dessiner concrètement. En matiere d'environnement, elle signifie d'abord une "croissance zéro" de la pollution. » [...]
« Aux indices économiques traditionnels qui mesurent exclusivement l'expansion de la production marchande, il conviendra d'ajouter d'autres critères qui traduisent aussi les changements du cadre de vie et qui ne sont a l'heure actuelle recensés dans aucun de nos éléments statistiques. Dans le monde de demain, l'augmentation des espaces verts publics, la plus grande pureté de l'air et de l'eau, le recul des accidents du travail ou de la route devront être des signes mesurables et mesurés de progrès. »
Ce texte n'est pas extrait d'un article du Sarkophage, le journal de Paul Ariès, ni du dernier numéro du mensuel Fakir qui comporte un très bon dossier sur la décroissance.
Il ne provient pas non plus du livret du Front de gauche sur la planification écologique.
Non, il date du 29 octobre 1975 et fut prononcé par le Président de la République française Valéry Giscard d'Estaing.
Ceci montre à quel point la récupération de l'écologie par les classes dirigeantes n'est pas une chose nouvelle.
Je rappelle dans mon livre que bien d'autres s'y sont essayés avec plus ou moins de succès : Georges Pompidou, Margaret Thatcher (qui devint à la fin des années 1980 une grande prêtresse du trou dans la couche d'ozone et du changement climatique), Jacques Chirac au Sommet de la Terre de Johannesburg (« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ») et bien-sûr le président déchu Nicolas Sarkozy avec son Grenelle de l'environnement.
Ce mouvement de récupération date précisément de 1970 et débute aux Etats-Unis.
Le 22 avril de cette année, la première Journée de la Terre réunit plus de 20 millions de citoyens autour d'initiatives diverses : manifestations, conférences, colloques, fêtes.
Durant la préparation de cet événement, certaines multinationales comprennent qu'il se joue là quelque chose d'important.
Elles décident de changer de stratégie : alors qu'elles niaient l'existence des problèmes écologiques dans les années 1950 et 1960, elle choisissent de rejoindre le mouvement et de s'autodéclarer acteurs de la protection de l'environnement.
C'est le cas de Monsanto, Ford ou Dow Chemical, qui montent leurs propres événements pour cette Journée de la Terre.
Il s'agit certes d'une première manoeuvre grossière.
Mais la récupération de l'écologie se poursuit d'une façon bien plus insidieuse et dangereuse.
Les grandes puissances économiques comprennent que la question environnementale risque de contrarier leur projet du moment : instaurer un système de libre échange le plus large possible au sein du monde non-communiste, avec une libre circulation des marchandises, des services et des capitaux.
C'est ce que l'on nommera plus tard la mondialisation, qui commence à s'organiser effectivement dès le milieu des années 1960 aux Etats-Unis et dans les années 1970 en Europe.
Pourquoi le libre échange est-il si important ?
Premièrement parce qu'il ouvre de nouveaux marchés et permet de poursuivre l'expansion du capitalisme tout en limitant les risques de surproduction.
Deuxièmement, parce qu'il permet de s'approvisionner en matières premières et en main d'oeuvre à bas prix dans les pays du Sud dans une logique tout à fait néocoloniale.
Troisièmement, parce qu'il met en concurrence, grâce au chantage aux délocalisations et aux fuites de capitaux, les régimes sociaux, les normes, les fiscalités du Nord avec ceux du Sud.
Grâce à un puissant lobbying, les multinationales occidentales et les dirigeants politiques qui les soutiennent obtiennent que le libre échange soit sanctuarisé.
Dès le premier Sommet de la Terre, qui se tient en 1972 à Rio, la messe est dite : la déclaration finale stipule que « tous les pays […] acceptent de ne pas invoquer leur souci de protéger l’environnement comme prétexte pour appliquer une politique discriminatoire ou réduire l’accès à leur marché. »
La suite de l'histoire est mieux connue.
Au début des années 1980, après le tournant ultralibéral « Reagan, Thatcher, Kohl, Delors », l'environnement disparaît des agendas politiques.
L'heure est au démantèlement de la souveraineté populaire, à la dérégulation, au libre échange débridé.
Il y revient en 1987, avec le fameux Rapport Brundtland, qui consacre la notion de « développement durable ».
Dès le départ, ce développement durable est en fait l'adaptation des politiques environnementales au tournant ultralibéral : on y affirme le besoin de croissance économique et de croissance du commerce international (donc de libre échange), on y appelle aux coopérations public-privé, on place l'individu au centre de la responsabilité environnementale en dédouanant les entreprises.
Une anecdote au passage : qui se souvient que la rédactrice du rapport sur le développement durable, Madame Brundtland, ancienne Premier ministre de Norvège, a négocié avec Jacques Delors pour que les conditions du grand marché européen de l'Acte unique s'appliquent aussi en Norvège, alors que le peuple avait dit « non », par référendum, à l'entrée dans l'Union européenne ?
Sociale-démocrate et libre-échangiste convaincue, Madame Brundtland ne pouvait pas imaginer de solution à la crise ailleurs que dans le cadre étroit des marchés et de la libre concurrence.
Ce développement durable restera au coeur des discours des Etats et des firmes multinationales durant une quinzaine d'années.
Puis, au début des années 2000, avec la crise climatique, mais surtout avec l'augmentation du prix des énergies fossiles, nous entrons dans une nouvelle ère : celle du capitalisme « vert ».
La planète est suffisamment dégradée pour que certaines technologies dites « propres » deviennent rentables, et les grandes multinationales se jettent sur ce créneau porteur, grassement subventionné par les collectivités.
On invente même un marché des droits à polluer, qui ouvre un nouveau créneau spéculatif, avec des « fonds carbone », des produits dérivés et structurés... de quoi reproduire dans quelques temps la crise des subprimes de septembre 2008.
Évidemment, tout cela entraîne des contestations, mais de natures très diverses.
La dénonciation du « capitalisme vert » se pratique aussi bien au Front de gauche que chez Europe Ecologie, et même au Parti socialiste, car elle n'engage pas à grand chose.
Le Front de gauche et Europe Ecologie partagent aussi la volonté de sortir du productivisme, qu'il faut bien comprendre comme étant le fait d'organiser la société autour d'un objectif d'augmentation de la production, et non de satisfaction des besoins sociaux.
Mais un sérieux problème se pose dès que l'on aborde le coeur du sujet, à savoir le capitalisme et sa stratégie d'expansion actuelle, le libre échange.
Certains écologistes, aveuglés par leur haine de l'État et leur culture libérale-libertaire, n'ont pas compris ce qu'était vraiment la mondialisation.
Sa pire conséquence n'est pas de déplacer la pollution et l'exploitation des travailleurs dans les pays du Sud, ce qui est déjà insupportable en soi, mais bien d'empêcher la mise en place de toute réglementation sociale ou environnementale contraignante pour le patronat, y compris au Nord.
L'ennemi numéro un, c'est donc le libre échange, car c'est lui qui nous empêcherait, par le chantage aux délocalisations et à la fuite de capitaux, de mettre en oeuvre tout le reste de notre programme.
C'est pour cette raison que l'écologie n'est pas un projet politique.
Il existe en effet une écologie compatible avec le marché ; celle du capitalisme vert, qui lui, est un projet politique, ou celle de la sociale-démocratie.
Et il existe « notre » écologie, que l'on peut qualifier de « radicale » ou d'écosocialiste, peu importe, qui est un tout autre projet politique.
Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de constater que l'Histoire nous fournit un cadre pour cette écologie radicale, d'autant plus pertinent qu'il a été élaboré par des représentants de pays du Sud.
En octobre 1974, des intellectuels sont réunis sous l'égide de l'ONU dans la ville mexicaine de Cocoyoc pour débattre de « L'utilisation des ressources, de l'environnement et des stratégies de développement ».
Plusieurs pays non alignés, mais qui mettent en oeuvre des politiques socialistes (Sri Lanka, Mexique, Tanzanie...) sont représentés.
A l'issue de leurs échanges, les experts publient une déclaration qui dénonce fermement un ordre économique international basé sur l'exploitation des pays du Sud et qui est le premier responsable de la dégradation de l'environnement.
Ils proposent une marche à suivre pour les pays qui veulent s'en émanciper, basée sur quatre grandes idées :
Premièrement, la souveraineté nationale. Les Etats doivent récupérer la pleine maîtrise de leurs ressources naturelles. Ils doivent s'allier, en suivant l'exemple des pays producteurs de pétrole (OPEP), pour réguler la production et négocier des prix de vente décents. Une Nation doit pouvoir être autonome, un mot qui revient en permanence dans la déclaration.
Deuxièmement, la souveraineté populaire, qui est la souveraineté nationale exercée dans un cadre démocratique, dans l'intérêt des peuples et non d'une classe dirigeante. Aucune confusion possible avec un repli sur les frontières nationales pour préserver les intérêts capitalistes.
Troisièmement, la rupture avec l'ordre économique mondial, c'est à dire (même si ces mots ne figurent pas dans la déclaration pour des raisons diplomatiques) la sortie du capitalisme et du libre échange.
Quatrièmement, l'internationalisme, c'est à dire la coopération entre Etats ayant retrouvé leur souveraineté nationale et populaire, notamment pour gérer ensemble les ressources naturelles et répondre aux problèmes environnementaux.
Cette déclaration de Cocoyoc, qui est le premier texte officiel que l'on peut qualifier d'écosocialiste, est à mes yeux le texte le plus important de l'histoire de l'écologie politique.
Pourtant, il ne figure nulle part, ni sur le site des Nations unies, ni dans la littérature très abondante sur l'écologie politique (à part dans mon dernier livre !).
Or, ce que nous disaient les pays du Sud il y a près de quarante ans est primordial pour notre combat actuel, en 2012.
Appliquer aujourd'hui les principes de la déclaration de Cocoyoc signifierait sortir de l'Organisation mondiale du commerce, désobéir à l'Union européenne, mettre en place un protectionnisme écologique et social, restaurer la souveraineté monétaire, contrôler les mouvements de capitaux...
Finalement, les intellectuels de Cocoyoc avaient inventé dès 1974 un concept qui trouverait son nom bien plus tard : la démondialisation.

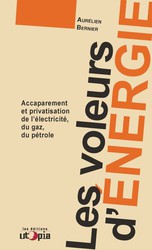
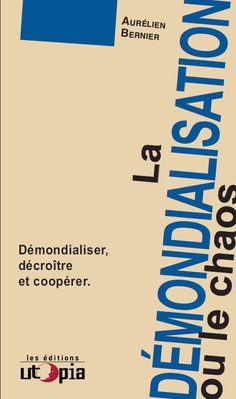
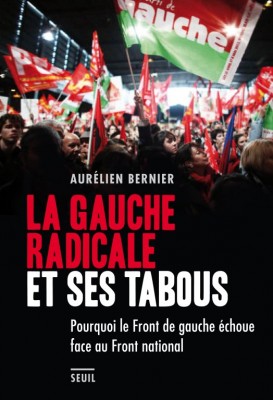



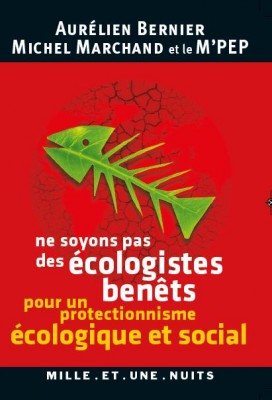
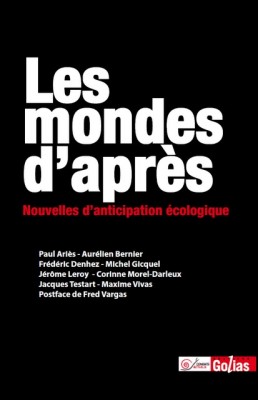



Commentaires