Juin 2007. Le président équatorien Rafael Correa, élu le 26 novembre 2006, annonce le lancement d’une démarche qualifiée de « révolutionnaire » : le projet Yasuní-ITT. Celui-ci prévoit que l’Equateur renoncera à l’exploitation pétrolière au cœur du parc naturel de Yasuní — où ont déjà lieu trois forages d’exploration (Ishpingo, Tambococha et Tiputini, d’où l’abréviation ITT) — si la « communauté internationale » accepte de verser au pays un dédommagement correspondant à la moitié des recettes attendues, estimées à plus de 7 milliards de dollars sur treize ans. Les fonds ainsi collectés permettront à Quito de développer les énergies renouvelables, de préserver et réparer les écosystèmes tout en protégeant les populations indigènes (dont certaines vivent en isolement total), de mener des recherches sur la valorisation de la biodiversité, ou encore de bâtir des programmes sociaux destinés en priorité aux populations des zones concernées.
A première vue, le projet Yasuní a tout de l’idée géniale. Alors que les négociations internationales sur le climat et la biodiversité s’enlisent, il éviterait d’émettre les quatre cents millions de tonnes de dioxyde de carbone correspondant à l’exploitation de ces ressources, tout en préservant l’un des écosystèmes les plus riches de la planète. Sans rompre avec la logique de « valorisation », et donc de marchandisation, de la nature, il s’oppose malgré tout au productivisme néolibéral : dans un pays pauvre et dépendant des activités pétrolières, il amorcerait une conversion écologique et sociale de l’économie. Mais, derrière l’image idyllique, les difficultés sont nombreuses.
Et le pétrole restera sous terre
Ancien ministre de l’économie, M. Correa met en œuvre une politique proche de celle du président vénézuélien Hugo Chávez : nationalisations, mesures sociales et adoption d’une nouvelle Constitution favorable aux plus pauvres. Il décide également de réduire le service de la dette, à la suite d’un audit dénonçant l’illégitimité d’une grande partie du fardeau (lire « La dette, quelle dette ? »). Le chômage baisse, les salaires du secteur public augmentent et le pays s’émancipe de la tutelle des organisations internationales ; mais une tentative de coup d’Etat, en septembre 2010, rappelle l’extrême fragilité de cette « révolution citoyenne ». Les relations de M. Correa avec les populations indigènes, et notamment avec la puissante Confédération des nationalités indigènes d’Equateur (Conaie), sont tendues. Parmi les mouvements amérindiens, certains critiquent les politiques extractives du gouvernement, qui mettent en péril leur habitat ; d’autres s’inquiètent des tentatives d’interdire certaines traditions jugées peu compatibles avec la reconstruction de l’Etat équatorien (telles certaines pratiques de justice coutumière qui légitiment parfois le lynchage).
Dans la géopolitique équatorienne, le pétrole occupe une place essentielle. Pour l’Etat, il constitue une ressource indispensable au financement des programmes sociaux (en 2008, la rente pétrolière représentait la moitié de son budget général), en même temps qu’il maintient le pays sous la dépendance d’entreprises étrangères (lesquelles contrôlent plus de 40 % de l’extraction) et du marché américain. Pour les populations indigènes, il est parfois l’unique source d’emploi. Mais il engendre également désastres écologiques et sanitaires, ainsi que des pratiques néocoloniales imposées par l’industrie extractive. Le groupe militant Acción Ecológica s’y attaque frontalement et se bat de longue date pour une interdiction des nouveaux forages. En février 2011, la condamnation pour pollution de la compagnie pétrolière Chevron (plus de 18 milliards de dollars !), confirmée un an plus tard en appel, a représenté une grande victoire.
Dès la formation du gouvernement Correa, la question de l’exploitation pétrolière provoque des affrontements au sommet de l’Etat. En l’espace de dix ans, l’idée d’un moratoire et d’une société postpétrolière a germé dans la mouvance intellectuelle de gauche, dont l’un des porte-parole est l’économiste Alberto Acosta. Devenu ministre de l’énergie et des mines en 2007, il finalise le projet Yasuní, dont les bases étaient jetées avant l’arrivée au pouvoir de M. Correa. Face à lui, l’entreprise étatique EP Petroecuador cherche au contraire à convaincre le gouvernement qu’il faut exploiter de toute urgence le pétrole du parc naturel. Avec l’augmentation du prix du baril sur le marché mondial (de 60 dollars au début de 2007 à plus de 100 dollars en 2012), les gisements ITT, particulièrement difficiles d’accès, offrent de nouvelles perspectives de rentabilité.
Le président doit donc choisir entre un moyen rapide mais destructeur de financer son programme politique et la satisfaction des revendications écologistes et indigènes. A l’issue de débats tendus, il tranche de façon habile : l’Equateur laissera le pétrole sous terre en échange d’une compensation financière. Ce faisant, il transfère la responsabilité de l’exploitation ou non des gisements à la « communauté internationale ». Approuvé durant l’été 2008, le projet Yasuní est présenté au sommet de Copenhague sur le climat en décembre 2009. Après une passe d’armes avec les Nations unies, M. Correa obtient la création d’un fonds fiduciaire directement géré par l’Equateur. Le 3 août 2010, celui-ci est opérationnel. Le gouvernement se fixe l’objectif de réunir 100 millions de dollars avant le 31 décembre 2011 et multiplie les déplacements dans les pays occidentaux pour y défendre sa cause.
Un succès plus que mitigé
Mais, rapidement, le manque d’enthousiasme des donateurs potentiels suscite des inquiétudes. Seuls quelques pays s’engagent à verser de l’argent : Espagne, Allemagne, Italie... Vingt mois après l’ouverture du fonds, le total des virements effectués n’est pas à la hauteur des espoirs. L’Espagne — où il existe une importante communauté équatorienne — est le seul pays occidental à avoir effectivement contribué, pour un montant de 1,4 million de dollars. Deux collectivités territoriales françaises (la région Rhône-Alpes et le département de Meurthe-et-Moselle) ainsi que quelques pays qui ne figurent pas parmi les plus gros pollueurs ou les plus riches (Chili, Colombie, Géorgie, Turquie) ont également abondé le fonds pour des montants compris entre 50 000 et 200 000 dollars chacun. D’autres promesses, comme celle faite par la Wallonie, ne se concrétisent pas. Après plusieurs annonces contradictoires, l’Allemagne choisit une voie différente de « soutien », en privilégiant une coopération bilatérale qui lui garantit des investissements profitables.
L’engagement le plus important ? Peut-être l’italien... qui prend la forme non pas d’un don, mais d’une annulation de dette externe de 51 millions de dollars. Derrière l’effet d’annonce, au beau milieu d’une crise de la dette particulièrement sévère en Italie, difficile de connaître le véritable poids de l’initiative Yasuní dans la décision de Rome : en 2006, la Norvège n’avait pas eu besoin de l’argument écologique pour annuler, sous la pression des associations, 20 millions de dollars de créances détenues sur l’Equateur. Faute de mieux, Quito accepte ces contributions multiformes et considère comme atteint l’objectif de collecter 100 millions de dollars fin 2011. Le compteur du fonds, lui, reste néanmoins bloqué à 3 millions de dollars.
On aurait pu croire que les organisations non gouvernementales (ONG) seraient plus motivées que les Etats. Il n’en est rien. Sur les sites Internet des grandes associations environnementalistes, les moteurs de recherche ne répondent pas au mot-clé « Yasuní ». Qu’il s’agisse du Fonds mondial pour la nature (World Wide Fund for Nature, WWF), de Greenpeace ou des Amis de la Terre, aucune structure n’a adopté de position officielle sur ce dossier. Officieusement, elles sont partagées. Greenpeace apprécie la proposition de non-extraction du pétrole, mais ne soutient, par principe, aucun projet gouvernemental. Les Amis de la Terre sont également sensibles à ce moyen d’éviter d’émettre des gaz à effet de serre et à la préservation de la biodiversité, tout autant qu’au respect des droits indigènes, mais ils craignent que Yasuní ne légitime le « chantage écologique ». Pour M. Sylvain Angerand, chargé de la campagne sur les forêts tropicales, « il faut un véritable débat sur Yasuní. Laisser le pétrole sous terre est une bonne chose. Mais solder la dette écologique que les pays du Nord ont contractée vis-à-vis des pays du Sud n’implique pas forcément un remboursement financier ». Par ailleurs, tout comme une partie des indigènes, l’association critique les politiques extractives de l’Equateur, qui restent intensives.
Lancée en 2010 par des ONG équatoriennes, la pétition internationale de soutien à Yasuní a reçu, en Europe, les signatures de responsables de l’Association pour une taxation des transactions financières et pour l’aide aux citoyens (Attac), du Front de gauche, du Nouveau Parti anticapitaliste, de Die Linke et de nombreux députés européens écologistes (1). Mais seul le Parti de gauche français s’intéresse réellement à un projet qui entre dans sa conception de la « planification écologique ». Les dirigeants des Verts, qui aimeraient soutenir Yasuní sans avoir l’air de soutenir le gouvernement Correa, jugé trop proche du « populisme à la Chávez » qu’ils dénoncent (2), demeurent simples signataires.
Depuis son lancement, le projet se heurte à d’innombrables difficultés. La crise financière de l’automne 2008 et l’échec du sommet de Copenhague en 2009 ont presque achevé des négociations internationales sur le changement climatique déjà mal en point. Les Nations unies concentrent leurs efforts sur l’adoption d’un dispositif de lutte contre la déforestation, baptisé REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation), qui doit faire largement appel au secteur privé, aux marchés du carbone, et dont les mécanismes de décision resteraient aux mains des grands Etats. L’intrusion du projet Yasuní dans les débats n’est pas du goût des pays développés, et l’austérité budgétaire est un bon prétexte pour l’évacuer poliment. Mais sans doute les pays riches craignent-ils plus que tout l’effet d’entraînement que pourrait avoir la démarche équatorienne : accepter de financer Yasuní, c’est ouvrir la porte à des centaines de projets de même nature portés par des pays du Sud qui réclameraient le même traitement.
Dans ce contexte hostile, l’Equateur se tourne vers les entreprises, avec l’espoir qu’elles se montrent plus généreuses que les Etats. Outre qu’elle s’annonce très incertaine, cette solution présente des risques réels de récupération. Les donateurs bénéficieraient en contrepartie d’un « marketing d’affinité », c’est-à-dire de droits d’utilisation de la marque Yasuní pour la commercialisation de produits (3). On frémit à l’idée de voir des constructeurs automobiles ou de grands énergéticiens arborer le logo officiel de l’initiative, « Produit Yasuní — Créer un monde nouveau »... Mais le gouvernement Correa pourrait emprunter une voie encore plus dangereuse, envisagée au lancement du projet : l’intégration au marché du carbone. Les « certificats de garantie Yasuní » émis en échange des contributions financières seraient alors convertis en crédits carbone qui viendraient compenser les rejets de gaz à effet de serre des pays riches ou des multinationales (4). Si cette option semble pour l’instant écartée, rien ne dit qu’elle ne pourrait pas resurgir en dernier recours.
Au-delà des schémas préconçus
La conversion écologique d’un petit pays pauvre comme l’Equateur n’a rien d’évident. Les chances de réussite de l’initiative Yasuní sont minces, et l’objectif premier de M. Correa consiste probablement à maintenir le projet en vie jusqu’aux prochaines élections nationales, en 2013. Difficile en effet de donner des signes d’affaiblissement alors que la Conaie, favorable à Yasuní, organisait en mars 2012 une grande marche sur la capitale pour « dire non à l’exploitation minière à grande échelle dans le pays » et défier le gouvernement. Mais en l’absence de perspectives de financements nouveaux, on voit mal comment la diplomatie équatorienne pourrait continuer à faire preuve d’autant d’optimisme qu’aujourd’hui.
Paradoxalement les commentaires sur le projet Yasuní et son lot d’incertitudes tendent à masquer les autres succès, encore fragiles mais bien réels, de la « révolution citoyenne » menée par M. Correa. Pour des mouvements verts ou altermondialistes occidentaux friands de symboles, l’initiative correspond à des schémas préconçus : un peuple indigène qui serait écologiste par nature (5) ; des énergies fossiles forcément mauvaises qui entraveraient le développement d’énergies renouvelables forcément bonnes ; des enjeux environnementaux qui seraient susceptibles, comme par magie, de transcender les clivages politiques... Qui plus est, elle entre en résonance en Europe avec des luttes locales, comme celles que mènent les mouvements d’opposition à l’extraction des gaz de schiste. Il est donc tentant de s’en faire une vision simple, voire simpliste. Pourtant, il est impossible de déconnecter le projet Yasuní du processus révolutionnaire en cours en Equateur, un processus qui doit composer avec une réalité sociale, économique, avec des rapports de forces délicats ; bref, à l’image de l’écologie politique, une idée simple dans un jeu complexe.

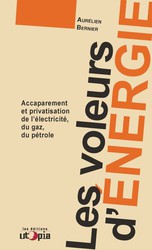
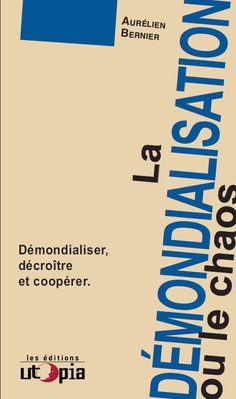
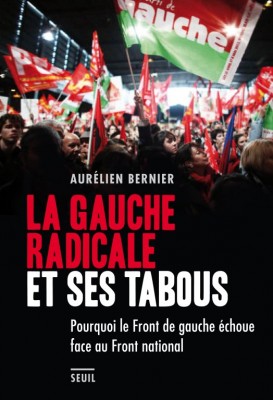



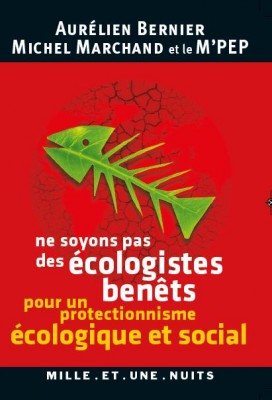
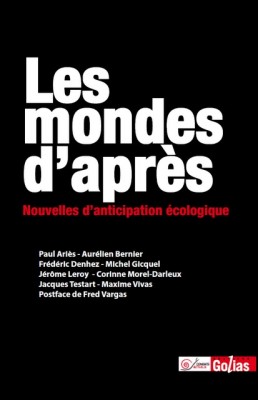



Commentaires